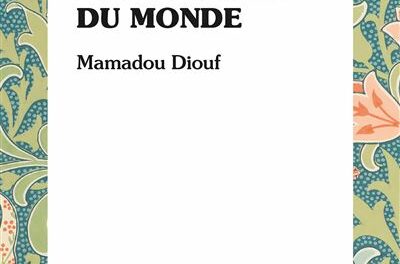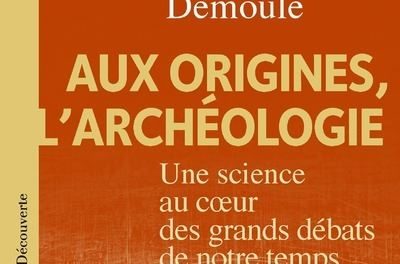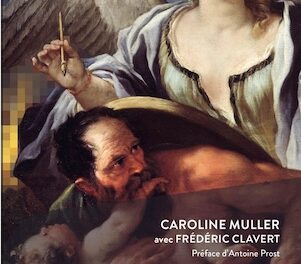Il faut incontestablement un petit peu de temps pour « digérer » cette réédition d’un essai qui a été publié en 2006. La question de la mémoire, de ce « devoir » qui semble s’imposer aux générations présentes et à venir, est devenue une question centrale dans le débat public, depuis que, lors d’une séance de nuit à l’assemblée nationale, un quarteron de députés, a fait voter une loi « mémorielle » de trop.
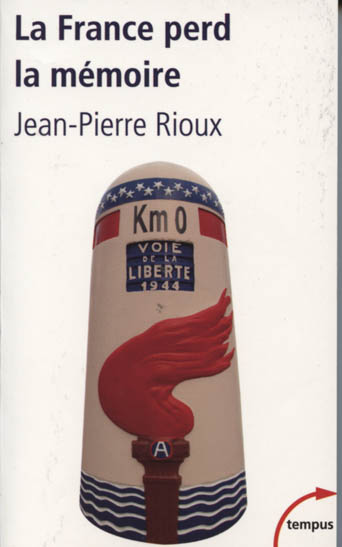
Cette dernière a suscité, à propos du bilan positif de la colonisation, une émotion dans la corporation des historiens, soucieux d’éviter que l’histoire, méthode scientifique de lecture du passé, ne se retrouve instrumentalisée par le politique. Depuis la parution de cet essai en 2006, il semblerait qu’il y ait un consensus sur la non pertinence de nouvelles lois mémorielles. Il en existait quelques-unes qui étaient prêtes en 2005, notamment l’une d’entre elles sur la reconnaissance du génocide des ukrainiens lors de la collectivisation forcée de 1928 – 1932 avec la famine qui s’en était suivie.
Si le devoir de mémoire est devenu une expression galvaudée à force d’avoir été trop utilisée, il n’en va pas de même pour ce que l’auteur appelle la mise en accusation du passé, qui n’est plus simplement lié aux blessures mal cicatrisées de la seconde guerre mondiale et de la collaboration, mais de plus en plus à la question coloniale et à celle de l’immigration.
Ce que l’auteur appelle « l’indécise nouveauté du monde du XXIe siècle » semble brouiller toutes les cartes. Les questions qui touchent aux identités communautaires sont devenues centrales d’autant plus que l’actuel locataire de l’Élysée a eu tendance à vouloir jouer de ce levier avec une certaine inconscience. Mais cette question du brouillage de mémoire va très au-delà des considérations politiques. La volonté de vivre l’instant présent, mais sans certitude pour ce qui concerne l’avenir, est à notre sens en train de faire des ravages.
Brouillage des mémoires
La communication en temps réel fait bouger les lignes, les lieux de mémoire et les traces patrimoniales sont livrés au consumérisme, ce qui contribue d’autant plus à rendre les repères plus flous.
L’auteur a jugé utile de rajouter à cet ouvrage, dans cette réédition de poche, deux textes qui s’interrogent sur l’état du « plébiscite de chaque jour », dont parlait Ernest Renan et une autre réflexion, intitulé « bonjour, Pénélope », qui s’interroge sur la cassure et l’art de renouer le fil du temps.
Dans la première partie, « c’est grave, docteur ? » Jean-Pierre Rioux fait remonter le basculement au 29 mai 2005, lorsque le non au référendum sur le traité établissant une constitution pour l’Europe l’a emporté. D’après l’auteur, la France a signalé au monde sa préférence pour la macération et sa vocation à faire l’autruche. On peut discuter sans doute cette affirmation. Plus peut-être que le refus d’une Europe lointaine et ressentie comme « normalisatrice », ce non au référendum pouvait être interprété comme une forme de refus des remises en cause que la mondialisation implique. Mais ces réserves n’enlèvent rien à la pertinence de ce « bonsoir des pépés », dont parle l’auteur. Il semblerait que ce soit dans les années 70, que soit surgi un petit peuple d’érudits locaux, des mémorialistes, qui ont retrouvé ainsi une nouvelle jeunesse, au nom de la nécessité de sauvegarder un patrimoine que les 30 glorieuses avaient eu tendance à dilapider. Pour l’historien de la vie politique, on peut comprendre que cette tendance à vouloir « culturaliser » les évolutions sociales était vécue comme un ferment de dépolitisation de masse. On aurait tendance d’ailleurs à le suivre sur ce terrain, en faisant le constat que la montée en puissance de l’écologie politique se révèle porteuse d’une tendance à l’indifférence et au repli sur soi. On se retrouve ainsi davantage préoccupé par la nécessité de manger sainement et d’avoir des comportements écologiquement responsables que de la nécessité de transformer la société.
Histoire et commémoration
En faisant l’inventaire des différentes questions liées à l’histoire et la mémoire, Jean-Pierre Rioux fait ici œuvre utile. Il évoque à propos des Français le détournement de sens entre la commémoration l’histoire. On pourrait d’ailleurs s’interroger sur la volonté que l’on a pu avoir de rappeler 1789 à l’occasion d’une sorte de défilé Disneyland qui n’avait pas d’autre utilité que celle d’avoir lieu. Cela rappelle certaines réunions dans l’éducation nationale. De ce fait, parce que peut-être l’on manquait de visibilité pour l’avenir, le politique a été encouragé dans cette tendance à faire de « l’ardente obligation » l’alpha et l’oméga de l’action.
À partir de là, puisque comme le dit avec une certaine ironie Jean-Pierre Rioux, Astérix a pris sa retraite, se développe cette tendance à l’instrumentalisation du passé, ce qui a dispensé de réfléchir à des projets pour l’avenir. De ce point de vue, la référence à l’identité nationale, à une relecture en version abrégée de Ernest Renan, a probablement fait des ravages. L’auteur le rappelle d’ailleurs : « pour Renan, la nation n’est donc pas une identité. Elle est un héritage autant qu’un dévouement, une ardeur et un désir autant qu’une mémoire, un devenir autant qu’une succession : elle est l’union active d’un passé assumé et d’un avenir délibéré. »
Mais c’est parce que ce projet collectif dont l’idée de nation est porteuse est en panne que l’on a eu tendance à revenir à cette « macération » à propos du passé que l’on a eu tendance, pour de dérisoires raisons électorales, à utiliser.
Relire Renan ?
L’auteur propose d’ailleurs d’enrichir cette idée de nation en la dépassant. La conjonction de crise d’envergure mondiale et interdépendante entraîne à frapper de plein fouet l’idée de souveraineté de l’État-nation et d’universalisme républicain. Il importe alors de rechercher une « gouvernance mondiale » et donc d’aller vers le supranational. Évidemment, si le supranational s’identifie aux délocalisations, ou à une Europe vue comme technocratique qui veut réglementer les cultures, il y a fort peu de chances que le message de Jean-Pierre Rioux soit entendu. Il en a d’ailleurs conscience en expliquant que, de coeur et de raison, la nation est encore le cadre qui préserve le moins mal en nous l’idée d’avancer encore. Ensemble.
En guise de conclusion pour cet essai, Jean-Pierre Rioux reprend le texte d’une conférence, fait une vingtaine de fois en France de 2006 à 2010. Dans son « bonjour, Pénélope », l’auteur tire un signal d’alarme sur la dilapidation du patrimoine par usage immodéré du concept. Il parle à son propos de neuroleptique, plus que d’héritage et de transmission. À trop user et abuser des références aux grands hommes, au lieu de mémoire, on a fini par substituer le « présentisme » qui fait des people, les « personnalités préférées des Français ». Le passé vécu comme inhumain, est devenu infréquentable à laisser la place à la médiatisation du présent. Le sacre du présent surplombe et plombe nos débats et combats de mémoire, et ce que l’on appelle le « vécu » est devenu déterminant. Mais cet événement, forcément éphémère, est immédiatement enfoncé dans le passé, et l’action laisse la place à l’émotion. De ce point de vue, on comprend bien que la tendance à vouloir légiférer au moindre fait divers apparaît comme une réponse médiatique qui tient lieu de politique.
Le présentisme
L’auteur propose en conclusion une chronologie qui commence en 1975 et qui s’achève en 2010. En 1975 on relèvera la sortie de l’ouvrage de Pierre Jakez Hélias, devenu un formidable succès de librairie avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus. Le patrimoine « vécu » venait de trouver sa bible. En 2010, le 7 janvier, Nicolas Sarkozy confirme la création d’une maison de l’histoire de France qui suscite d’ailleurs bien des interrogations dans la communauté des historiens. Une fois de plus, la matière historique se retrouve, comme les confitures de jadis, sous une couche de paraffine. Et l’on peut rapprocher cette tendance du détricotage des programmes d’histoire et de leur contenu, entrepris depuis 2008. Pour la première fois en effet, depuis 1982 et le colloque de Montpellier sur l’enseignement de l’histoire organisée par le ministre de l’éducation nationale de l’époque, Alain Savary, jeune professeur, j’avais participé avec l’enthousiasme du néophyte à cette réunion qui avait été initiée par l’appel d’Alain Decaux dans le Figaro Magazine, « Français, on n’apprend plus l’histoire à vos enfants » l’histoire, comme discipline scientifique de formation se voit retirée d’un ordre d’enseignement. Au-delà des préoccupations corporatistes, et du calcul comptable en matière d’économies de postes budgétaires, cette remise en cause vise à ancrer dans les jeunes générations la référence à une histoire « livre d’images », et en aucun cas celle d’une matière vivante chargée de sens pour inventer un avenir et d’autres possibles.