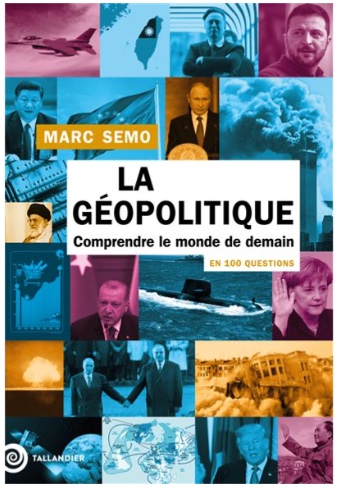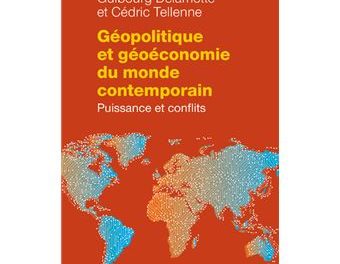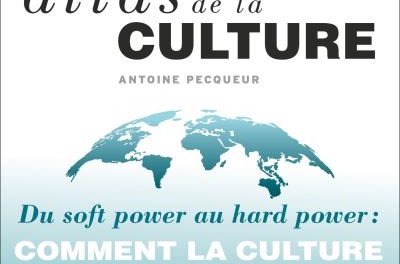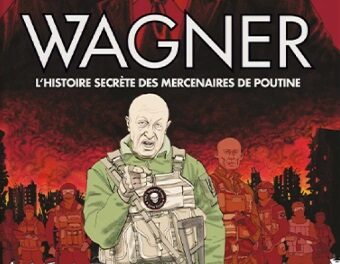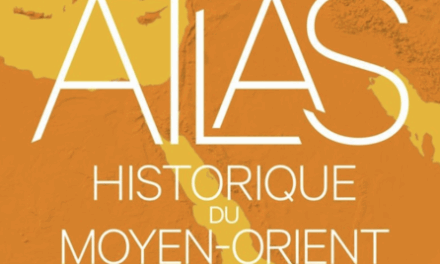Dès l’introduction, Marc Semo explique qu’il n’est pas universitaire et que ce qu’il peut apporter est donc son expérience. Il souhaite offrir avec ce livre un décryptage clair et pédagogique d’une discipline aujourd’hui très populaire.
L’auteur
Marc Semo est journaliste, spécialisé dans les questions internationales. Il a longtemps travaillé à « Libération » puis au « Monde ». Il est aujourd’hui collaborateur à « France Culture » et éditorialiste pour « Challenges ».
Pourquoi la géopolitique ?
Des moyennes puissances désinhibées s’affirment comme l’Inde, la Turquie ou l’Arabie Saoudite. Les Européens sont-ils prêts à vivre dans un monde où seule compte la loi du plus fort ? Comme le veut l’esprit de la collection, chaque question est abordée en un recto-verso environ.
Géopolitique de la politique
Le mot est aujourd’hui utilisé à tout propos. L’auteur parle d’abord de la géopolitique des puissances maritimes. En effet, à rebours de la vision continentale allemande, l’école anglo-saxonne a privilégié une approche maritime. Cette partie permet de préciser les concepts comme le « heartland ». Il faut entendre par là la région pivot, celle qui constitue l’enjeu de la géopolitique mondiale. Le « rimland » désigne lui la zone où se cristallisent les rivalités. Ensuite, c’est le moment de préciser les conceptions notamment françaises ou allemandes de la géopolitique. On a parfois tendance à opposer un peu trop schématiquement tellurocratie et thalassocratie. La vraie puissance est amphibie, à la fois maritime et terrestre. La géopolitique est donc de retour car elle a su depuis 1945 renouveler ses approches et tirer les leçons des dérives du passé.
Grammaire de la géopolitique
L’auteur définit d’abord la puissance, s’interroge sur le poids du territoire ou encore de la démographie. Cette dernière reste un facteur essentiel de puissance. Il est temps ensuite de décliner le tryptique grande, super ou hyperpuissance et donc de réfléchir aussi à l’hégémonie. Bertand Badie souligne le fait que la mondialisation n’est pas compatible avec l’hégémonie. La force militaire fait l’objet d’une entrée puis l’auteur développe quelques théories en relations internationales. Le soft power ou la question des limites ne sont pas oubliés.
L’État dans tous ses états
Les traités de Westphalie en 1648 ont marqué une étape. Presque tous les pays européens participèrent aux négociations. L’auteur s’arrête alors sur la notion d’État et précise ce qu’il faut entendre par Empire. Ce fut une des premières constructions étatiques de l’histoire, notamment en Asie et au Moyen-Orient. L’Empire romain dura entre cinq et quinze siècles selon les dates choisies. Michel Foucher a défini les frontières soulignant qu’« elles restent des buttes témoins du passé ou des fronts à vif selon les conjonctures, toujours des lieux de mémoire et parfois de ressentiment ». Presque 50 % des kilométrages de frontières européennes datent d’après 1945 et plus du quart est postérieur à 1990.
Le retour de la guerre
La notion de guerre hybride fait l’objet d’une entrée. Marc Semo s’interroge aussi sur un retour de la guerre froide. Rappelons que l’expression est apparue sous la plume de George Orwell. Dans le monde entier, les dépenses militaires augmentent selon les calculs de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les articles suivants précisent les notions de « conflit gelé », de « guerre juste ».
Géopolitique de l’Occident
C’est d’abord par ceux qui le contestent, que se définit l’Occident. La notion n’est pas que géographique. Depuis 2022, les BRICS pèsent pour 31,5 % du PIB mondial, dépassant pour la première fois ceux du G7 (31 %). Mais, en terme de PIB par habitant, les pays occidentaux restent bien devant. Isolationnisme ou multilatéralisme : ces mots sont cruciaux à comprendre aujourd’hui, tout comme de comprendre les fondements de la puissance américaine ou les ressorts de l’Europe comme puissance.
Le nouveau grand jeu des puissances
La Russie, c’est aujourd’hui 145,5 millions d’habitants et le déclin est amorcé. Le PIB russe varie selon les années entre celui de l’Espagne et celui de l’Italie. Le pays aurait déjà perdu 200 000 hommes dans le conflit avec l’Ukraine. Quant à la Chine, elle risque d’être vieille avant d’être riche. Depuis la fin de la politique de l’enfant unique en 2015, les naissances ont chuté de moitié. L’Inde est actuellement au 129 ème rang mondial en terme de PIB. La France doit aussi considérer de nouveaux ensembles comme l’Indopacifique puisque 90 % de son importante ZEE est située ici. Le réseau diplomatique français demeure le deuxième ou troisième du monde.
La géopolitique des émergents
Il est temps alors de définir les forces et faiblesses des BRICS. Représentant quelque 46 % de la population du globe et près de 3,7 milliards d’habitants, les BRICS pèsent lourd. Cependant, ils ne disposent que de 15 % des votes à la Banque mondiale et au FMI. L’Amérique latine de son côté continue d’être avant tout un immense réservoir de matières premières, notamment agricoles. L’une des principales menaces pour la stabilité de ces pays est l’explosion de la violence. L’auteur passe en revue d’autres puissances comme la Turquie ou l’Iran qui veut s’affirmer comme la puissance montante d’un grand Moyen-Orient. L’Arabie Saoudite compte elle ne plus dépendre du pétrole à l’horizon 2030. Il ne faudrait pas oublier les lions africains qui décollent. Un politiste note par ailleurs que « les potentialités de croissance du Nigeria autant que sa capacité de nuisance intriguent et effraient tout à la fois ».
La quête des règles dans le chaos du monde
On peut dater du Congrès de Vienne en 1815 la première approche du multilatéralisme. Aujourd’hui, la gouvernance mondiale s’appuie sur l’ONU dont le système est lui-même fondé sur trois piliers : la sécurité et la paix, l’économie, et les droits humains. L’auteur pose ensuite la question du bilan des interventions militaires occidentales au nom de l’humanitaire et du contre-terrorisme. Le coût humain et guerrier de telles guerres et la stabilisation peuvent s’avérer immenses mais le coût de l’inaction serait aussi terrible. Un article est consacré au droit pénal humanitaire.
Les réalités de la géoéconomie ?
La mondialisation actuelle n’est pas un phénomène inédit dans l’histoire même si elle est d’une ampleur inégalée. L’interdépendance reste une réalité mais il s’agit de ce que certains économistes appellent une « interdépendance arsenalisée » qui favorise le pouvoir de contrainte des États. Marc Semo insiste sur la « maritimisation » du monde et sur l’importance des câbles sous-marins, ce véritable réseau d’autoroutes de l’information long de plus de 1,3 million de kilomètres. L’Europe doit affronter la question énergétique alors qu’elle importe 90 % de son pétrole et 60 % de son gaz.
Géopolitique des grands défis transversaux
Parmi les grands défis, il y a celui des biens publics mondiaux. On entend par là des biens dont il est impossible d’exclure un utilisateur et dont les utilisateurs ne sont pas rivaux. C’est par exemple la qualité de l’environnement ou l’éducation. La question démographique est également fondamentale lorsque l’on sait que les plus fidèles alliés des États-Unis sont ceux qui vieillissent le plus. Le tour d’horizon se termine par une approche de la guerre informationnelle et de l’intelligence artificielle en se demandant s’il s’agit d’une révolution géopolitique.
Cet ouvrage peut être un outil de travail utile dans le cadre de l’HGGSP. Ses entrées ciblées peuvent permettre de le conseiller aux élèves.
Lien vers l’éditeur : https://www.tallandier.com/livre/la-geopolitique-en-100-questions/