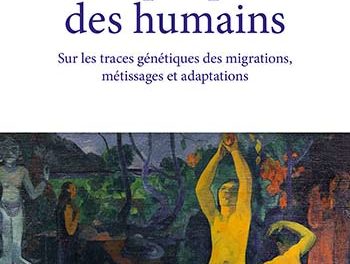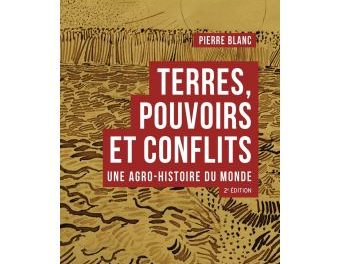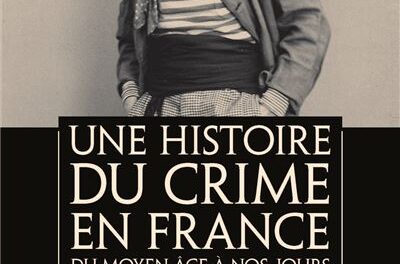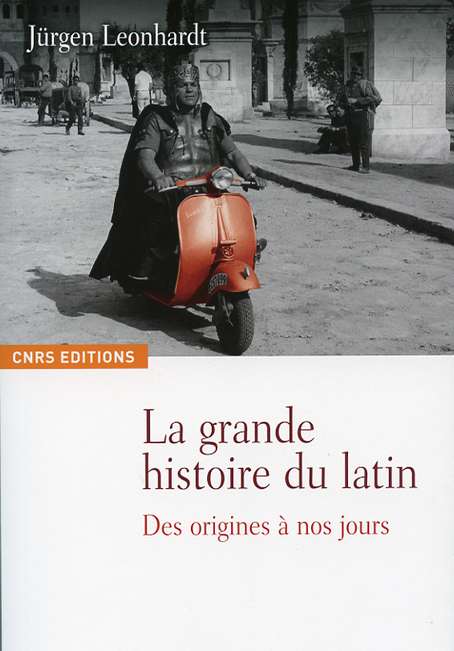
« Sans le latin, la messe nous emmerde », chantait Brassens.
Sans le latin, inutile de chercher à comprendre les 2700 ans d’histoire qui ont vu naître l’Empire romain, triompher le christianisme, s’affirmer l’identité de l’Occident. Sans le latin, qui faillit disparaître dans les brumes du haut Moyen Âge, impossible de penser la mondialisation, puisque cet idiome fut le premier à connaître un rayonnement international. Sans le latin, Gutenberg n’aurait pas inventé l’imprimerie, ni Descartes le cogito…
L’auteur retrace l’extraordinaire aventure de cette langue, de Romulus à nos jours en passant par les monastères carolingiens, l’épopée des conquistadors, la Sorbonne de la Renaissance, les bibliothèques des Lumières, le concile de Vatican II… qui vit le latin chassé des églises et continuer sa route ailleurs…
Langue des vainqueurs, langue administrative, langue des érudits, langue scolaire et langue de l’Église… Classique, vulgaire, médiéval, humaniste, moderne, le latin sous toutes ses formes a façonné nos représentations, épousé la marche de l’histoire, produit d’innombrables trésors de foi et de culture. Et offert un support indispensable à la bonne santé de ses nombreux cousins, le Français, l’Italien, l’Espagnol…
La langue dominante est en effet un instrument de puissance. Peut-être que le XXIe siècle verra alors le mandarin remplacer l’anglais ?
Le destin tout à fait singulier de la langue latine se voit conférer une actualité brûlante en ces temps de globalisation, où s’entrelacent les cultures et les identités de différents pays. Ces diverses évolutions, mais aussi l’importance grandissante de l’anglais comme langue internationale, ont fait vaciller la conception selon laquelle l’épanouissement langagier de l’individu devait nécessairement passer par la pratique constante et attentive de la langue maternelle; elles sont autant d’incitations à repenser entièrement cette question de statut : qu’est-ce qui condamne une langue à devenir une « langue morte » ?
Commençons par quelques remarques sur le rôle de la langue maternelle. Dans notre monde moderne, les exigences du plurilinguisme ne s’imposent plus seulement aux élites des milieux culturel ou diplomatique, comme c’était encore le cas il y a quelques décennies, mais à de larges secteurs de la population. Si l’on établit une comparaison avec ce qui se passait au XIXe siècle, on constate que de nos jours, bien plus de gens sont amenés à effectuer des opérations mentales parfois complexes dans une langue qu’ils n’ont apprises qu’en second lieu, certains devant même donner une dimension polyglotte à leur vie quotidienne. Le plurilinguisme – un domaine où, bien loin de se contenter d’une vague aptitude à communiquer, la maîtrise de l’écrit et une certaine aisance dans la négociation sont également requises – est devenu l’idéal d’un monde globalisé.
L’anglais successeur du latin
Cette exigence nouvelle provoque des mutations fondamentales au sein du système éducatif: l’enseignement de la langue maternelle se voit complétée, et même dans certains cas remplacée par un apprentissage bilingue qui débute aussi tôt que possible. La langue maternelle a perdu un peu de sa toute-puissance. Parallèlement, l’idiome anglo-saxon a conquis une position hégémonique, que nul autre ne lui conteste : il est plébiscité dans le monde entier lorsqu’il s’agit de choisir une première langue étrangère ; parmi tous les individus parlant et écrivant l’anglais, ceux dont il est la langue maternelle – les fameux native speakers – ne représentent plus qu’une minorité.
En tant que langue internationale, l’anglais a pris la succession du latin, comme de nombreux commentateurs l’ont fait remarquer au cours de ces dernières années. Pour la première fois, l’on peut prendre l’exacte mesure des qualités intrinsèques du latin en tant que langue internationale sans tomber pour autant dans les errements d’une apologétique, dont les philologues classiques se sont toujours fait une spécialité. Constatons au passage, non sans amusement, que le nouveau rôle dévolu à l’anglais fait ressurgir de nombreuses questions auxquelles le latin se trouva jadis lui aussi confronté.
Les changements les plus considérables dans les habitudes linguistiques se sont bel et bien produits sur un terrain qui constitua durant des siècles le domaine réservé du latin : celui des sciences. Le XIXe siècle, jaloux de tout ce qui touchait aux prérogatives nationales, s’en était fait en quelque sorte un point d’honneur: toutes les contributions et autres documents scientifiques qui prétendaient à une reconnaissance internationale devaient être rédigées dans la langue du pays de son auteur. Lorsque cette posture devenait par trop incommode – dans le cas de langues peu répandues comme le finnois ou le polonais – et qu’on tenait absolument à toucher les lecteurs du monde entier, le choix se portait sur la langue de publication dont on se sentait culturellement le plus proche: le français, l’anglais ou l’allemand ; dans tous les autres cas, les chercheurs publiaient leurs travaux dans la langue nationale. Pour les grandes nations européennes, l’emploi de la langue du pays allait de soi, quelque soit la discipline concernée. Les élites, dotées d’une solide instruction scolaire, ne se laissaient pas arrêter par les frontières nationales: les plus érudits mettaient volontiers à profit leurs connaissances des langues étrangères pour étudier divers ouvrages dans l’original, mais tous écrivaient dans la langue de leurs pères. La prépondérance de l’anglais, qui s’est imposée comme langue scientifique de la planète, a bouleversé ces habitudes pourtant si bien établies.