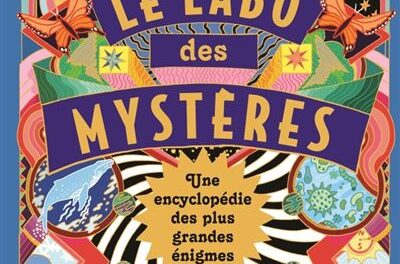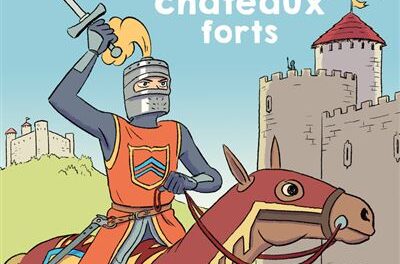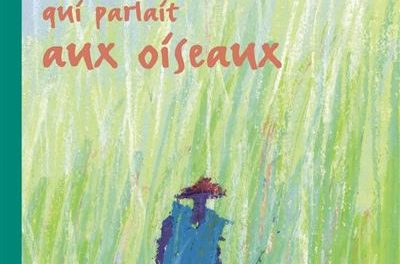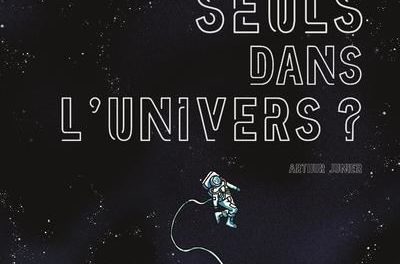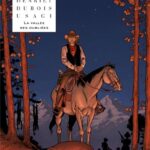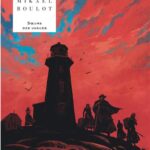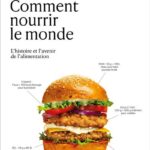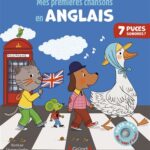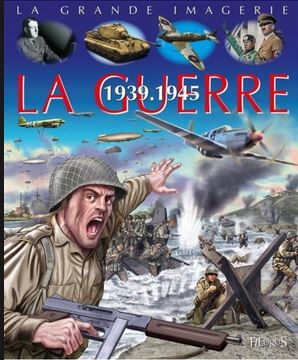
Des textes clairs et des mots justes
L’ouvrage s’adresse a priori à des enfants de 8-12 ans. Il est conçu par Jacques Beaumont avec un texte de Christine Sagnier. La table des matières récapitule un travail en 10 thèmes par double-page. On passe de l’avant-guerre, à l’arrivée du nazisme au pouvoir. L’Europe en guerre précède la vie sous l’occupation, la résistance et la collaboration, la mondialisation de la guerre, le génocide, le tournant de la guerre puis les armes et le matériel. L’ouvrage se referme sur le lendemain de la guerre.
D’une façon générale, les textes sont clairs et soutenus par une maquette bien conçue. L’explication à la prise de pouvoir de Hitler distingue l’élection au Reichstag et la nomination du chancelier par Hindeburg. L’ouvrage est de son temps en n’omettant pas de mentionner les homosexuels dans la liste des déportés. L’explication du génocide est claire et trouve les mots justes pour expliquer la notion de sous-hommes pour le nazisme. Le débarquement est qualifié de débarquement allié, ce qui est un point positif lorsqu’on sait le nombre de publications qui font allusion à un débarquement américain (la majorité des soldats était britannique).
Quelques énormités dont certaines particulièrement regrettables
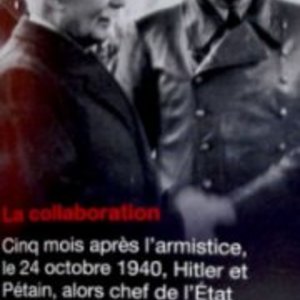
Sans doute a t-on choisi pour titre «1939-1945» pour éviter l’appellation « Seconde Guerre mondiale» déjà au catalogue de l’éditeur. Il demeure que si cette guerre commence pour la Chine en 1931-1937, pour l’Éthiopie en 1935, pour la Belgique en 1940 ou pour l’URSS et les EU en 1941, un enfant s’interrogera sur la pertinence du titre.
La collaboration dépaxtonisée et le retour du partage du monde à Yalta
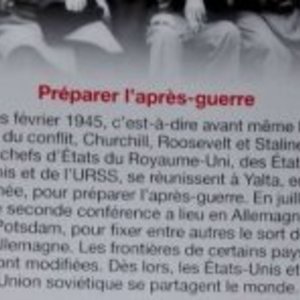
Le passage sur la collaboration française est plutôt consternant. On y affirme que « Pétain accepte dès lors de collaborer avec l’Allemagne (sic)» (p. 15), singulière façon de présenter la politique de collaboration proposée par Vichy et dont le Reich ne cessa jamais de se méfier. Sans doute faudrait-il demander à Fripounet de mettre ses connaissances historiques à jour à compter de l’année 1973.
La consternation se manifeste également lorsqu’on découvre le traitement réservé à Yalta (p. 27) où l’on apprend que « les États-Unis et l’Union soviétique se partagent le monde (sic)». Certes, les auteurs ont des circonstances atténuantes. Cette vieille légende franco-française a été soigneusement entretenue, y compris par un de Gaulle ou un Mitterrand. On sait par ailleurs que l’ensemble des journalistes français ont en commun d’avoir tous été absents le jour où la conférence de Yalta fut traitée au collège, au lycée puis dans le supérieur. D’où l’ignorance des médias français sur le sujet et la tendance à répéter à l’envi cette perle d’inculture. A cela, il faut ajouter que si le chapitre sur le génocide trouve les mots justes et mentionne les Tsiganes, un terme fondamental est regrettablement omis : racisme. L’omission est plutôt consternante.
On aura compris malgré les qualités pédagogiques indéniables de cet ouvrage que le contenu est nettement perfectible. Ceci étant, il ne contient peut-être pas plus d’énormités que quelques autresPar exemple, une récente Histoire de France en bandes dessinées dont l’auteure affirme, malgré la reprise d’un grand nombre de clichés, avoir tenu compte des acquis de l’histoire savante.. Il n’en demeure pas moins que ceux qui écrivent les livres d’histoire pour les enfants et le plus grand public sont sans doute pétris de l’idée qu’elle serait un genre littéraire ouvert à tous plutôt qu’une science humaine avec sa méthode et ses règles.
Dominique Chathuant | © Les Clionautes