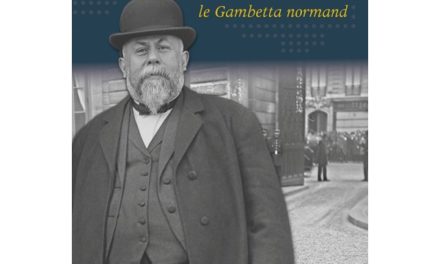L’historiographie de la Guerre d’Algérie a clairement changé de siècle en 2000 : la soutenance de la thèse de Raphaëlle Branche, publiée l’année suivante (La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962, Paris, Gallimard) ou tous ses travaux portant sur la violence et le système colonial ont évidemment contribué à construire un regard critique nouveau sur la question, en s’affranchissant des points de vue des acteurs directs, jusque là dominants. Le titre de son ouvrage paru en 2005 en témoigne clairement : La Guerre d’Algérie : une histoire apaisée ? (Le Seuil, coll. « L’histoire en débats »).
Raphaëlle Branche, Maître de conférences en histoire contemporaine à Paris-I-Panthéon-Sorbonne, a dirigé un nouvel ouvrage important, publié fin 2009, et qui marque un nouveau pas important sur cette voie.
D’abord parce qu’il rassemble des contributions d’une quinzaine d’historiens majeurs de ce champ de recherches qu’est l’Algérie dans la guerre de libération.
Ensuite parce qu’on peut y voir le lien entre plusieurs générations d’historiens réunis dans un projet commun. La figure la plus ancienne est celle de Charles-Robert Ageron, né en 1923 et décédé dans l’année qui a précédé la parution de ce livre. Le livre, logiquement, lui est dédié. Mais les générations suivantes sont représentées, avec Benjamin Stora, Guy Pervillé, Omar Carlier ou Sylvie Thénault, etc. S’y ajoutent aussi trois contributions de chercheurs étrangers (britanniques).
De la guerre d’Algérie à la guerre des algériens
Le premier apport directement utile pour les enseignants est la présentation de Raphaëlle Branche. En une douzaine de pages très denses, elle propose en effet une synthèse excellente, avec une périodisation argumentée, qui, sans négliger les racines et les implications du conflit en métropole, contient déjà ce qu’on peut concevoir comme le parti pris d’ensemble : un renversement de l’angle d’analyse. Il s’agit en effet de la guerre d’indépendance des algériens, et non pas de la « Guerre d’Algérie », encore moins des « évènements d’Algérie ». Comment les algériens eux-mêmes ont-ils vécu, agi, souffert, combattu, et « comment sont-ils devenus algériens » ? L’objectif est de tenter de comprendre ce conflit « au ras du sol », de comprendre comment le passage de l’Algérie française à l’Algérie indépendante se traduit au quotidien, en particulier en termes d’identité pour les populations directement concernées.
Cette introduction ouvre une somme de quatorze contributions, qu’on ne pourrait toutes présenter ici en détail, mais qui apportent toutes quelque chose d’intéressant.
Plusieurs traitent plutôt de la situation en amont, des racines et de la gestation du mouvement nationaliste algérien.
Omar Carlier examine le rôle de l’Étoile Nord-africaine et de son leader charismatique Messali Hadj au sein de l’émigration algérienne en métropole avant la seconde guerre mondiale. Et de la place donnée (retirée ?) à ce mouvement majeur dans le discours historique de l’Etat algérien aujourd’hui. Entre mythe et occultation, l’Etoile nord-africaine, pourtant première association politique autonome, aux source du nationalisme algérien, peine à trouver une place dans l’histoire officielle en Algérie.
La contribution de
Benjamin Stora
emprunte le même chemin de réflexion sur les conditions dans lesquelles se fait l’histoire. En s’engageant dans la rédaction d’une biographie de Messali Hadj, puis d’un vaste Dictionnaire biographique (de 600 militants nationalistes), Benjamin Stora est arrivé à une réflexion plus générale sur les origines sociales des acteurs principaux : ceux de l’avant-garde, mais aussi le rôle des élites rurales, des « bourgeois de village » et des ouvriers agricoles. Et il tente d’expliquer la sous représentation des paysans dans les instances dirigeantes du nationalisme par la répression coloniale, le poids de l’islam, le quadrillage des campagnes par un réseau de notables acquis à la présence française, ou encore le déficit de formation des militants paysans au sein des formations nationalistes.
Guy Pervillé essaie aussi de creuser la question des élites algériennes, et de leurs origines sociales et de leur formation. Les composantes politiques du nationalisme algérien (Malika Rahal traite de la place des réformistes) ou les apports personnels (Sylvie Thénault évoque la figure de l’instituteur et écrivain Mouloud Feraoun, assassiné en 1962 par un commando de l’OAS, et de sa relation complexe avec la question des rapports entre la France et l’Algérie).
Si cet ouvrage s’efforce de renverser le point de vue, en se situant du côté algérien de la guerre d’indépendance, la complaisance n’est pas de mise : la diversité des attitudes au sein de la population algérienne est prise en compte, mais aussi les pires excès ne sont pas passés sous silence. L’article de Charles-Robert Agéron (Complots et purges dans l’ALN entre 1958 et 1961) fait le point sur le degré extrême de violence de la « justice révolutionnaire » au sein du mouvement nationaliste. Entre paranoïa du complot et de la manipulation et élimination des adversaires pour le contrôle de l’appareil, les purges sanglantes n’ont pas cessé, et elles permettent sûrement de mieux comprendre la violence jamais interrompue en Algérie, des « enfumades » de Bugeaud aux égorgés du FIS.
L’apport suivant est doublement conforme à la démarche générale de l’ouvrage : il propose une analyse des rouages internes du FLN (plus précisément de la Fédération de France), à un moment crucial (l’organisation de la funeste journée du 17 octobre 1961), mais vue par deux historiens britanniques, ce qui est peu fréquent. Jim House et Neil Mac Master, en s’appuyant en particulier sur des sources militaires et policières françaises, qui compensent les lacunes des archives du FLN, souvent détruites ou dispersées, reviennent en détail sur les semaines qui précèdent la terrible répression d’octobre 1961, en décrivant le fonctionnement des nationalistes en métropole, les liens extérieurs (appuis en Allemagne, GPRA à Tunis), le processus complexe de prise de décision et le contexte politique (et policier) du moment.
Une contribution intéressante prend comme sujet la «forteresse ouvrière» de Renault dans le contexte de cette guerre d’Algérie. Elle fait ressortir le rôle du PCF et de la CGT dans la relative faiblesse de la mobilisation ouvrière dans le soutien à la cause du FLN : les « solidarités d’atelier », locales, individuelles et spontanées, mais sans réelle continuité, l’emportent souvent sur une solidarité ouvrière internationaliste et anticolonialiste parfois tiède. Au point, peut-être, de remettre en question les concepts de classe ouvrière et e mouvement ouvrier selon Laure Pitti, auteure de cet article.
La lancinante question des Harkis
Plusieurs contributions, complémentaires, abordent la question de l’engagement militaire de certains Algériens dans les combats aux côtés de l’armée française.
On connaît en général aujourd’hui, à travers leurs difficultés d’intégration après 1962, le cas douloureux des harkis. Il est abordé par une autre contribution de Charles-Robert Ageron (« Les supplétifs algériens dans l’armée française pendant la guerre d’Algérie »), qui permet de mesurer le nombre et la très grande diversité des formations auxiliaires composées de soldats musulmans. Il évoque aussi les différents moteurs qui ont pu jouer dans l’engagement de ces Algériens, en défendant l’hypothèse d’une minorité agissant par patriotisme français, et d’un faisceau de motivations surtout économiques, mais sans exclure pressions et engagements forcés de la part des autorités coloniales, ou conflits intertribaux et les allégeances traditionnelles. Il conclut par ailleurs sur les limites politiques des supplétifs (échec du projet de constitution d’un « grand parti de la France »), mais aussi sur les difficultés d’en mesurer l’efficacité militaire. L’analyse est de grande qualité, évaluant et mesurant de façon détaillée la combativité, l’importance des désertions, les défections multiples, les risques de noyautage, ainsi que les jugements portés sur ces supplétifs par les différents acteurs. Les derniers développements ne sont pas sans importance pour la question de la mémoire des harkis, « abandonnés par la France », puisque C.R. Agéron conclut, en s’appuyant sur des données précises, que « dans leur grande majorité ils ne se sont jamais considérés comme des soldats de l’armée française » (seuls 6% d’entre eux ont fait ce choix en mars 62 malgré des conditions présentées comme « exceptionnelles »).
Un essai de périodisation de « l’engagement des harkis » entre 1954 et 1962 vient compléter directement l’article de C.R. Agéron. François-Xavier Hautreux repère une première phase d’improvisation, puis à partir de 1957 une première augmentation importante des effectifs, essentiellement pour leur meilleure connaissance du terrain, mais aussi pour ses aspects psychologiques et politiques. L’utilisation de ces troupes, leur armement, les modes de recrutement de ces soldats sont évoqués, jusqu’au tragique été 1962, dont un bilan humain est proposé, en suggérant la nécessité d’écrire l’histoire avant de construire la mémoire du phénomène harki.
Dans un autre article, qui clôture l’ouvrage,, Chantal Morelle (« Les pouvoirs publics français et le rapatriement des harkis en 1961-1962 ») revient sur la question du rapatriement des harkis, des reproches faits au gouvernement français de n’avoir pas su les protéger, conformément aux accords d’Evian. L’organisation des retours (pieds-noirs et harkis), les immenses difficultés du moment, la complexité de l’accueil en métropole montrent l’imbrication des responsabilités.
Stéphanie Chauvin présente le cas particulier des conscrits FSNA, ce qui dans le jargon de l’époque désigne les « Français de souche nord-africaine ». «Des appelés pas comme les autres ?», qui ne sont pas à confondre avec les harkis, mais qui, depuis 1912, effectuent en tant qu’ «indigènes musulmans d’Algérie», leur service militaire dans l’armée française. Ils compensent les classes creuses de métropole, tout en ajoutant d’autres enjeux, puisqu’on souhaite en faire de véritables militants de la cause française.
Les viols et la sale guerre
L’un des intérêts du livre est de mettre en lumière l’extrême violence («brutalisation» ?) engendrée par la guerre de libération, dans tous les secteurs de la société.
Raphaëlle Branche
, dans un article d’une grande intensité (« Des viols pendant la guerre d’Algérie »), analyse un des pires aspects de la « guerre sale ». En rejetant l’hypothèse d’écarts spontanés ou d’actes individuels, elle part du postulat suivant Conquérir, occuper, vaincre : les trois logiques du viol, pour montrer que la souffrance volontairement infligée à des femmes ne relève pas du hasard de la guerre et de ses débordements. Le crime de viol, dans ce contexte, répond à une volonté délibérée : celle d’atteindre toute une communauté, dans ses valeurs fondamentales. C’est l’arme du conquérant, de l’occupant, le signe de la domination et de la volonté de rester et de durer en Algérie.
Selon Raphaëlle Branche, contrairement aux ambiguïtés du discours officiel de l’armée française sur la pratique systématique de la torture, les cas de viols parvenus à la connaissance des autorités ont donné lieu à des sanctions. Mais si les poursuites ont été très rares, c’est que le silence des victimes l’emporta le plus souvent. Les difficultés immenses vécues par les enfants nés de ces viols sont évoquées, mais plus largement, l’auteur conclut sur les liens entre la virilité et la guerre. Le viol, comme surenchère de l’affirmation virile, dans le contexte désinhibant de la guerre, rejoint le racisme, au cœur du colonialisme. Violence absolue sur l’absolument Autre : parce qu’ennemie, parce qu’Algérienne et parce que femme.
Comment l’appareil d’État en France a-t-il été lui-même transformé par la guerre en Algérie ? Comment les pouvoirs d’exception ont contribué à exclure les Algériens des droits ordinaires de tout citoyen français ?
L’existence même, à la Libération, d’une Brigade nord-africaine (BNA) au sein de la préfecture de police de Paris montre bien que les Algériens de Paris sont traités différemment. Même si le service de police qui lui succède porte le nom de BAV (Brigade des agressions et violences), sa fonction reste la même : surveiller (et punir) la «criminalité nord-africaine», même lorsqu’elle désigne en réalité des manifestants défilant aux cris de «A bas le colonialisme !» ou «L’Algérie aux Algériens!»…Le préfet de police Maurice Papon, on le rappelle ici avec précision, est nommé en mars 1958, imprégné des théories de la guerre subversive. Il organise la militarisation de la police, en écho à l’évolution de l’armée dans la bataille d’Alger, avec la volonté d’anéantir par tous les moyens le FLN en métropole. L’article d’Emmanuel Blanchard (« Police judiciaire et pratiques d’exception pendant la guerre d’Algérie ») décrit les différentes formes de répression à l’œuvre : policière, administrative ou judiciaire ; ou encore la création d’une FPA, force de police auxiliaire, composée de supplétifs Algériens, recrutés en Algérie même, déployés en métropole sous le commandement direct du préfet. Il montre ainsi combien les pouvoirs républicains ont vacillé dans cette période.
A l’arrivée, c’est un apport de grande qualité que cet ouvrage, publié dans une collection très accessible (de poche, 10,50 Euros seulement), et qui apporte une série de regards précis, parfaitement argumentés et complémentaires, et qui permet à chacun de renouveler et d’approfondir la connaissance qu’on peut avoir aujourd’hui d’un moment clef de l’histoire récente.