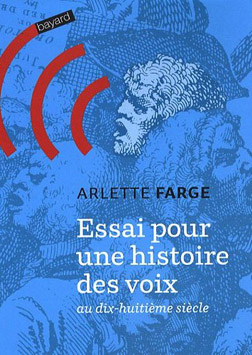
Avec Arlette Farge, nous partons en voyage à travers un XVIIIème siècle de tumulte, entre murmures et grondements critiques, propos blasphématoires, bruit persistant des voix populaires, babils des enfants, cris des possédés et annonces publiques ….
Chercheuse au CNRS et à l’EHESS, auteur de plusieurs études portant sur la vie quotidienne des classes populaires au XVIIIème siècle, notamment Délinquance et criminalité, Vivre dans la rue au XVIIIème, Dire et mal dire, elle s’aventure dans un domaine négligé par les historiens : celui des voix.
La société du XVIIIème siècle est une société oralisante. A Paris, le bruit est assourdissant, « une cacophonie indistincte, éructée par des larynx brutaux », selon les élites.
Le 18ème siècle est le siècle où la parole, la voix, le cri, la lecture orale, la conversation rapide touffue et le badinage malin sont, dans les classes populaires, peu lettrées, les véhicules essentiels de la communication, du monde du travail, qu’il soit rural ou urbain, du lien avec le roi, l’Église ou la justice » (p. 14).
Et c’est bien un défi que se et nous lance Arlette Farge: capter l’inaudible, capter ce qui échappe, ce qui est perdu à jamais. Elle s’appuie sur son matériau de prédilection qui semble inépuisable : les archives de justice et de police, mais également les archives de l’Assistance Publique de Paris. Elle concentre son intérêt sur « les petites choses » et les « petites gens », souvent à la marge de la société (pauvres, fous, criminels, femmes). Elle convoque également les journaux, les traités juridiques, les auteurs littéraires de l’époque.
Traque phonétique
Ses sources ne sont pas directes : elle traque donc dans les retranscriptions des greffiers, dans les textes des « peu lettrés » souvent écrits phonétiquement, dans les sources plus littéraires ou populaires, les phrases, les rythmes, les timbres, les souffles. Elle approche ainsi au maximum le monde de l’oralité. A partir d’un mémoire rédigé par un certain Thorin lors de son embastillement, en 1758, elle nous livre ses hypothèses, par une étude pointilliste de la syntaxe et de l’orthographe plus que chaotiques de l’auteur, pourtant, semble-t-il, d’une certaine culture.
Les « mots agglutinés » comme peinamonmaître, forbravjen ou janpleur en disent long sur ce qui fait unité de sens et racontent, sous la plume de l’historienne, comment les classes populaires se sont appropriées des états ou des attitudes. Jamlavite (« jamais de la vie ») sonne comme « une exclamation exprimant la négation et la non culpabilité ». Elle se prononce dans un souffle comme « une vérité à défendre ». Forbravgens écarte toute forme de distance et témoigne de l’idée que Thorin se fait l’amitié fidèle. Ce mémoire entre oral et écrit est un merveilleux récit sur la voix tout autant qu’il renseigne sur l’univers social et politique des expressions. L’objectif d’Arlette Farge est clair : faire émerger du tohu-bohu incompréhensible, de ce que Rétif de la Bretonne appelle « les borborygmes », toutes ces voix qui sont autant de positions dans le monde social. Après un premier chapitre de définitions du vocabulaire (cri, langage, voix …), elle montre combien la hiérarchisation des voix est révélatrice du statut des interlocuteurs. La voix est un pouvoir dans toutes les couches de la société. Ainsi, la voix d’une femme peut être empreinte d’autorité comme dans les cabarets où elle est utilisée pour faire cesser une bagarre. Pendant la Révolution, les cris des femmes deviennent des armes. Les lettrés, au cours du XVIIIème siècle, créent leur propre oralité: l’art de la conversation cultivé dans les salons, les traités de prononciation, le développement de l’art théâtral témoignent de cette codification de l’oral. Les voix (« A chacun sa voix ») sont multiples : le cri du nouveau né est perçu comme le signe de son appartenance à l’humanité. Un enfant qui naît en silence porte la marque de la sainteté puisque l’intériorité de Dieu est, par essence, sans voix.
La voix des femmes
C’est par son cri déchirant que l’enfant abandonné est souvent sauvé. La voix des femmes est souvent stigmatisée. Douce et maternelle, elle est aussi voix du Diable. Exclues de l’espace politique, les femmes s’y intègrent en se manifestant vocalement. La voix est alors politique. Voix violentes de la dispute ou de la révolte, cris tous distincts des marchands, voix des « hors lieux », des fous, des prisonniers, des galériens, des infirmes, des convulsionnaires , toutes ces voix qu’Arlette Farge appelle joliment « le souffle des passions souffrantes », les voix sacrées de l’Eglise ou du pouvoir dont les ordonnances sont criées selon des notes différentes, les voix de l’amour, toutes ont leur place dans cet essai. Face à cette diversité, le XVIIIème siècle cherche à imposer une orthodoxie de la voix : se multiplient dès lors les traités de diction. On cherche à policer la voix des enfants en leur enseignant l’articulation des mots. Les décisions royales visent à unifier le royaume et, en premier lieu, en uniformisant la langue. Mais par cette normalisation des voix, le pouvoir renvoie chacun à sa catégorie : on parle selon son rang. Et ce n’est sans doute pas un hasard si la voix du roi est absente : le pouvoir absolu est silencieux. Enfin, dans un dernier chapitre « Voir la voix », A. Farge partage son intuition sur les peintres qui donnent à voir les voix sociales : au peuple, les bouches ouvertes et aux élites, les lèvres cousues. Tout comme Diderot, dans les Salons, elle fait parler les tableaux comme ceux de Fragonard qui peint des « bouches fermées comme si elles étaient ouvertes […] les bouches ne sont dessinées que par un point minuscule et cette bouche est plus bavarde que n’importe quel chant de l’oiseau printanier » (p. 293).
Arlette Farge nous livre une enquête passionnante non seulement sur les voix qui, désormais, ne sont plus « perdues à jamais » mais aussi sur le travail de l’historien : « face à des mots écrits et grâce à une lecture minutieuse de ces milliers de procès verbaux, il lui est nécessaire, à force de rigueur d’interprétation, de retrouver, par delà les mots, certains sons et d’en extirper d’évidentes harmoniques […] A l’historien de devenir l’indiciaire des tons » (p. 108). Elle, qui a toujours su résister à l’autosuffisance de la source montre combien elle est parvenue à convoquer ses voix, les ressusciter, les faire parler. A l’écoute de ses archives-matériau, elle prête sa voix d’historienne, dans un livre magnifique, bruissant et très littéraire, aux humbles. Un ouvrage finalement politique et d’actualité : « Il n’est pas question qu’aujourd’hui comme hier, pauvreté et misère laissent l’historien sans voix. Il n’est pas question non plus d’accepter que ces voix du peuple dites défigurées deviennent « sans voix ». Un livre à entendre donc …













