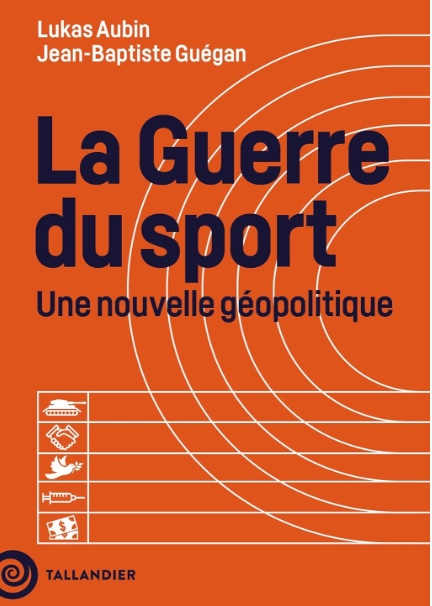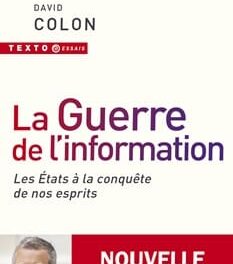Le sport est aujourd’hui le théâtre des affrontements géopolitiques. Lukas Aubin et Jean-Baptiste Guégan explorent les différentes facettes de cette réalité.
Les auteurs
Lukas Aubin est spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. Jean-Baptiste Guégan est expert en géopolitique du sport. Ensemble, ils ont signé en 2022 « Atlas géopolitique du sport ». L’ouvrage est structuré en trois parties : la sportocratie, le sport un instrument de puissance et la nouvelle guerre du sport. Chacune est composée de plusieurs chapitres.
La dimension géopolitique du sport
Etats, entreprises, associations, athlètes de haut niveau, tous veulent s’emparer du sport parce qu’il est un instrument de puissance. Il est une « arme de séduction massive ». Illustration d’un monde bipolaire durant la guerre froide, le sport offre désormais la vision d’un monde multipolaire et fragmenté. « Vitrine de la vitalité des nations » selon les mots de l’historien du sport Pierre Arnaud, le sport c’est aussi « la guerre, les fusils en moins » comme le dit George Orwell. Le sport, c’est plus que du soft power, c’est une dimension clé des nouvelles formes de conflits.
Les prémices de la sportocratisation du monde
Dès le début du XXème siècle, le sport est caractérisé par cette contradiction entre la volonté de faire la paix et son usage comme instrument de puissance. Jusqu’en 1920, les participants aux Jeux olympiques sont composés principalement d’un cercle restreint d’une trentaine de pays majoritairement occidentaux. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’organisation du sport mondial est tiraillée par les idéologies. Le communisme soviétique le répudie, le fascisme européen l’exploite et l’impérialisme libéral vante un universalisme à plusieurs vitesses.
La guerre froide du sport
Le sport est alors un des terrains privilégiés de l’affrontement entre les deux Grands. Il traduit l’opposition de deux modèles. Les auteurs montrent aussi que Fidel Castro a utilisé le base-ball pour promouvoir la révolution cubaine et sa réussite à l’extérieur de Cuba. Par ailleurs, douze nations africaines participent aux Jeux d’été de 1960 et elles sont trente en 1972. Les années 80 sont marquées par les boycotts. Après la chute de l’URSS, le sport devient dans l’espace post-soviétique un moyen d’affirmer son identité.
Un nouvel ordre mondial du sport
Les auteurs continuent de dérouler la chronologie et insistent sur l’émergence de la Chine. Les Jeux de Pékin voient pour la première fois depuis soixante-douze ans un autre pays que la Russie ou les Etats-Unis s’approprier la première place au classement des médailles et c’est la Chine qui accomplit cet exploit. Aujourd’hui, le sport représente 2 % du PIB mondial. La sportocratie est donc un système-monde globalisé et globalisant constitué de réseaux qui parcourent la planète et structurent le sport mondial. Les partenaires et acteurs privés sont les véritables financeurs du sport mondial.
L’arsenalisation du sport
Habilement manié, le soft power par le sport permet d’améliorer la réputation d’un Etat, de faire des affaires ou d’exister sur la carte. Les auteurs reviennent sur le fait que le sport n’échappe pas aux jeux de pouvoir. La structure hiérarchique du sport repose sur le concept d’Etat-nation. Tous les membres du CIO sont liés à des intérêts politiques. Les évènements sportifs peuvent être des moments clés pour structurer une identité nationale.
Le pouvoir par le corps et le corps du pouvoir
Il a fallu attendre l’après Seconde Guerre mondiale pour que les personnes en situation de handicap puissent être considérées par le sport. Quatre-vingt-dix ans après la mort de Coubertin, on ne peut que constater que le sport est partout. Sa religion a conquis la planète. Le sport professionnel transcende les frontières nationales pour devenir une industrie à l’échelle globale. Lors des Jeux de Rio en 2016, 23 des 39 membres de la délégation qatarie étaient nés en dehors de l’émirat. Le pays n’a rien inventé en ce domaine. Le livre évoque aussi le cas de Nadia Comaneci et de ses performances inédites à l’époque.
L’ours et le lynx : l’affrontement entre la Russie et l’Ukraine sur le front sportif
Le mouvement sportif mondial est le premier à s’être mobilisé pour sanctionner le pouvoir russe. On sait peut-être moins que 200 athlètes russes de haut niveau ont entamé des procédures pour changer de nationalité entre le 24 février 2022 et le 1er janvier 2024. L’Ukraine continue de participer activement aux évènements sportifs.
L’aigle et le dragon : une rivalité constante entre les Etats-Unis et la Chine
Dès les années 50, la Chine saisit rapidement l’importance de la reconnaissance du CIO et de la participation chinoise aux Jeux. En 1984, le pays se hisse à la quatrième place du classement des médailles. En face, les Etats-Unis sont la première nation olympique et sportive de l’histoire avec un total de 2963 médailles remportées depuis 1896. Au départ, tout avait bien commencé entre la Chine et les Etats-Unis : c’était au temps de la diplomatie du ping-pong. Les deux pays partagent un sport en commun à savoir le basketball.
Les nouveaux pôles de puissance : vers une désoccidentalisation du sport mondial
En 2002, l’Asie fait une entrée fracassante sur la scène sportive internationale par l’intermédiaire du Mondial de football attribué par la Fifa à la Corée du Sud. Depuis les années 2000, l’Amérique latine fait également une entrée remarquable et remarquée dans le monde du sport mondial avec notamment la victoire du Brésil en football en 2002. Les Etats du golfe arabo-persique veulent s’affirmer comme de futurs acteurs majeurs du sport. Sans le sport international et le football, personne ne saurait positionner le Qatar sur un globe terrestre. Pour les Saoudiens, le sport est devenu une industrie d’Etat, une stratégie géopolitique. L’Inde de son côté cherche à s’ouvrir aux sports mondialisés. Le livre passe aussi en revue la stratégie de la Corée du Sud, de l’Indonésie ou encore de la Turquie.
Nouveaux enjeux et nouveaux conflits du sport
La guerre des récits ne date pas d’aujourd’hui mais elle a retrouvé une nouvelle intensité avec le sport. De manière générale, depuis la fin de la guerre froide, les boycotts totaux n’existent pratiquement plus. Parmi les autres questions qui se posent, il y a celles du dopage ou encore du sexisme. La proportion de sport féminin diffusée sur les chaînes françaises reste inférieure à 5 % des diffusions sportives en 2021. La question du genre s’est également imposée. On peut aussi relever un certain greenwashing dans le sport.
En conclusion, les auteurs rappellent que l’Europe de l’Ouest n’a plus son avantage passé et l’Asie s’impose un peu plus chaque jour. Le sport se fait avant-scène des relations internationales. La désoccidentalisation du sport touche la gouvernance du sport et ses instances, ses moyens d’action autant que ses récits. Il faut aussi penser un sport durable. Le livre propose donc un tour d’horizon très complet du sport et de sa dimension géopolitique. L’ouvrage pourra être utilisé avec profit en spécialité HGGSP.