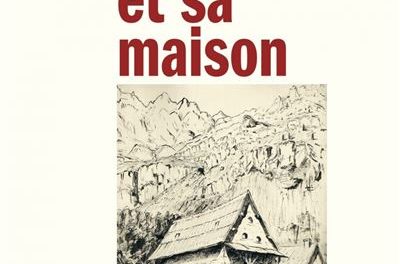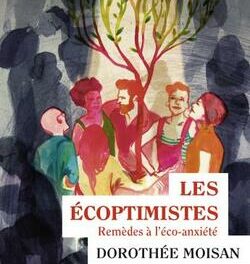La mondialisation racontée à ma fille est un ouvrage de vulgarisation qui dépasse la description stricto sensu de la mondialisation pour nous rappeler quelques grands mécanismes économiques. Il est extrêmement solide et une partie de son sel vient d’allusions à l’histoire ou à la politique. C’est un livre à utiliser pour expliquer le monde et pouvoir donner des exemples simples et éprouvés.

L’auteur
André Fourçans est professeur d’économie à l’ESSEC. Docteur d’État en Sciences Économiques à Paris, en Business Administration aux États-Unis et titulaire d’un MBA de l’Université de l’Illinois, il a participé à de nombreux organismes économiques et politiques français, européens et américains.
C’est donc un économiste libéral à la fois universitaire et ayant une connaissance directe de la mondialisation qui a entrepris une oeuvre de vulgarisation : cette deuxième édition « entièrement refondue » prolonge le succès de L’économie racontée à ma fille (deux éditions également) et fait notamment suite à Effet de serre : le grand mensonge ? Le Seuil, 2002.
La mondialisation est l’évolution normale de l’économie et c’est son interruption de 1914 à 1945 qui est l’exception ; l’ouverture 19e siècle n’a été retrouvée que dans les années 1990 ; elle s’accélère maintenant du fait des technologies de l’information. Nous sommes devant un processus continu qui va se poursuivre malgré quelques éventuels spasmes chinois ou islamistes. Et cette mondialisation est largement américaine. Faut-il le regretter alors qu’on a reproché aux États-Unis leur isolationnisme politique et économique dans les années 1920-1930 ? Les succès du Japon et de la Corée du Sud lors de la deuxième moitié du 20e siècle leur doivent d’ailleurs beaucoup.
Le libre-échange va donc s’accentuer pour le plus grand bien général, avec bien sûr des exceptions douloureuses. Mais il vaut beaucoup mieux gérer ces dernières plutôt que d’interrompre le processus. Par ailleurs, les avantages comparatifs de chaque pays évoluant très rapidement, les spécialisations d’aujourd’hui, comme le glissement vers la Chine de l’industrie mondiale, ne seront pas forcément celles de demain.
L’auteur s’attaque ensuite au mythe de l’omnipotence des multinationales. General Motors et ses consoeurs sont loin de diriger le monde. Leur pouvoir est d’abord limité par la concurrence et il revient aux États d’y veiller. A ces deux acteurs s’ajoutent les institutions internationales, dont l’OMC qui a su montrer son indépendance, et maintenant les ONG. Ces quatre lieux de pouvoir s’influencent mutuellement.
Dans ce contexte, l’Union Européenne ne peut qu’évoluer vers toujours plus d’ouverture, et non vers une Europe forteresse. Quant à l’Europe politique, éventuelle puissance mondiale, son avènement suppose résolus tant de problèmes politiques, financiers et conceptuels que ce n’est pas pour demain.
La partie qui débute par le chapitre « Jusqu’où réguler la mondialisation ? » commence par épingler le foisonnement d’anathèmes anti-mondialistes proférés par une bonne part de l’intelligentsia française. Pourquoi tant de haine ? D’abord la mondialisation bouleverse les habitudes et les repères traditionnels. Ensuite, il y a une opposition idéologique au libre-échange, dont l’auteur rappelle qu’il est séculairement à l’origine du progrès général. Le limiter en exigeant le respect des « normes sociales et environnementales » est dénoncé par le Sud comme un protectionnisme inavoué pour le maintenir dans la misère. Les dites « normes » se diffusent de toute façon ne serait-ce que par la pression de l’opinion publique du Nord relayée par les actionnaires des multinationales : les « cruelles » entreprises du Nord ont un actionnariat beaucoup plus scrupuleux que celles du Sud. Certains scrupules ont même été appliqués trop rapidement puisqu’ils ont renvoyé à la prostitution des enfants que leurs sous-traitants n’avaient plus le droit d’embaucher. Il aurait fallu offrir une alternative aux parents, comme la scolarisation à temps partiel ou un système de bourses.
Quant à la mondialisation culturelle, vilipendée comme « marchandisant » la culture, elle doit être regardée de plus près. L’industrie du divertissement est assez éloignée de la culture avec un grand « C ». Cette industrie trouve son inspiration dans le monde entier, plus qu’en Amérique (les sources de Disney sont en général européennes). A côté des géants, le national, voire le local, prospèrent également, tous deux bénéficiant du système technique et commercial. On peut regretter que l’analyse de ce passage reste surtout économique et n’aborde pas les questions de langue, de plus en plus sensibles chez les non anglophones.
La mondialisation est accusée de peser sur les salaires des moins qualifiés, mais ces derniers ne sont pas si nombreux au Nord, et il vaut mieux les aider que de paralyser un processus qui fait ailleurs cent fois plus d’heureux. Il n’est d’ailleurs pas certain que la mondialisation soit coupable : de toute façon la tertiarisation de l’économie avantage les qualifiés au détriment des autres. Et la crainte des délocalisations est très exagérée, car les bas salaires de tel pays sont compensés par d’autres coûts (insécurité, corruption…) ; d’ailleurs, les entreprises du Sud s’installent de plus en plus au Nord malgré les salaires élevés. Finalement, l’incidence de la mondialisation sur l’emploi est de même nature que celle du progrès technique dont elle n’est qu’un accélérateur : les anciens métiers disparaissent partout au bénéfice de nouveaux. Cette accélération est bien sûr porteuse d’insécurité, mais ne menace pas, au contraire, le nombre mondial d’emplois.
Quant à la pauvreté au Sud, elle est en diminution du fait de la forte amélioration du niveau de vie de quelques centaines de millions de Chinois, d’Indiens et de bien d’autres. L’Afrique reste à la traîne, du fait des guerres et de l’incompétence des gouvernements plus que de la mondialisation, dont elle s’est d’ailleurs exclue. D’où l’échec de l’aide au développement dont des études fines montrent qu’elle n’a bénéficié qu’aux pays bien gérés… donc à ceux qui en auraient pu s’en passer. Une autre cause de la pauvreté du Sud est la non ouverture des marchés du Nord mais aussi de ceux des autres pays du Sud. Ce n’est donc pas la mondialisation qui est en cause, mais son contraire. Le montant des marchés perdus de ce fait au Nord par le Sud serait d’après l’ONU 14 fois supérieur au montant total de l’aide.
L’environnement s’est considérablement amélioré au Nord où les déchets solides et liquides sont beaucoup plus limités ou mieux traités que dans les années 1950 à 1990. Bien sûr, ce n’est pas le cas au Sud. De toute façon, le développement économique apporté par la mondialisation devrait avoir le même effet sur l’environnement qu’au Nord : une fois les besoins vitaux satisfaits, on y fera attention.
La mondialisation est aussi démographique, avec le vieillissement des sociétés au Nord, puis au Sud. Lorsque tout le monde en aura mesuré les conséquences, le retard de l’âge de la retraite paraîtra la solution la moins pénible. Au passage, remarquons que l’auteur tombe dans la même erreur que beaucoup de financiers en pensant que « la capitalisation n’est pas liée à la démographie », car qui produira, achètera et distribuera des intérêts ou des dividendes s’il n’y a plus d’adultes ? Ce vieillissement mène à « l’irrésistible poussée migratoire », consubstantielle à toute mondialisation : celle d’avant 1914 avait vu les Européens se répandre dans le monde entier. On pourrait toutefois noter que cette « poussée » vient autant de l’échec des pays de départ que de la mondialisation.
Ce livre dépasse la description stricto sensu de la mondialisation pour nous rappeler quelques grands mécanismes économiques. Son style est volontairement simple, ses raisonnements fort clairs et appuyés par de nombreux exemples. Les lecteurs habitués à la « conceptualisation » et à l’anti-libéralisme ne seront pas dans leur élément. Il serait néanmoins dommage qu’ils le négligent, car il est extrêmement solide et une partie de son sel vient d’allusions à l’histoire ou à la politique : « ma fille », pour l’apprécier pleinement, devrait avoir une culture de vieux chroniqueur du Monde ou du Figaro.
Donc un livre à lire si l’on veut vraiment comprendre le monde et pouvoir donner des exemples simples et solides.