Si les mythologies grecque, nordique ou japonaise nous sont connues, ce n’est pas le cas de la mythologie coréenne, et c’est à ce titre que l’ouvrage de Laurent Quisefit consacré à cette dernière vient combler une lacune, au moment où la vague hallyu permet au public occidental de se familiariser avec la culture coréenne. Si les séries TV, les manhwas et la K-pop ont su se frayer un chemin jusqu’à nous, ce n’est, jusqu’à présent, pas vraiment le cas des mythes et des légendes coréennes, contrairement à ceux originaires du Japon qui ont imprégné la culture manga qui, ainsi, a su les exporter.
Laurent Quisefit nous propose donc de la découvrir et, autant le dire d’emblée, elle ne ressemble en rien ou du moins très peu aux mythologies classiques, les dieux restant au fond assez discrets.
Titulaire d’un doctorat en études de l’Extrême-Orient, chercheur associé à l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon (EHESS, INALCO, Université Paris-Cité), Laurent Quisefit a étudié le coréen à l’École des langues orientales (INALCO). Il a enseigné la civilisation de la Corée dans plusieurs universités françaises et a publié de nombreux articles et contributions sur l’histoire et la civilisation de la Corée, en France comme à l’étranger. Ses travaux portent sur l’anthropologie, l’histoire médiévale, les relations franco-coréennes ou encore le mouvement d’indépendance coréen.
Loin de nous proposer de simples récits mythologiques, l’auteur nous les livre en les remettant en perspective, en opérant un classement en trois parties destiné à nous les rendre plus accessibles et en les comparant à l’aide de tableaux synthétiques. Une bibliographie, un lexique, une chronologie et quelques arbres généalogiques aident le lecteur peu familiarisé avec les mythes coréens.
Des mythes transcrits tardivement
En Corée, le terme de mythe a été traduit par le mot probablement tardif de shinhwa et nous est parvenu par deux chemins : les traditions écrites et réécrites, avec comme ouvrages centraux le Samguk yusa, ou Histoire mémorable des trois royaumes rédigée au XIIIᵉ siècle, et les transmissions orales assurées par les chamanes (mudang), elles-mêmes transcrites très tardivement par les ethnologues au cours du XXᵉ siècle et qui témoignent des variantes existantes d’un endroit à l’autre d’un même récit. Cette tradition orale est d’autant plus précieuse que, durant l’Antiquité, le bouddhisme et le confucianisme reléguèrent le chamanisme dans les campagnes où il parvient à se maintenir tant bien que mal. Aujourd’hui, pourtant, c’est le mythe de Tan’gun, récit fondateur du peuple coréen, qui tient la première place, comme en attestent les festivités organisées chaque année le 3 octobre en Corée du Sud.
En première partie, l’auteur débute de manière classique avec les cosmogonies et anthropogonies, pour lesquelles durant longtemps ona cru que la Corée n’en possédait pas. C’est donc naturellement que le premier récit proposé est le Ch’angsega (ou chant de la création). Il met en avant le rôle du Bouddha du futur, Miruk, et les origines et le rôle joués par l’eau et le feu :
Quand le Ciel et la Terre sont apparus, Miruk est né.
le Ciel et la Terre n’étaient pas séparés.
Mais collés l’un à l’autre […]
Puis logiquement viennent la séparation du Ciel et de la Terre (Ch’onji kaebyok), retranscrite en 1937, l’apparition du soleil, de la Lune et des étoiles, dont le récit est repris des travaux de l’anthropologue Son Chin-t’ae réalisés dans les années 20 et qui met en scène une mère, ses enfants et un tigre. Les autres récits s’intéressent aux sept étoiles composant la Grande Ourse, mais aussi au thème du Déluge, universel, et pour lequel la Corée possède également sa propre version. Enfin, vient la naissance du peuple coréen et le mythe de Tan’gun, fils de Ungnyo la femme-ourse et de Hwan’ung issu du monde des dieux, donc du monde céleste. Ce mythe est assez proche de certaines traditions sibériennes et de la mythologie tibéto-mongole avec l’épopée du roi Geser et met en avant le principe de bienveillance divine envers l’humanité.
Des dieux, des œufs, des dragons, des hommes
Activités humaines, dieux et esprits, les mythes de l’île de Cheju-do sont présentés avec, en tête, l’histoire des trois clans de Cheju-do qui met en avant les origines mythologiques des liens noués entre la péninsule coréenne et le Japon. Le messager du monde inférieur relate l’histoire de Kang’im, messager de la mort et guide des âmes. Lui succèdent dans cette sélection l’histoire de la princesse Pari, celle d’un pêcheur avalé par une baleine ou encore celle très populaire du lapin et du Roi-Dragon.
Dans une deuxième partie, l’auteur se concentre sur les fondations dynastiques et relate les origines magiques ou divines des premiers États coréens et de leurs familles régnantes. Les œufs jouent un rôle central, comme en attestent les origines mythiques du royaume de Shilla associé à un œuf violet d’où sortit un petit garçon, futur fondateur du royaume, auquel le nom de Pak Hyokkose fut donné. Et si, comme le précise l’auteur, les mythes coréens n’ont pas d’équivalent à Hercule ou Thésée, une exception demeure avec Ko Chumong, héros d’origine divine forcé de s’exiler.
La troisième partie est centrée quant à elle sur les mythes royaux du Koryo (918-1392) dont le but est de légitimer la dynastie du même nom. Au total, sept récits commentés sont proposés au lecteur, récits où le merveilleux, les dieux et les déesses interviennent ainsi que des tigres, comme l’atteste le récit consacré au fiancé de la sanshin.
Assurément, les amateurs de mythologies trouveront avec cet ouvrage une excellente initiation littéraire et scientifique aux légendes coréennes.

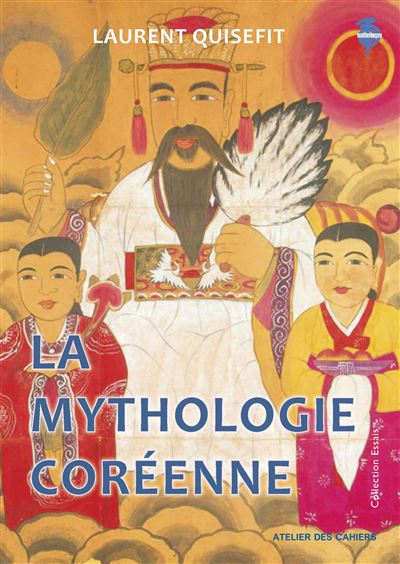
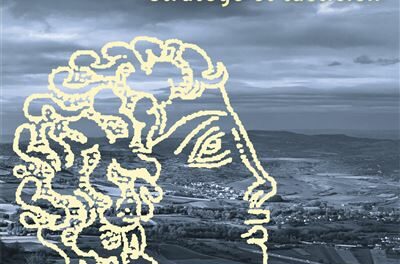
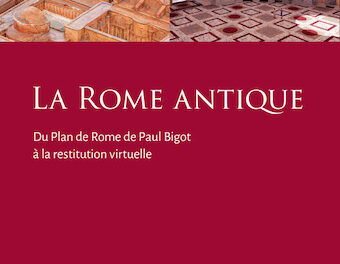
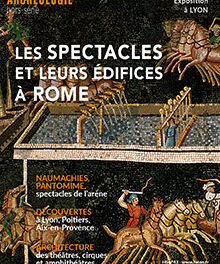
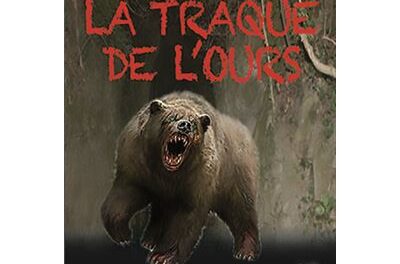








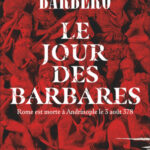
Un très bel ouvrage pour faire connaître les mythes coréens à un public francophone.