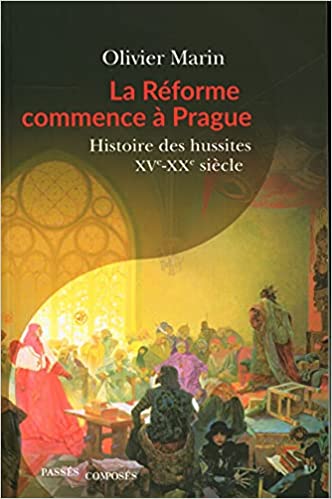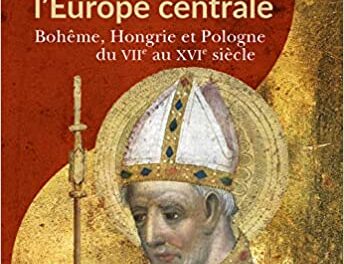En 1430, Jeanne d’Arc, confinée par le roi Charles VII au château de Sully-sur-Loire, se fend d’une lettre dans laquelle elle s’en prend aux Bohêmes qu’elle rêve d’écraser tant ils souillent, selon elle, « les sacrements de l’Eglise ». Ces Bohêmes sont aujourd’hui plus connus sous le nom de hussites Au départ, il s’agit d’un terme injurieux forgés par certains polémistes hostiles à Jean Hus et ses partisans., un terme qui dérive d’un certain Jean Hus, autrement dit Jean de Husinec, le village de Bohême du Sud qui le vit naître dans le dernier tiers du XIVè siècle. Devenu prêtre au terme de ses études à Prague, il se fait remarquer pour ses prêches, en tchèque. Mais le personnage réputé, et soutenu au début par l’archevêque et par le roi, devient sulfureux, à un point tel que le pape va jusqu’à l’excommunier en 1411.
Jean Hus, martyr
Convoqué au concile de Constance Il se tient de 1414 à 1418, dans le but de régler le « Grand Schisme » qui divise la Chrétienté latine depuis 1378., Hus s’y rend, malgré les réticences de son comparse Jérôme de Prague. Ses partisans retiennent leur souffle, se demandant à quelle sauce ses juges vont l’accommoder. il est principalement reproché à Jean Hus ses critiques à l’égard de la papauté, et en général de toute idée de hiérarchie ecclésiastique, et de vouloir donner le calice aux laïcs En fait, l’initiative en revenait au théologien Jakoubek de Stribro., coutume progressivement tombée en désuétude en Occident. Resté inflexible face aux accusations (dont celles du Français Jean Gerson), il est donc condamné au bûcher en 1415 et ses cendres sont par la suite dispersées dans le Rhin, de manière à éviter la constitution d’un culte en sa faveur.
Olivier Marin Maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris-XIII, il a notamment publié L’Archevêque, le maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur pragois (années 1380-1419), Paris, Honoré Champion, 2005 et Les Traités anti-hussites du dominicain Nicolas Jacquier, Paris, Institut d’études augustiniennes, 2012. fait des hussites et de leur foi l’objet central de son nouveau livre. Eux se qualifiaient de « fidèles », fidèles à l’Eglise des origines et au message véhiculé par Jean Hus Ses thèses prennent notamment appui sur la variante néotestamentaire de la Bible et sur certains écrits du réformateur anglais John Wyclif que Hus a beaucoup lu. Il se réfère au modèle de l’Eglise primitive et considère que tout chrétien digne de ce nom doit inlassablement prêcher et être prêt au sacrifice de sa vie.. Plus tardivement, on les appela « utraquistes » (ils communiaient sub utraque, autrement dit sous les espèces eucharistiques du pain et du vin, alors que partout ailleurs les laïcs ne communiaient plus qu’à l’hostie) ou « calixtins » (ils ont adopté le calice comme symbole unificateur de ce qui est rapidement apparu comme une dissidence, « hérésie » diront d’autres…).
De la « Réforme » à la « Révolution »
Quand en 1417 l’université de Prague se prononce ouvertement pour la communion sous les deux espèces, le concile voit rouge mais se montre impuissant à étouffer la dynamique :
« Presque sans coup férir, une nouvelle Eglise concurrente, dotée d’une solide assise territoriale et gouvernée conjointement par la haute noblesse et l’université, était en train de naître sous ses yeux en Bohême. » (p. 127)
La « réforme » hussienne Il est toujours délicat de dresser une généalogie des influences, en l’occurrence de celles qui ont contribué à forger le répertoire doctrinal hussien. On se reportera à cet égard au chapitre 3, Le problème des origines, pp. 69-87. bascule bientôt, en se radicalisant, dans ce qui devient, aux yeux d’Olivier Marin, une « révolution hussite » ou « hussitisme », autrement dit un composé puisant à la fois aux références hussiennes classiques et aux thèses d’un certain Mathias de JanovConfesseur et prédicateur à la cathédrale Saint-Guy à Prague, il a rédigé les Règles de l’Ancien et du Nouveau Testament dans lesquelles puise abondamment Jakoubek de Stribro, l’inventeur de l’utraquisme, selon lequel le chrétien doit revenir aux sources de l’Eucharistie, et avoir, par conséquent, accès le plus possible à l’autel. Il souhaite également la destruction des madones vénérées par le peuple. Si l’on y ajoute la haine de l’institution monastique, et en particulier des Mendiants. Olivier Marin fait remarquer que l’écrasante majorité des clercs devenus hussites sont des séculiers, qui ont eu à pâtir de la concurrence des Mendiants sur le plan pastoral, et la détestation de Rome (la seule autorité légitime à laquelle obéir étant le ChristOn remarquera toutefois que l’Eglise utraquiste tient notamment à ce que ses prêtres soient ordonnés par des évêques en communion avec le pape…), on aura une idée des principales orientations de ce mouvement appelé à prospérer dans une grande partie de la Bohême.
Prague, 30 juillet 1419 : la première des « défenestrations de Prague » Les autres ont lieu en 1483, 1618 et 1948. lance la « révolution hussite ». Depuis le premier étage de l’hôtel de ville, les échevins sont défenestrés par des hussites enflammés par le prédicateur Jan Zelivsky : « Tout le temps du massacre, Zelivsky encouragea les assaillants en brandissant l’eucharistie » (p. 133). Une « révolution » qui plonge la couronne de Bohême dans une longue guerre, entre 1419 et 1436. Il ne peut bien entendu être question, dans le cadre de cette recension, de pénétrer dans le maquis des événements qui scandent ces années de troubles extrêmes : l’auteur en maîtrise parfaitement le déroulé et les enjeux. Mais la lecture des chapitres qui y sont consacrés donne quelque peu le tournis et si l’auteur est comme un poisson dans l’eau, le lecteur, lui, manque parfois de se noyer…
Disons, pour simplifier, que la guerre provoque la vacance prolongée du trône de Bohême et de l’archevêché de Prague et amène le pape à lancer des croisades anti-hussites, qui se terminent toutes, pour ainsi dire, par un fiasco. Par ailleurs, le mouvement hussite se divise durablement, grosso modo en deux tendances : une variante radicale, connue sous le nom de « taborites » Ils prennent leur nom du mont Tabor, c’est-à-dire de la colline de Burkovak en Bohême du Sud, symbole de la vocation utopique des montagnes saintes. , et une « variante magistérielle » (p. 128), expression que l’auteur préfère largement à « modérée ». Les hussites les plus radicaux se commettent en destructions d’églises et mettent un point d’honneur à ruiner les couvents et monastères « de fond en comble » (p. 42).
« A partir de 1427, la révolution entre dans sa période conquérante » (p. 177), ce qui amène les participants au concile de Bâle, au début des années 1430, à tenter d’amadouer les hussites les moins radicaux : ainsi, en 1433, les légats dépêchés en Bohême promettent le calice à tous ceux qui y communient déjà, sous réserve de leur obéissance à Rome. En 1436, dans la ville catholique de Jihlava, à la frontière entre la Bohême et la Moravie, la réconciliation entre hussites tempérés et catholiques romains est scellée par un compromis promulgué en latin, tchèque, hongrois et allemand : les Compactata. C’est, pour Olivier Marin, le signe, pour l’essentiel, de la victoire de la « Réforme » hussite.
« Les hussites ne devaient plus être traités d’hérétiques, mais considérés comme partie intégrante de l’Eglise. Sur les Quatre Articles de Prague Autrement dit, le programme d’action des Hussites forgé au début du conflit qui, en particulier, supprimait toute espèce de contrôle épiscopal ou pontifical sur les prédicateurs et imposait l’utraquisme., seul celui qui concernait la punition des péchés publics fut relégué dans les oubliettes de l’histoire. L’utraquisme était légalisé, et la communion sous une seule espèce tolérée seulement dans les enclaves catholiques. La reconnaissance de la libre prédication de la parole de Dieu impliquait une forme de pluralisme religieux. Les ambassadeurs bâlois durent même avaler la couleuvre de l’abolition de la domination ecclésiastique. Les changements sociopolitiques consécutifs à la révolution étaient ainsi entérinés. » (p. 198)
Lendemains de guerre
Quant au roi Sigismond de Luxembourg, il fait son entrée à Prague en août 1437. Le retour du roi cache cependant l’affaiblissement de la monarchie au profit des diètes locales. Mais, surtout, la guerre a essorébaisse de 40% de la population, désorganisation de l’économie et du commerce et divisé profondément le royaume : en effet, la dynamique hussite, dans ses dimensions religieuse et guerrière, a fragilisé la Couronne de Bohême Aussi appelée Couronne de Saint-Venceslas., entendue comme l’ « ensemble hétéroclite de territoires qui ont été progressivement associés au royaume de Bohême, selon des modalités auxquelles Charles IV de Luxembourg a donné une forme juridique contraignante en 1348 » (p. 28). Le hussitisme a remporté ses succès les plus spectaculaires dans le royaume de Bohême Au début des années 1430, le mouvement domine même près des trois-quarts du territoire : Prague et son arrière-pays, la Bohême du Sud et surtout la Bohême orientale, où habitent des populations essentiellement de langue tchèque, ce qui a pu conduire, parfois abusivement, à mettre en équivalence les termes « hussite » et « tchèque ».. En revanche, en Moravie le contraste est frappant entre les villes, réfractaires (comme Brno, restée fidèle au catholicisme), et les campagnes, où le hussitisme a progressé. Quant à la Silésie et aux Lusaces, le hussitisme y a été rejeté de façon quasi-unanime.
Les lendemains de guerre sont emplis d’incertitudes et de reculs : en 1458, Georges de Podebrady, l’homme fort du pays depuis 1448 et, qui plus est, hussite tempéré, devient roi de Bohême grâce à l’appui des catholiques (dont il a épousé l’une des leurs). Il aspire à la réconciliation entre hussites (à l’exclusion des radicaux) et catholiques. Las, la guerre est rallumée lorsque la papauté juge les Compactata comme nuls et non avenus (1462) et déchoit Georges de Podebrady du trône de Bohême (1466). Après la mort de ce dernier en 1471, il faut attendre la paix de Kutna Hora (1485) pour que les Compactata soient rétablis et érigés en loi du royaume, avec une avancée : les fidèles ont désormais le droit, sans y être forcés par personne, de communier sous une seule ou sous les deux espèces. Olivier Marin est formel : « Il n’est pas exagéré de considérer le texte comme la première paix de religion que l’Europe ait connue » (p. 216). Pour autant, la papauté n’a pas avalisé l’accord, Prague est censée rester exclusivement hussite et les hussites radicaux jugent le texte schismatique !
Vers la marginalisation
Paradoxalement, alors que l’Eglise utraquiste a désormais pignon sur rue, elle voit fondre l’effectif de ses prêtres : comme le siège épiscopal de Prague est toujours vacant, il est compliqué d’ordonner les prêtres, sauf à faire venir en Bohême des évêques en délicatesse avec Rome qui se chargeraient de la tâche ; mais surtout, du fait de la sécularisation des biens ecclésiastiques, les prêtres utraquistes, vivant bien plus modestement qu’autrefois, sont « souvent réduits à errer avec leurs maigres bagages de paroisse en paroisse » (p. 220). La situation est donc devenue désastreuse dans les campagnes, qualifiées de « déserts pastoraux ». Dès lors, contrairement à ce qui s’observe ailleurs en Europe, on assiste à une augmentation de l’analphabétisme religieux dans les campagnes de Bohême et une montée des « superstitions ». Un comble !
Au XVIe siècle, la situation ne s’arrange pas : le pape Pie V refuse en 1568 toute nouvelle ordination de prêtres utraquistes. Le hussitisme connaît en outre un processus continu de marginalisation dans le contexte de lutte entre Réforme luthérienne (avec lequel les hussites s’étaient, un temps, trouvé quelques points de convergence) et Contre-Réforme catholique. Au lendemain de la bataille de la Montagne Blanche (1620), la situation devient critique : la fête du « martyr » Jean Hus est célébrée une dernière fois le 6 juillet 1621 et Rome suspend la possibilité pour les laïcs de communier au calice. Nobles et bourgeois n’ont donc plus le choix qu’entre la conversion (au catholicisme) ou l’exil. C’est cette dernière option que choisit Jean Komensky, plus connu sous le nom de Comenius, ultime évêque de l’Unité des Frères, dernier avatar du hussitisme radical. La répression bat donc son plein : dès lors, « la peur, la lassitude, l’intérêt, la conviction se conjuguèrent pour faire adhérer les ultimes disciples de Jean Hus à l’universalisme tridentin » (p. 248). Si bien qu’au XVIIIe siècle, on n’entend plus parler de hussitisme… jusqu’à son exhumation par certains tenants du mouvement national tchèque au XIXe siècle.
Résurgences ou chant du cygne ?
Mais c’est Thomas Masaryk qui mobilise le plus ouvertement et le plus régulièrement les symboles du hussitisme : déclaration, depuis Genève, de son opposition à la monarchie des Habsbourg le 6 juillet 1915 (500e anniversaire de la mort de Jean Hus) ; adoption, à la naissance de la République de Tchécoslovaquie (28 octobre 1918), de la devise « La vérité vaincra », directement inspirée de Jean Hus ; déclaration du 6 juillet comme fête nationale tchécoslovaque, au grand dam de l’Eglise catholique ! Si les « valeurs » hussites sont inscrites dans le préambule de la nouvelle Constitution de 1948, rédigée après le « coup de Prague », « avec le temps, la société finit par se lasser de l’omniprésence de la mémoire hussite dans l’espace public » (p. 262). Ce n’est donc pas un hasard si, en novembre 1989, la « révolution de Velours » se noue autour de la statue équestre de saint Venceslas et non auprès du monument dédié à Jean Hus… Dès lors, la mémoire hussite n’a cessé de refluer dans les pays tchèques. Rares sont aujourd’hui ceux qui continuent de lire Jean Hus. Néanmoins, il se pourrait, nous dit Olivier Marin, que sur « le plan politique, l’émergence des populismes, la montée du sentiment anti-européen et/ou anti-élites créent un appel d’air favorable à l’exhumation de la référence hussite » (p. 268).
« Pré-réforme » ou « Réforme » ?
Il ne nous appartient pas de juger si « la Réforme » a commencé, ou pas, à Prague. Les spécialistes sauront apprécier comme il convient les (solides) arguments de l’auteur récusant pour l’aventure hussite les qualificatifs de « pré-réforme », d’ « hérésie » ou de « schisme ». Laissons-lui plutôt le dernier mot :
« Le hussitisme n’a pas été une simple pré-réforme avortée, comme on le répète encore paresseusement. […] pour ne pas être protestant, le hussitisme n’en relève pas moins, au même titre que l’anglicanisme, de la Réformation. […] le hussitisme fonctionna comme un incubateur, dans la mesure où il cristallisa des idées réformatrices dispersées et les fit passer presque aussitôt au stade de la réalisation. Mieux : sous l’appellation d’un événement unique, ce sont en réalité deux Réformes qui ont alors vu le jour sur le sol tchèque. Avec l’utraquisme naquit une Réforme magistérielle, d’orientation sacramentelle, à base nationale et socialement conformiste. Tabor, puis l’Unité des Frères, frayèrent en revanche la voie à une Réforme radicale, car subversive, apocalyptique et prosélyte, en même temps que plus réceptive aux séductions théocratiques. La compétition entre ces deux variantes de la Réforme n’a pas cessé de rejouer jusqu’à nos jours. » (pp. 270-271)