« La Retirada » : Une BD historique au contenu original et émotionnel
Cet ouvrage, considéré et classé dans la catégorie des BD, est composé en fait de nombreux dessins de Josep Bartoli. Ce dernier partira au Mexique après la deuxième Guerre mondiale où il deviendra l’ami de l’artiste-peintre mexicaine Frida Kahlo (1907-1954), avant de s’installer aux USA pour finalement y mourir en 1995, à 85 ans à New-York.
La Retirade de 1939, l’exode des républicains espagnols vaincus, est symbolisée par ces combattants parqués dans le camp d’Argelès à leur arrivée en France. Josep Bartoli, témoin et acteur de ce drame en tant que commissaire politique du POUM, raconte par des dessins que l’on trouve dans les rubriques « Dessins de guerre » (p. 19-38) et « Cahier des camps » (p. 67-115), commentés par Georges Bartoli (neveu du dessinateur). Josep Bartoli croque au jour le jour la vie de ses compagnons d’infortune. Il nous donne à voir avec une centaine de dessins, d’une force émotionnelle époustouflante, le spectacle dantesque de ces gens entassés dans des baraquements, prisonniers dans un pays (la France) qui a refusé d’aider la République espagnole contre la dictature de Franco, donnant au lecteur de quoi désespérer et de quoi s’indigner.
En contrepoint, le photographe Georges Bartoli, neveu de Josep Bartoli, nous donne à voir un reportage photographique de son cru intitulé « Le raid de la mémoire » (p. 127-148) et nous livre, pour les 70 ans de la Retirada, son témoignage ainsi que d’autres enfants de la Retirada sur la dure condition des exilés espagnols jusqu’à la fin du franquisme, interrogé par la journaliste Laurence Garcia : « Les enfants de la Retirada et de la République » (p. 149-159).
Cette BD est également constituée de textes : une « note liminaire » (p. 7-9) explique le terme espagnol « Retirada » ; une biographie de Joseph Bartoli (1910-1995) (p. 10-18) ; Georges Bartoli, écrit les 2 textes suivants : « Les camps du mépris : Voyage au bout de la plage » (p. 39-48) et « L’exil en héritage » (p. 49-66) ; quant à Laurence Garcia, elle fait le récit de « La légende familiale : Josep, Salvador et Georges » (p. 117-126).
La Retirada dans l’histoire de la Guerre civile d’Espagne
La Retirada, du mot « retraite » en espagnol, est l’exode des réfugiés espagnols de la guerre civile. Dès le début de 1938, l’armée française anticipe la chute des Républicains et un exode éventuel. Elle estime les besoins d’hébergement à 5000 personnes pour la 17e région militaire de Toulouse et 10.000 pour la 16e région militaire de Montpellier. Des plans sont réalisés pour répartir les réfugiés entre Matemale, Le Canet (capacité illimitée), Argelès-sur-Mer (capacité d’accueil de 3000 personnes), Saint-Cyprien (capacité illimitée). Mais les travaux n’avaient pas commencé en janvier 1939, à l’arrivée des premiers réfugiés malgré la demande, mi-janvier, du gouvernement républicain espagnol au gouvernement français d’accueillir 150.000 réfugiés civils.
Les premiers réfugiés arrivent à la fin de décembre 1938 et au début de janvier 1939. La France met en place un dispositif d’empêchement. Mais la chute du front de Catalogne et la prise de Barcelone par les phalangistes, le 26 janvier 1939, entraînent la débâcle des forces républicaines et le début de l’exode massif. Les républicains sont vaincus, après trois ans de guerre civile qui a ensanglanté toute l’Espagne. Civils, militaires fuient vers la frontière pour se réfugier en France.
Devant l’arrivée de près d’un demi-million de personnes, les autorités françaises choisissent de concentrer les réfugiés près de la frontière pour éviter qu’ils ne se dispersent et pouvoir ainsi les contrôler. Dans un premier temps, devant l’afflux de militaires et de civils vers la frontière française, le gouvernement issu du Front populaire propose à Franco d’organiser une zone neutre entre Andorre et Port-Bou. Le dictateur espagnol refuse, considérant les fuyards comme des prisonniers de guerre. La frontière est alors ouverte le 27 janvier 1939 par le gouvernement français, afin de permettre aux premiers réfugiés civils d’entrer en France afin d’échapper à la répression phalangiste (35.000 exécutions), pendant que les derniers combattants républicains espagnols continuent la lutte jusqu’au début du mois de février où sonne l’heure de la « Retirada », la Retraite.
Filtrage à l’entrée
Cette ouverture n’est, dans un premier temps, concédée qu’aux civils, les gardes mobiles françaises et le 24e régiment de tirailleurs sénégalais faisant le tri, repoussant même les hommes valides, par la force au besoin. Lors de l’entrée sur le territoire français, les réfugiés sont dépouillés de tout : armes, mais aussi bijoux, argent liquide, etc. Mais, dès le 28 janvier 1939, le dispositif de filtrage est converti en dispositif d’accueil. Le 2 février 1939, 45.000 Espagnols sont déjà arrivés en France.
À partir du 5 février 1939, le gouvernement français décide de laisser entrer ce qui reste de l’armée républicaine qui est autorisée à franchir la frontière : ce sont 250.000 combattants qui s’ajoutent aux 250 000 premiers réfugiés. Des familles sont séparées. Pour les hommes, le gouvernement français ouvre des camps d’internement sur les plages à Argelès et à Saint Cyprien, notamment. Ces camps sont barbelés, la surveillance est assurée par des tirailleurs sénégalais et des gardes mobiles.
Les présidents Juan Negrín (gouvernement), Manuel Azaña (République), Martínez Barrio (Parlement), Lluís Companys (generalitat de Catalogne) et José Aguirre (celle du Pays basque) franchissent la frontière dès ce jour, avec le trésor catalan. Les derniers contingents à passer la frontière, et parmi eux, la division Durruti qui est enfermée à Mont-Louis, arrivent en bon ordre. Ils gardent même avec eux leurs prisonniers. A nouveau, la frontière est fermée à partir du 9 février 1939 par le gouvernement français. Contrairement aux craintes de ce dernier, l’exode se passe sans incidents notables. La route de Mollo reste cependant ouverte encore jusqu’au 13 février 1939.
Début 1939, les autorités estiment le nombre de réfugiés à environ 500.000 ou plus, dont un tiers de femmes, enfants et vieillards. Sur ce total, 330 000 sont hébergés dans l’urgence dans les Pyrénées-Orientales, et plus de 130 000 sont évacués dans les départements des deux tiers sud de la France. À partir de février 1939, ce sont plus de 450.000 républicains qui franchissent la frontière franco-espagnole suite à la chute de la Seconde République espagnole et à la victoire du général Franco. Les autorités françaises ont sous-estimé l’ampleur de l’exode.
En mars 1939, ce sont 264.000 Espagnols qui se serrent dans les camps des Pyrénées-Orientales quand la population départementale s’élève à moins de 240.000 personnes (On trouve parfois la francisation Retirade).
Ces réfugiés sont majoritairement originaires du nord-est de l’Espagne : Catalogne (à 36, 5 %), Aragon (18 %), Levant espagnol (14,1 %). La France est complètement débordée par ce drame humanitaire. Elle désarme, trie, tente d’appréhender les problèmes sanitaires, au cœur d’un hiver particulièrement rude. L’essentiel étant de garder la main sur les réfugiés espagnols (Les « Rouges »), six régiments d’infanterie, quatre de cavalerie plus des éléments organiques sont mobilisés. En mars 1939, 264.000 Espagnols se serrent dans les camps du Roussillon, quand la population départementale s’élève à moins de 240.000 personnes. En avril 1939, 43.000 réfugiés sont encore retenus à Argelès-sur-Mer, 70.000 au Barcarès, 30.000 à Saint-Cyprien soit, au total, 143.000 réfugiés républicains espagnols. Il faut attendre le début du printemps 1939 pour voir des camps être créés à la périphérie des Pyrénées-Orientales, notamment à Agde et Bram.
« La Retirada » et sa postérité en France
La retirada a constitué un apport humain et culturel aux Pyrénées-Orientales. Une fraction importante de cette population espagnole et catalane choisira d’y rester ou y reviendra après avoir été dispersée, à la sortie des camps. Au fil du temps et du travail des générations, au poids démographique s’ajouteront un poids économique et un poids culturel très concret. Ainsi se développent en Pyrénées-Orientales, la sardane et la corrida, la paella et le flamenco.


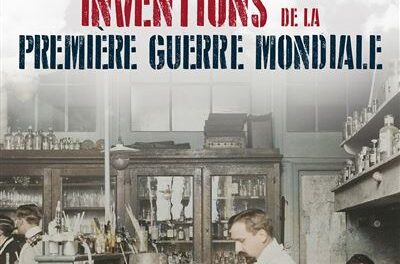
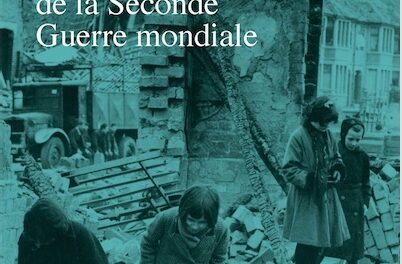








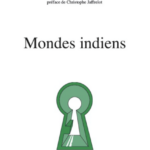

Ce qui me surprend toujours au sujet de la « retirada », c’est que l’on oublie le rôle joué par l’entente Franco-Pétain, deux militaires qui se connaissaient au moins depuis la guerre du Rif (1925) . En 1939 étain était ambassadeur de France à Madrid, lorsqu’il fut « appelé », et le 12 février 1941 à Montpellier, au retour de l’entrevue Franco-Mussolini les deux hommes tractèrent directement : quelles en sont les traces historiques ?
ll y a fort à penser que si cette tractation évita certainement à la France de se retrouver « prise en écharpe » entre deux ennemis, et probablement de se trouver amputée du département des P.O., elle ne se fit pas sans contrepartie: outre la restitution de l’or espagnol rentré en France par les communistes espagnols qui espéraient poursuivre la lutte (celui en tous cas que l’état français avait pu récupérer) , et les « camions de la « retirada », quels furent les conseils prodigués en vue d’inciter les « réfugiés » à avoir « envie de rentrer chez eux » Qui ho sap???