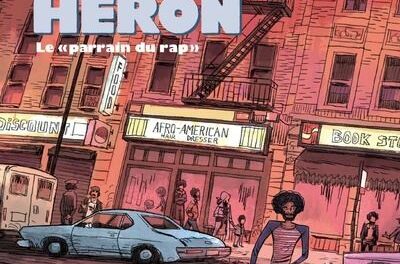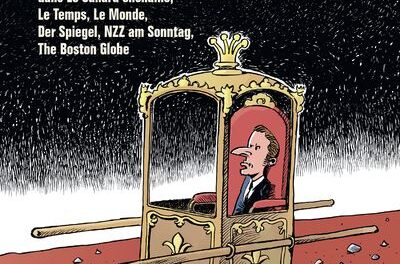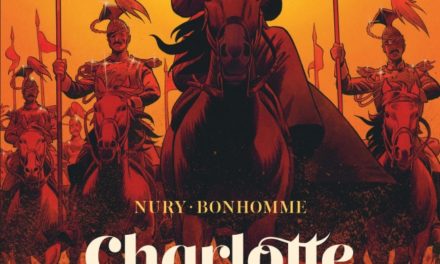Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine rwandaise, passe de la fiction (Tous tes enfants dispersés, Consolée, Ejo) au témoignage pour raconter enfin son histoire qui est aussi celle d’un sauvetage d’enfants tutsi par des humanitaires.
Quatre photos
Le livre débute par la narration de ce cheminement, qui est d’abord une recherche personnelle. Sortie de Rwanda avec sa mère à bord d’un convoi de l’ONG Terres des hommes, elle recherche des images de ce convoi. Elle entre en contact avec l’équipe de la BBC qui a filmé des images, récupère quatre photos qu’elle étudie soigneusement. Elle y devine l’endroit où elle était cachée avec sa mère. Elle met en parallèle ces traces infimes avec des images de la Shoah, notamment les photographies prises par les Sonderkommandos à Auschwitz. Elle s’intéresse aussi aux sauvetages d’enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à ceux organisés par Nicholas Winton. Cela fait germer une interrogation et un espoir : une liste de noms existe-elle pour son convoi ? Elle espère pouvoir partager ces photos avec d’autres rescapés. C’est une manière de se réapproprier son histoire, la quête passera d’abord par la littérature, elle intervient dans ce cadre auprès de classes, mais en tant qu’écrivain dans un premier temps.
Le temps du témoignage
Beata Umubyeyi Mairesse raconte ensuite le début du génocide, les caches successives, les informations qu’elle entend, les premiers morts qu’elle voit. A l’attente et à la peur, succède l’irruption des Interahamwe dans la chambre d’hôtel où elle est réfugiée avec sa mère et une autre tutsi et son réflexe de survie. Scolarisée à l’école belge, elle fait mine de ne pas comprendre le kinyarwanda et répond en français. Cela les sauve temporairement, un militaire revient pour la violer, mais elle emploie le même stratagème. C’est l’occasion d’évoquer les euphémismes employés pour qualifier les viols : « On lui a fait des choses de mauvais homme »‘, « se faire marier », « kubohoza« , terme proche de libérer, mais qui désigne les viols collectifs. Elle revient aussi sur les témoignages de femmes lors du TPIR d’Arusha, évoquant leur contamination au VIH et leur manque d’accès aux soins. Elle évoque aussi la violence de la stratégie de la défense vis-vis de ces témoins : la réalité des viols est remise en cause car elles n’auraient pas été assez attirantes pour cela après des semaines de traque. Une religieuse, soeur Christine se charge de leur départ et de les protéger d’ici là.
Beata Umubyeyi Mairesse voyage avec sa mère cachée sous des linges, le convoi n’emmène en théorie que des enfants de moins de 12 ans. Ils partent avec l’accord du préfet Sylvain Nsabimana, qui participe au génocide. C’est peut être un moyen de s’assurer une défense par la suite. Le départ du convoi provoque sa destitution. La mère de Beata Umubyeyi Mairesse est mise en joue par un militaire mais un second militaire lui désigne l’équipe de journalistes. Elle prendra conscience plus tard que c’est la présence de la BBC qui a évité l’exécution. Ses souvenirs sont cependant flous. La frontière passée, un comité d’accueil les attend, avec des rescapés déjà évacués. Elles attendent deux semaines au Burundi, avant le départ pour la France. La soeur de Christine et son mari deviennent leur famille d’accueil. Le récit de Fergal Keane, journaliste à la BBC, complète celui de Beata Umubyeyi Mairesse.
Terre des hommes
Les souvenirs sur les humanitaires sont flous, ce qui s’explique sans doute par la terreur au moment du départ, mais aussi par le peu de temps passés avec les enfants. Ils étaient basés au Burundi et faisaient des aller-retours, les souvenirs des autres rescapés sont également très flous. Beata Umubyeyi Mairesse trouve des informations sur d’autres sauveteurs, notamment Philippe Gaillard, responsable du CICR et Carl Wilkens, humanitaire américain qui a travaillé pour l’Eglise adventiste. Elle choisit de faire de l’humanitaire, essuie des refus pour des départs au Rwanda et part travailler au Cameroun pour MSF.
Pendant le COVID en 2020, elle contacte l’archiviste de Terres des hommes, elle se heurte à une absence de sources et au principe de protection des données, mais il lui fournit un contact. Ariane Zwalhen était déléguée de l’ONG au Rwanda pendant le génocide. Elle lui raconte le début du génocide et propose de la mettre en relation avec Alexis Briquet, qui avait fait partir le convoi. Il se souvient d’elle et de sa mère, de son sourire. Mourant, il accepte de répondre à ses questions à plusieurs reprises. Elle prend l’initiative de prévenir les autres rescapés qu’elle a pu retrouver.
Après sa mort, elle a l’idée d’écrire son histoire pour lui rendre hommage et culpabilise de ne pas avoir entrepris de démarches plus tôt. Elle se demande pourquoi ne pas avoir commencé par cette piste, mais elle avait peu de souvenirs de ses sauveteurs. Elle retrace son travail, évoque une « nécessaire collaboration » avec le gouvernement Hutu pour faire sortir des enfants du pays. Les premiers sauvetages sont racontés, puis le premier convoi. Face au refus du CICR de passer la frontière, Alexis Briquet s’appuie sur un prêtre franciscain, qui leur fournit des véhicules. Ils doivent composer avec les génocidaires pour agir et acceptent d’évacuer aussi les enfants de tueurs. Les miliciens essaient d’arrêter le convoi. Des adultes tutsi, blessés, sont parvenus à se réfugier dans les camions, sont renvoyés à Butare. Le premier convoi parvient au Burundi le 5 ou le 6 juin 1994, les enfants sont pris en charge à leur arrivée par la Croix-Rouge.
Après ce convoi éprouvant, le CICR et la Croix-Rouge retirent leur soutien à Terre des hommes et l’humanitaire italien qui l’avait accompagne, Pierantonio Costa, renonce. Il sera par la suite umurinzi w’igihango, l’équivalent de Juste parmi les Nations. Il est rejoint par Deanna Cavadini, déléguée de Terre des hommes en Italie, par une journaliste et un photographe. Ils apportent vêtements, médicaments et vivres. Selon Alexis Briquet, le 2e convoi, le 18 juin, celui de Beata Umubyeyi Mairesse, a été le plus facile à organiser. Lors de sa déposition au TPIR, il assure avoir respecté le cadre et n’avoir embarqué que des enfants de moins de 12 ans, passant sous silence la présence de Beata Umubyeyi Mairesse et de sa mère. Un témoignage du préfet y fait cependant référence, elles sont désignées comme Françaises, il aurait joué un rôle pour qu’elles embarquent.
Le convoi du 3 juillet concerne l’évacuation des enfants de Kaduha, les religieuses du couvent y joué un rôle central. Dans le contexte de l’opération Turquoise, il part dans la précipitation, avec un appui des militaires français et permet l’exfiltration de Sylvain Nsabimana et de sa famille. Après le génocide, Terres des hommes fait partie des 44 ONG expulsées du Rwanda par le nouveau régime. Le préfet sera jugé avec notamment Pauline Nyiramasuhuko lors du procès des « Six de Butare ». Les recherches dans les documents du TPIR sont laborieuses, l’accès n’est pas prévu pour les rescapés et les familles des victimes. Elle est aidée par l’historienne Hélène Dumas dans ses recherches.
L’heure de nous mêmes
La dernière partie revient sur les images, essentielle dans la quête de Beata Umubyeyi Mairesse. Quatre photos en sont à l’origine, elle en récupère ensuite environ 150 de Terres des hommes. Ces images ont été prises par des Occidentaux, à destination d’autres Occidentaux. Par le biais de Deanna Cavadini, également compagne d’Alexis Briquet, elle entre en contact avec le photographe Mauro Parmesani. Il comprend la démarche de l’écrivaine : se réapproprier ces images.
Récupérer ses images est le fruit de longues démarches, souvent infructueuses. Se pose une question face aux attitudes variables des photographes : « Est-ce que ces photos nous appartiennent ? ». Lors du début du génocide, seuls une dizaines d’envoyés spéciaux couvrent l’événement. Pour circuler, les journalistes se glissent principalement dans les convois d’évacuation. Les commentaires et les légendes de ces images n’analysent pas les causes, ne donnent pas les profils des victimes. La narration se contente d’évoquer une haine ancienne entre Hutu et Tutsi, un conflit où tout le monde se tue, ce que résume le terme « génocide rwandais »‘. Avec la fin des rapatriements, les reporters ont majoritairement quitté le pays à l’exception des photographes Luc Delahaye et Patrick Robert. Ils photographient un charnier sur la colline de Nyanza-Kicukiro, mais les médias français refusent de les publier. Les journaux américains et allemands les diffusent. Dans les rushes, la parole des victimes est présente, elle est systématiquement coupée à la diffusion. Soit les victimes sont identifiées comme rwandaises sans précision, si elles sont présentées comme Tutsi, les images sont accompagnés d’un commentaire mentionnant une participation des Tutsi aux massacres. Elle s’appuie sur les travaux de Nathan Réra, qui fait le lien entre ce traitement médiatique et le rôle de la France dans le génocide.
Ces contre-sens demeurent : lors de l’exposition « L’ombre de la guerre » de la MEP à Paris en 2011, deux photographies illustrent la guerre civile : une photographie de Sebastiao Salgado d’un camp de réfugiés Hutu et la photographie de James Nachtwey d’un Hutu démocrate attaqué à la machette par des Hutu pour avoir refusé de participer au génocide. Sur le site du photographe, il est présenté comme « un survivant de camps de la mort hutu ». L’équipe accompagnant Terre des hommes insiste sur les sentiments des humanitaires mais ne précise ni l’identité des tueurs ni celle des enfants. Le travail précis de Fergal Keane (BBC) est une exception.
L’ouvrage constitue un témoignage intéressant car il explore les hésitations, les difficultés à témoigner, le temps nécessaire à se réapproprier son histoire. Fruit d’une enquête minutieuse, il laisse une large part aux rencontres qui ont émaillé ces quinze ans de travail et de réflexion et aux liens entre les génocides. Les portraits des rescapés du convoi entrecoupent le récit de l’écrivaine et enrichissent son témoignage. Le convoi pose aussi des questions intéressantes sur le traitement des conflits par l’image et sur la contextualisation dans les médias, en particulier lorsqu’il s’agit d’un pays éloigné et sur les enjeux de mémoire.