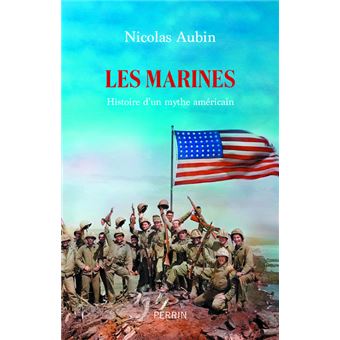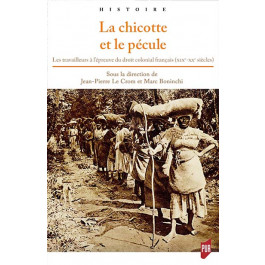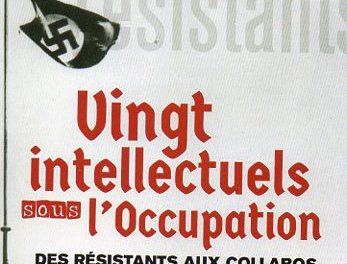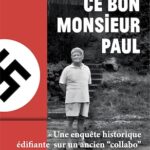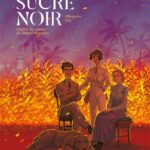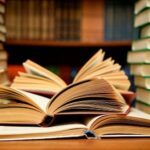Un livre remarquablement informé, tout à fait passionnant et sans équivalent. 4ème de couverture. »
« Nés à l’aube de la guerre d’indépendance il y a plus de 2 siècles, les Marines ont été de toutes les guerres américaines, avec pour apothéose, en 1945, cette levée des couleurs au sommet du mont Suribachi d’Iwo Jima, devenu l’icône de l’Amérique, triomphante. Pourtant, en France, personne ne connaît leur histoire avant 1918, et la bataille du bois de Belleau, personne ne sait que ce corps a d’abord été méprisé et menacé de dissolution, avant de devenir une organisation d’élite et la seule unité militaire dont l’existence et garantie par un texte de loi voté en 1947.
À la confluence de l’histoire militaire, de celle des organisations et des mentalités, le présent ouvrage passe au tamis la légende pour proposer la première histoire globale des Marines. Il brosse le portrait d’un corps devenu une source d’inspiration inépuisable pour les producteurs de l’industrie du divertissement et un modèle – ou repoussoir – pour des générations d’adolescents. Il révèle enfin comment les Marine ont construit leur légende au point d’être aujourd’hui, unanimement perçu – y compris par eux-mêmes – comme l’incarnation du mythe américain par excellence.
Professeur agrégé d’histoire, Nicolas Aubin collabore au magazine Guerres & Histoire. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont, chez Perrin, l’Infographie de la Seconde Guerre Mondiale avec Jean Lopez, Vincent, Bernard et Nicolas Guillerat.
L’auteur analyse de façon détaillée les différentes étapes de l’histoire des Marines de leur fondation à notre époque. Pour ce compte-rendu en direction des enseignants d’histoire-géographie, il nous importera au delà de quelques repères chronologiques clés, de comprendre comment un corps militaire aux débuts médiocres a pu être partie prenante de l’histoire de la guerre aux Etats-Unis – victoires et défaites mêlées – et de son érection au statut hollywoodien de légende de la Nation.
Comment cette organisation militaire au départ accessoire a-t-elle pu devenir un mythe patrimonial américain au rayonnement mondial ?
Pour le savoir, il faudra à l’auteur en retracer l’histoire, enfouie sous les strates de récits légendaires. Les deux tiers de l’ouvrage y sont consacrés. Mais pour comprendre le succès du mythe « Marines » dans la société civile, l’histoire ne suffit pas. il faudra pénétrer dans ses pratiques et ses représentations pour en comprendre l’identité.
Démêler mythe, légendes et histoire, grâce à une documentation considérable et de grande qualité
Face à un tel défi, l’auteur a pu disposer d’une documentation considérable. D’abord les archives de l’US Marine Corps, quasiment complètes. Ensuite un service historique, créé en 1919 et régulièrement alimenté, à tel point qu’il est considéré comme le meilleur tenu au sein des forces armées.
À ces documentations primaires s’ajoutent une production considérable d’analyses et de synthèses historiques, stimulées par l’ouverture à la fin du XXe siècle de la Marine Corps University. Avec de nombreux travaux universitaires, non seulement de chercheurs civils, mais également d’officiers reconvertis, ce qui ne surprendra pas pour une organisation si attachée à son histoire, et de grande qualité sur les aspects militaires et organisationnels.
Enfin difficile d’oublier l’ensemble des fictions, écrites, audiovisuelles qui accompagnent comme toujours l’histoire des Etats-Unis. En l’espèce, les jeux vidéo sont devenus en 20 ans un levier incontournable du mythe.
Afin de retracer l’histoire de la fabrication du mythe
La documentation atteste bien des débuts d’un corps hybride, soit des soldats aguerris incorporés aux marins des flottes de guerre. Rien de nouveau historiquement. Depuis l’Antiquité, l’engagement naval se termine en mélèe. À Salamine, en 480 av. J.-C., les 14 Epibates Soldats d’infanterie de marine embarqués sur les navires de guerre pour les combats à l’abordage ou les raids.présents sur chaque galère athénienne taillent en pièces les archers perses.
Qui débute difficilement lors de la guerre d’Indépendance
Nés pendant la guerre d’Indépendance, ces premiers soldats s’attribuent le nom de leurs ennemis britanniques bien présents dans la Royal Navy – comme d’ailleurs dans toutes les flottes européennes du XVIIIe siècle. On notera que le Cardinal de Richelieu ordonne la mise en place d’unités dédiées, les « Compagnies de la mer ». Toutes ces troupes sont rattachées à la marine et non à l’armée de terre.
Si la guerre d’Indépendance a prouvé qu’un détachement de soldats à bord des bateaux de guerre est indispensable, leur contribution à la victoire contre les Anglais est peu probante. La faute à un recrutement aléatoire et à une place au combat mal définie par des chefs de circonstance. Il en sera de même pour la 2nde guerre contre les Britanniques. Les Marines peinent à se faire reconnaître comme des soldats à part entière par les commandants des navires et leur équipage.
Mais dont certains éléments-clé sont déjà en place
Lors des compagnes de courses contre les barbaresques, la prise du fort de Derna en Cyrénaïque (la Libye actuelle) – dont les conséquences seront sans lendemain – devient le symbole du premier engagement victorieux de « soldats de la mer » – en réalité 8 sur 600 – ayant traversé le désert depuis l’Egypte. Derna est en effet l’une des deux seules batailles incluses dans le texte de l’hymne des Marines Corps.
En 1950, sa dimension romanesque fournira la trame du film hollywoodien Tripoli :
C’est bien avec la prétendue prise du « palais de Moctezuma » en 1846 et d’après la version romancée du Commandant des Marines Archibald Henderson que le célèbre « First to Fight » ouvre la première strophe de l’hymne :
Dans le même registre, mobilisés pour réduire une insurrection en Virginie, le 16 octobre 1859, l’histoire des Marines y voit le premier mort officiel de la guerre de Sécession Celle-ci n’éclate en fait que 18 mois plus tard, quand les sudistes bombardent Fort Summer, à l’entrée de Charleston en Virginie., Luke Quinn, honoré comme tel à Quantico (siège actuel de l’US MC).
Le renouveau par la mer : « destinée manifeste, destinée impériale »
C’est finalement du tuteur jaloux, l’US Navy que viendra le renouveau. D’abord parce que les « navalistes » emmenés par le contre-amiral Luce et le théoricien Alfred T. Mahan vont imposer leurs vues. Pour eux, la puissance et la prospérité britannique se sont construites sur leur capacité à protéger leur commerce mondial avec une Royal Navy dominante, ce dont les jeunes Etats-Unis ont profité, avec des intentions commerciales et donc uniquement pacifiques Ironie du destin en ce début d’année 2025, cet avertissement à ne pas se passer d’une force militaire autonome résonne fortement à nos oreilles européennes….
Il est temps pour les Etats-Unis de se doter d’une flotte et de bases Outre-Mer et d’assumer sa destinée impériale.
Sécuriser les voies maritimes
Réflexions géopolitiques – Dossier : buts et moyens de guerre, attrition et politique
https://www.clionautes.org/securiser-les-voies-maritimes.html
La question du devenir d’un corps qui peine à trouver sa légitimité va rester en débat pendant la fin du XIXe siècle. Le défi de l’industrialisation de la Marine entraîne la démocratisation du corps, d’autant que les officiers formés à Annapolis L’académie des officiers de marine, l’équivalent pour la Navy de West Point pour l’Army. ne sont pas tous absorbés par la Navy.
Une transformation à petits pas
La transformation du corps de soldats de la Marine à un corps expéditionnaire passe par des étapes cruciales : les nouveaux officiers issus de l’Académie au départ peu enthousiastes, donneront pourtant – les « Fameux Cinquante » dont seront issus 5 chefs de corps et 13 généraux…
La promotion se fait désormais sur des tests physiques et intellectuels, réduisant peu à peu à la portion congrue l’origine aristocratique de départ.
La création d’un manuel en 1885 faisant office de vade-mecum est suivi d’un recueil de stratégie et de logistique pour officiers l’année suivante.
En 1891 s’ouvre la 1ère école d’application du corps à Washington. Les « Leathernecks » sont désormais prêts à devenir le bras armé des nouvelles ambitions impériales consécutives à la doctrine Monroe qui a pour but l’éviction des Européens d’Amérique latine. Ils vont s’affirmer comme pièce essentielle des mesures de contre-insurrection face aux instabilités mexicaine et caraïbe, transformant au passage la « Destinée Manifeste » en Realpolitik.
La bataille du bois de Belleau, parenthèse française et mythe fondateur (1917-18)
L’entrée des Etats-Unis dans la 1ère guerre mondiale est une nouvelle opportunité à saisir pour ceux qui se présentent comme les “First to Fight”. Mais l’inimitié de l’US Navy et du général Pershing reste grande pour un corps qu’ils continuent à percevoir comme auxiliaire dans le meilleur des cas.
De plus, les militaires américains n’ont pas l’expérience de la terrible guerre moderne qui a pour théâtre le front Ouest. Heureusement, quand les troupes sont opérationnelles, la 3ème et dernière tentative allemande de percer est à bout de souffle, alors que les troupes allemandes sont à 70 km de Paris. Les Marines participent donc au « sauvetage » de la capitale. L’objectif de la prise du bois de Belleau est mal préparée, les soldats US se faisant faucher par les mitrailleuses puis les survivants prenant au corps à corps les positions allemandes avec l’appui décisif de l’artillerie française. Le récit de leurs exploits est relayé par la presse américaine. Mais le prix du sang est sans commune mesure avec les batailles passées : la brigade a perdu 112 officiers et 4 700 hommes. Les 2 régiments sont décorés de la fourragère, une cordelette tressée qui distingue les unités particulièrement méritantes.
Guerres du Pacifique et soft power hollywoodien, le combo qui assoit définitivement le statut « Marines »
La bataille du Bois de Belleau est fondatrice pour l’avenir du corps et sa véritable professionnalisation à venir. D’un côté les valeurs virilistes du combat dans lequel le duel d’homme à homme, le courage, l’emportent sur la conception scientifique prussienne ; de l’autre, la compréhension par les chefs de la nécessité de la préparation d’artillerie et du soutien aérien. Ainsi le Bois de Belleau, entouré de prés à découvert où de nombreux Marines auront laissé leur vie face aux mitrailleuses allemandes, devient la métaphore de l’île entourée d’eau à prendre.
John Lejeune, le patriarche visionnaire
Né en 186 et originaire de Louisiane, John Archer Lejeune https://en.m.wikipedia.org/wiki/John_A._Lejeune est brillamment reçu à l’Académie Navale des Etats-Unis. Promis à une brillante carrière dans la Navy, il choisit à la surprise de ses supérieurs le corps des Marines, dont il devient rapidement le commandant. Il comprend que la guerre moderne a autant besoin de techniciens, de tacticiens bien formés que de guerriers.
Ses héritiers, John Russel, Thomas Holcomb et Holland Smith mettent en place « l’assaut amphibie ». La préparation logistique fait l’objet de la rédaction d’un manuel de 9 chapitres et 240 pages couvrant tout le spectre d’un débarquement et, régulièrement actualisé, restera la bible de l’USMC. L’épreuve du terrain entre 1937 et 1941 donne d’excellents résultats qui convainquent la Navy et les politiques. L’exemple le peut-être le plus emblématique pour nous étant le chalandBarge à fond plat, permettant de glisser sur le sable des plages, avec protection rentrante de l’hélice et rampe basculante à l’avant, ainsi que nous l’avons tous vu dans les films sur le débarquement en Normandie. de Higgins.
Parallèlement le soin apporté à l’esprit de corps l’incite à faire écrire l’histoire du corps et à le mettre en scène. « Il pressent que l’esprit de corps ne s’enracine qu’à condition d’être cultivé au quotidien, par des célébrations, des lieux de mémoire, des dates commémoratives, des héros à honorer, bref, un ensemble de traditions qui forgent une identité, telles que les a mises en évidence l’historien Eric Hobsbawm Sur la différence entre coutumes héritées et traditions inventées, voir Eric Hobsbawm, « Inventer des traditions », Enquête, n°2, 1995, p. 171-189..
Dès les années 20, la rencontre avec les producteurs de cinéma qui grâce à la technique du tournage en extérieur sont demandeurs de grands espaces et d’aventures exotiques. De futurs grands noms s’essaient au genre, Joseph Mankiewicz, Raoul Walsh Franck Capra ou Henry Hathaway. Le grand public identifie désormais aisément le corps des Marines.
Hollywood et la guerre dans le Pacifique font de l’entre-deux-guerres le moment décisif de l’histoire du corps. Celui-ci peut rendre grâce à Lejeune et à ses successeurs.
Les experts du Pacifique
L’autre seconde guerre mondiale (1941-45)
Mis en service dans la guerre du Pacifique, le corps des Marines va s’illustrer sous le commandement général de Mc Arthur en participant à la conquête de Guadalcanal et en tenant en haleine le grand public via les reporters enrôlés dans le corps pour être au plus près des combats. Leurs récits, étayés des noms de leurs camarades combattants, fait le bonheur des journaux locaux, trop heureux de mettre en valeur les boys du coin.
Avec le film “Sands of Iwo Jima” (Allan Dwan, 1949), John Wayne, acteur et héros principal, troque avec succès l’habit de cowboy du Far West contre celui de Marine. Mêmes attitudes, même gouaille, même fraternité virile, même relation aux femmes. Le film est un énorme succès, relayé par une intense propagande des Marines eux-mêmes dans les salles. Des projections gratuites sont organisées avec des concours d’écriture pour les enfants des écoles.
La guerre de Corée (1950-1953)
Rappelés en catastrophe par Mc Arthur qui manque de troupes après l’offensive foudroyante des Nord-Coréens jusqu’au réduit de Busan, les Marines vont montrer une réelle capacité d’innovation notamment aéroterrestre. Ainsi l’idée d’employer des hélicoptères pour transporter rapidement les soldats est testée avec succès en donnant un avantage tactique aux mouvements des troupes. La polyvalence des hélicoptères Sykorky HRS-1 permet d’évacuer rapidement les blessés, de ravitailler en urgence, d’assurer des réglages d’artillerie… la perte de seulement six appareils en 3 ans de conflit impressionne l’US Army qui peut envisager la création de divisions héliportables.
La Panthéonisation
1950. Auréolé de sa gloire militaire et de sa légende, l’USMC obtient en pleine guerre de Corée un siège au Joint Chiefs of Staff (JCS) pour son chef de corps, malgré l’opposition du Président Truman. Mieux, 2 ans plus tard le Douglas/Mansfield Act du 20 juin 1952 sanctuarise par la loi le statut du corps, fait unique dans les armées américaines. L’apothéose a lieu le 10 novembre 1954 avec l’inauguration d’un gigantesque monument de 100 tonnes de bronze, inspiré d’une photographie célèbre, Raising the Flag on Iwo Jima, du photographe de guerre Joe Rosenthal, lauréat du prix Pulitzer.
La fin de l’innocence
La guerre de Corée est-elle gagnée ? Ou plutôt est-elle la première des guerres perdues après 1945 ? Le but de la guerre fut-il la victoire sur le communisme ou son endiguement ? Toujours est-il que l’illusion de la victoire et de l’héroïsme de combattants perpétuant les mythes de la conquête de l’Ouest s’arrête bel et bien avec celle du Vietnam.
L’USMC part au Vietnam sur un malentendu : avec son équipement aéroporté toujours plus moderne, elle envisage participer en accord avec le haut commandement militaire et la Présidence à une nouvelle guerre du Pacifique. C’est mésestimer les liens profonds tissés entre la population Viet-Minh et le FNL, noyauté par les communistes du Nord, contre la corruption généralisée des élites du Sud. Le général du corps, Viktor Krulak, comprenant que l’on est dans une guerre contre-insurrectionnelle favorise la mise en place des CAP (Combined Action Platoons Voir également Michel Goya, « CAP » https://lavoiedelepee.blogspot.com/2020/05/les-combat-action-platoons-une.html qui mettent les Marines dans des villages avec à charge pour eux de gagner la confiance des populations locales en se mélangeant aux Forces Populaires. Mais le président Johnson et le général Westmoreland (en charge de la guerre au Vietnam) s’accommodent sans problème d’une dictature au Sud, l’important pour eux étant de contenir l’expansion communiste en Asie de l’Est. Ils freinent donc les efforts de pacification menés par Krulak, dans une guerre dans laquelle les pires opérations stratégiques auront été prises.
Vague à l’âme
Le retour catastrophique Chacun se souvient des images de l’évacuation chaotique de Saigon et de Phnom Penh, préfigurant l’évacuation tout aussi tragique de Kaboul.au pays en 1975, lié à une guerre mal comprise (contre un pays dont tout le monde ignorait 10 ans plus tôt où il se trouvait sur la carte), confronte l’USMC alors au zénith de ses forces à une défaite qu’il accepte mal, jugeant l’opposition pacifiste intérieur comme les ayant trahis.
Oliver Stone dans « Né un 4 juillet » (1989) relate la difficile réadaptation à la vie civile d’un Marine (magnifique prestation de Tom Cruise) qui devient pacifiste.
La chanson du groupe Buffalo Springfield, utilisée dans le film a été présentée comme un hymne anti-guerre. En fait Stephen Stills l’a écrite en 1966 pour protester contre l’assaut policier qui eut lieu sur le Sunset Boulevard à Los Angeles réprimant des jeunes manifestants se réclamant de la contre-culture. Il n’en reste pas moins que la musique pop / rock de la contre-culture américaine est bien née avec la contestation de la guerre du Vietnam et des valeurs patriotiques traditionnelles.
Stanley Kubrick interrogeait déjà dans Path of Glory (Les sentiers de la gloire) les dilemmes moraux liés à la discipline militaire pendant la guerre de tranchées. Dans Full Métal Jacket, (1987), il montre comment l’endoctrinement annihile tout libre arbitre, poussant un groupe de Marines à abandonner toute humanité. Cet œuvre qui rencontre un énorme succès public rend floue la frontière entre le Bien et le Mal, et distinction essentielle pour le corps, héritier d’un mythe américain désormais mis à mal.
Paradoxalement, le film est aussi plébiscité par des futures recrues du corps – la contre-culture hippie et pacifiste n’aura jamais été majoritaire, en tout cas pas en situation de terrasser le mythe de l’homme viril et moral, d’autant que la 1ère guerre de Golfe donne l’occasion à l’USMC de renouer avec une victoire militaire écrasante.
En fait le mythe est présent dans toute la pop culture : science-fiction avec Aliens de James Cameron (1986) ; jeux de figurines Warhammer, Warhammer, 40,000 avec des troupes de l’Imperium qui sont des Space Marines ; les jeux vidéo ne sont pas en reste : en 1993, le joueur est un Marine de l’espace dans Doom.
Face au nouveau désordre mondial
Le 11 septembre 2001 sonne le début de la fin pour l’hyperpuissance américaine. Pour les Marines, cela signifie le début de la « guerre contre la terreur ». Après la victoire militaire sur Saddam Hussein, les politiques pensent pouvoir instaurer la démocratie avec l’aval des Irakiens ayant subi la dictature féroce du Raïs. En fait la désagrégation du système confessionnel et clanique crée un vide dont s’emparent les islamistes, rejoints par les Sunnites, chassés du jour au lendemain des structures de pouvoir.
L’échec de la stratégie contre-insurrectionnelle
La question contre-insurrectionnelle est de nouveau posée avec force aux Marines. James Mattis, commandant de la 1ère division marine fait lire à ses soldats le Small Wars Manual et leur demande d’échanger avec les vétérans des CAP au Vietnam. Les entraînements se font sur le principe du Three Blocks War de Charles Kublak, fils de Franck. Malgré la clairvoyance de Mattis qui rejette le Nation Building cher à l’élite de Washington en s’alliant avec les cheiks sunnites, la promesse d’une réconciliation Chiites / Sunnites au niveau de l’Etat Irakien échoue une fois les troupes parties vers l’Afghanistan, de nouveau menacé par l’avance talibane.
Une guerre gagnée sur l’idée d’instaurer la démocratie libérale dans une région, le Proche-Orient, dont les néo-conservateurs ignorent l’histoire et les clivages ethno-culturels profonds, a conduit à une paix introuvable et perdue.
Le retour du théâtre Pacifique
Nous savons tous depuis le 1er discours de Barack Obama que l’Asie Pacifique est le nouveau pivot vers lequel l’Amérique se tourne. Qui dit Pacifique dit aujourd’hui pour les Marines le retour des opérations maritimes aéroportées, pratiquées en 42-45 et en Corée. Or dès les années 30 comme le rappelle l’auteur, la menace alors japonaise est pensée par les stratèges du corps, l’idée étant de ménager un corridor de sécurité US jusqu’aux Philippines. Dès 2011, dans la droite ligne des discours d’Obama sur le nécessaire désengagement au Proche-Orient pour se concentrer sur la Chine, le corps répond présent La revue Marine Corps Outlook titre son n° spécial Return to the Sea…. En 2019 le commandant David H. Berger postule que la Chine contestera dès 2030 à la flotte US, non seulement l’entrée dans les mers de Chine mais aussi la circulation dans la partie occidentale du Pacifique Il s’agit de remettre en cause les accords de Montego Bay (1989) sur la libre circulation des navires de toute nationalité dans les eaux internationales, soit hors du périmètre des ZEE (200 milles)..
Mais plusieurs facteurs modifient la donne antérieure : la marine chinoise s’équipe à grande vitesse et rivalise en nombre d’appareils avec la marine US ; la présence de gigantesques métropoles sur les littoraux du sud-ouest du Pacifique impliquera une stratégie de « bulles d’interdiction Benoist Bihan, « Des opérations d’interface. Une approche amphibie des opérations littorales », DSI, n°59, 2010. » que les défenseurs chercheront à défendre dans la profondeur et que les assaillants chercheront à percer. Les Leathernecks s’y préparent, mais comme le conclut Nicolas Aubin, « ils restent historiquement tiraillés entre innovation et tradition, terre et mer, toujours incertains de leur place au sein des branches armées, mais convaincus de leur légende ».
Démythifier
L’histoire de l’USMC – constamment mise en scène – s’est donc confondue avec les mythes fondateurs des Etats-Unis. Comprendre pourquoi le corps reste indissociable du patrimoine national – sans rejet ni hagiographie – sera la dernier temps de ce livre-monument.
Habitus – We make Marines
Ce qui fait de l’USMC une armée à part est bien l’idée mise en pratique que devenir Marine est faire partie d’un entité à part – voire supérieure – de la société : esprit de corps, virilité, courage, sens de la famille, fidélité aux pionniers. Non seulement les Marines incarnent les valeurs de l’American Way of Life, mais ils ont le devoir de les revitaliser quand la société s’en éloigne.
En ce sens, le recrutement est avant tout « blanc, masculin et conservateur », même si la proportion de déclassés sociaux est majoritaire. Il faut dire que le corps à ses débuts, s’il n’offre guère d’aisance financière à la troupe et de promotions pour ses officiers, permet à tout le moins aux classes populaires de trouver un emploi et une raison de vivre le rêve américain. Pas étonnant donc de retrouver des valeurs conservatrices qui excluent les femmes, les noirs et les homosexuels, et qui perdurent bien après l’application de lois « progressistes » que les Marines, de la base au commandement, rejettent.
En fait, l’USMC n’est pas dans son ensemble monolithique. Une enquête interne de 2011 montre que 60% des Marines sont favorables à l’intégration des homosexuels, tandis que la proportion de femmes engagées homosexuelles est d’un tiers. Le problème vient plus des faibles candidatures des minorités en comparaison des autres armes. Effet miroir donc, accentué par les récits légendaires entrés dans la pop culture que les candidats ont intégré avant de franchir la porte du recrutement…
Culte de la violence
La place centrale du DI (Drill Instructor) qu’est le sergent instructeur dans l’histoire du corps consacre la nécessaire catharsis du recrue accédant par l’effort, la solidarité collective, le dépassement de soi au statut de Marine. La réalité, c’est aussi l’hyper-violence d’une (trans)formation qui peut mener jusqu’à la mort de recrues. Les Marines eux-mêmes sont le théâtre d’affrontements racistes entre Blancs et Noirs. Si la formation par la violence a des vertus pédagogiques au combat – ce que soulignent d’anciennes recrues – la violence face à l’ennemi déshumanisé, l’environnement hostile – les jungles tropicales – forment une philosophie de vie évidente. Nicolas Aubin évoque comment la championne franco-américaine de tennis, Mary Pierce fut martyrisée par son père violent, obsédé par la victoire et l’écrasement de ses adversaires sur le cours. Jim Pierce, un ancien Marine…
Il reste à l’auteur à terminer par une rapide comparaison entre la Légion étrangère et l’USMC, deux corps mythiques dont la renommée dépasse largement les frontières de leur pays respectif. L’occasion d’un nouveau livre ?