Spécialiste de l’esclavage et en particulier de la traite Atlantique qu’il étudie depuis plus de 25 ans, Olivier Grenouilleau a publié l’an passé un ouvrage d’histoire globale sur le mouvement abolitionniste.
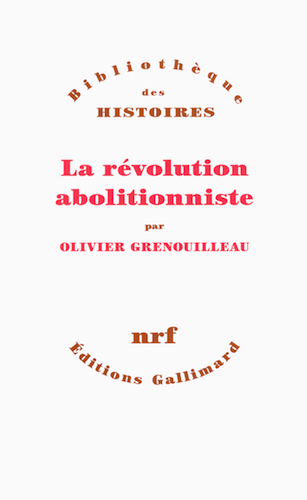
En dépit de l’ambition du projet, il applique à lui-même la modestie indispensable à tout œuvre d’historien. Il propose une synthèse des travaux de la recherche en France, dans le monde anglo-saxon et parfois ailleurs sur le sujet. Il apporte aussi sa pierre à l’édifice, en défendant ses points de vue, sans détour et le plus souvent avec nuance et modération. Il propose enfin des pistes de recherches pour approfondir encore l’étude des multiples facettes de l’abolitionnisme. C’est une réflexion profonde et argumentée qui nous est présentée.
Une histoire globale
Malgré la quantité impressionnante des sources et des travaux sur la question, le défi de l’histoire globale est ici relevé en solitaire. Le risque est alors l’imprécision. J’en ai remarqué une, au sujet de Thomas Clarkson, qui apparaît d’abord comme quaker puis devient plus loin anglican, ce qu’il était effectivement malgré ses importantes amitiés quaker p. 159, 372.. Ce risque est probablement amoindri lorsque l’histoire globale est rédigée par un collectif d’auteurs, comme L’histoire mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron, ou L’histoire du monde au XIXe siècle, sous la direction de Pierre Singaravelou et Sylvain Venayre. Une diversité d’auteurs offre de toute évidence davantage de points de vue, mais aussi potentiellement plus de précisions. Elle permet probablement une réflexion plus ouverte, plus personnelle pour le lecteur. Elle est enfin plus proche d’une réalité nécessairement protéiforme. Cela étant, les ouvrages collectifs constituent des mosaïques qui manquent de la cohérence présente dans le livre d’Olivier Grenouilleau.
Présentation et critique du plan
L’ouvrage s’ouvre sur un Avant-propos intitulé « Une révolution méconnue », puis une introduction évoque l’abolitionnisme « Avant, ailleurs, autrement », afin de mieux situer, au sein de l’histoire globale de la contestation de la traite et de l’esclavage, l’originalité de l’abolitionnisme occidental né fin XVIIIe.
Il est ensuite découpé en trois parties, chacune étant elle-même divisée en deux :
I- L’histoire
1. De la recherche de causes premières à une approche plus compréhensive
2. Voies nationales, dynamiques globales
II- La doctrine
3. Un radical-réformisme à l’ère des révolutions
4. Regards sur la rhétorique abolitionniste
III- L’internationalisme
5. Universalisme des droits de l’homme et intérêts nationaux
6. De l’abolitionnisme à la colonisation ?
Le tout s’achève sur des « Remarques conclusives », 20 pages de références bibliographiques et un index des noms.
Le plan correspond d’une certaine manière aux trois temps identifiés par l’auteur. D’abord celui de la naissance de l’abolitionnisme au sein d’une « République des lettres » déjà internationale, à l’époque des Lumières. Puis celui du développement, de l’approfondissement doctrinal et de l’adaptation de l’abolitionnisme aux circonstances : les révolutions et indépendances qui traversent toute l’Amérique, la révolution française et les guerres napoléoniennes qui ébranlent le vieux continent, les résistances des planteurs et des colons, en particulier dans le Sud des États-Unis où ils ont su eux aussi s’adapter, mais aussi le renouveau du christianisme, principalement dans le monde protestant, et plus profondément la démocratisation et la laïcisation des sociétés. Enfin, le troisième temps est celui de la globalisation de l’abolitionnisme que l’on retrouve aujourd’hui à travers les actions des ONG.
Ce plan est en réalité tout autant chronologique, que géographique et thématique, ce qui conduit à quelques répétitions, notamment entre la deuxième et la cinquième partie, dont les titres sont assez proches. Ainsi peut-on lire : « Avec la révolte de Saint-Domingue, l’image du volcan qui sommeille est remplacée par celle de l’incendie et des massacres de colons. », puis plus loin : « A l’image du volcan qui sommeille, utilisée par des partisans de l’abolition à propos des îles esclavagistes, à la fin du XVIIIe siècle, se substituent celle de la torche et de l’incendie qu’une abondante iconographie contribue à populariser en métropole » p. 155, 381..
Introduction : « Avant, ailleurs, autrement »
L’introduction, longue de plus de 60 pages, est à peu près la seule partie de l’ouvrage qui évoque l’abolitionnisme dans les mondes extra-occidentaux. Olivier Grenouilleau a le mérite de défricher un terrain très peu connu en France. Il remarque l’écart entre l’abondance des sources en Occident et leur rareté ailleurs. Il nous signale ainsi que nous disposons d’assez peu d’informations sur l’Afrique subsaharienne précoloniale -qu’il intègre dans la dénomination désuète de « mondes animistes ». Malgré cela, il affirme que des esclaves « toujours étrangers » y ont mené, « au sein de sociétés étatiques », des révoltes « peu nombreuses » p. 19..
Au sujet des mondes musulmans, l’auteur affirme dès l’abord que « l’esclavage ne peut y être directement « aboli » », en faisant référence à Daech. p. 35. Il est plus nuancé et se montre convaincant par la suite. « La situation est différente en Occident, où, du fait de la laïcisation de l’État, on peut abolir une institution dont l’existence est mentionnée dans les textes sacrés. », écrit-il. Le fait que la Tunisie ait aboli l’esclavage dès 1846, avant la France ou les États-Unis, est rappelé. Et de conclure : « Aussi faut-il se garder de toute tendance à l’essentialisation. « L’esclavage […] ne relevait nullement de données intrinsèques à l’islam » ». p. 37.
Olivier Grenouilleau montre en outre dans l’introduction qu’histoire globale ne signifie pas histoire exhaustive, avouant en l’occurrence n’avoir pas étudié l’abolitionnisme dans le monde indien. Il a finalement concentré une grande part de sa réflexion sur « l’espace géo-historique recouvert par les trois religions monothéistes » p. 20..
1. De la recherche de causes premières à une approche plus compréhensive
Dans la première partie, l’auteur nous montre que l’historiographie a eu tendance à privilégier un facteur plutôt qu’un autre pour expliquer la genèse de l’abolitionnisme. Ce faisant, il s’appuie sur Seymour Drescher pour mieux rejeter la thèse d’Éric Williams qui privilégie le facteur économique. Olivier Grenouilleau est convaincu que l’abolitionnisme a très peu à voir avec « l’essor du salariat » ou « les progrès du libéralisme économique ». Nous y reviendrons. Éric Williams a toutefois eu le mérite d’attirer notre attention « sur le contexte » de l’abolitionnisme, plus que sur ses « héros » p. 107-112, 470..
Les grandes figures de la philanthropie comme Thomas Clarkson ou Victor Schoelcher ont certes joué un rôle important, mais les facteurs culturels sont loin d’être négligeables, notamment le revivalisme religieux, et surtout : « il faut insister sur le rôle joué par d’anciens esclaves au sein même des mouvements abolitionnistes », écrit-il À Saint-Domingue les esclaves se sont libérés eux-mêmes. À Londres dans les années 1780 les Sons of Africa tel Olaudah Equiano ont notamment été reçus à plusieurs reprises au parlement de Westminster. Aux États-Unis le rôle de premier plan des abolitionnistes noirs a été souligné dès 1969 par l’historien Benjamin Quarles, Blacks Abolitionists, Oxford University Press, 1969. Voir aussi H. Adi & M. Sherwood, Pan-African History. Political figures from Africa and the Diaspora since 1787, Londres, Routledge, 2003, p. 54, URL : http://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/hakim_adi_pan-african_history_political_figuresbook4you.org_.pdf. L’auteur plaide finalement à juste titre pour une explication multifactorielle et la recherche des connexions qui peuvent lier les différents facteurs p. 85, p. 201..
2. Voies nationales, dynamiques globales
Dans la deuxième partie est abordée l’histoire du mouvement abolitionniste par aires géographiques. Au sujet des États-Unis, le résumé de 10 pages est orienté autour de la question de l’unité nationale. Le rôle des intellectuels africains-américains dans leur propre libération est alors mis de côté. Les militants noirs sont présents ailleurs dans l’ouvrage, mais finalement trop peu selon moi p. 122, 234, 293, 333. Olivier Grenouilleau n’évoque ni les premières figures de l’abolitionnisme noir tel Prince Hall de Boston ou Absalom Jones de Philadelphie, ni l’important Mouvement des Conventions des personnes de couleur à partir du début des années 1830, et à peine les sociétés et publications abolitionnistes mixtes, regroupant blancs et hommes de couleur. Voir notamment D. Porter ed, Early Negro Writing (1760-1837), Boston, Beacon Press, 1971, p. 6-8, 71, 75, 312, 330. P. Rael, Black Identity & Black Protest in the Antebellum North, Chapell Hill & Londres, The University of North Carolina Press, 2001..
Lorsqu’il en vient à la comparaison des abolitionnismes français et britanniques, Olivier Grenouilleau nous montre qu’avant les années 1780 la France n’est pas en retard, que le mouvement y reste élitiste alors qu’il devient populaire outre-manche, et enfin qu’il est plus philosophique et moral, moins religieux et économique de ce côté-ci de la Manche p. 149-150, 164..
3. Un radical-réformisme à l’ère des révolutions
De la troisième partie découle le titre de l’ouvrage. L’auteur est convaincant lorsqu’il insiste sur l’idée que « le processus abolitionniste […] en France comme ailleurs, était essentiellement réformiste. » p. 215, p. 470. L’abolitionnisme a été un réformisme dans le sens où il a généralement soutenu l’important processus d’indemnisation des planteurs, qu’il a choisi de ne pas s’attaquer directement à l’esclavage mais d’abord à la traite et que ce sont très souvent des plans d’abolition graduelle et non immédiate qui ont été mis en œuvre p. 225.. L’abolitionnisme a été un processus sur la durée, et ainsi il ne faut pas accorder trop d’importance aux dates comme 1794, 1833 ou 1848, qui ne correspondent pas à des ruptures nettes p. 230.. Par ailleurs, les abolitionnistes ne sont ni de gauche, ni de droite nous dit Olivier Grenouilleau, ils étaient « libéraux-conservateurs » p. 213-214. Je précise que le Royaume-Uni n’a pas connu de révolution aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles. C’est progressivement que les droits démocratiques et un commerce plus moral y ont été établis. Et c’est ce pays qui a été le principal moteur de l’abolitionnisme globalisé.. Mais alors pourquoi ce titre : La révolution abolitionniste ? Il est sûr que : Le réformisme abolitionniste aurait été moins accrocheur. Et cette phrase de la quatrième de couverture : « L’auteur montre que ce caractère profondément révolutionnaire et largement méconnu du projet abolitionniste se conjuguait avec un réformisme de l’action » ne résume pas convenablement selon moi le contenu de cette troisième partie, dans laquelle il est question de « radical-réformisme ». Il me semble même finalement que l’abolitionnisme, certes apparu à l’ère des révolutions, a été peu révolutionnaire, y compris dans son « caractère ».
4. Regards sur la rhétorique abolitionniste
5. Universalisme des droits de l’homme et intérêts nationaux
Les quatrième et cinquième parties mettent en œuvre de manière très éclairante une démarche plus compréhensive. Les arguments des abolitionnistes et de leurs adversaires sont analysés avec finesse. C’est l’impératif moral qui est demeuré le principal argument abolitionniste : « L’esclavage abrutit et corrompt tous ceux qui y sont impliqués, maîtres comme esclaves. » p. 307. Les arguments de nature économique ont été également indispensables pour convaincre le plus grand nombre. Il s’agissait de défendre une production coloniale et un commerce maritime sans esclaves ni traite face au spectre de la ruine agité par les défenseurs de l’esclavage p. 286.. Les abolitionnistes devaient ainsi bien s’informer et présenter des faits précis, chiffres à l’appui, rapporter aussi les expérimentations de travail libre pour mieux contrer l’argumentaire des esclavagistes. Les premiers défendaient notamment « le juste », des « valeurs présentées comme à la fois désintéressées et universelles », les seconds faisaient passer les abolitionnistes pour de doux rêveurs ignorant les réalités du terrain colonial, voire des traitres à la patrie, en particulier au moment de l’insurrection de Saint-Domingue p. 87, 282, 288-291..
Au Royaume-Uni, la doctrine abolitionniste a pris corps lorsque s’est affirmée l’idée d’une indispensable rédemption. Dans le cadre du revivalisme religieux, le sentiment de la faute -liée au système esclavagiste mais certainement aussi à la difficile lutte pour l’indépendance qu’ont dû mené les colons d’Amérique-, doublé d’une « tradition libertaire » séculaire, a conduit de nombreux Britanniques à défendre une cause humanitaire respectable, pour l’honneur, le salut et la vertu p. 365, 466..
6. De l’abolitionnisme à la colonisation ?
Enfin la sixième partie soulève la question capitale des rapports entre abolitionnisme et seconde colonisation. Olivier Grenouilleau a le mérite de ne pas avoir de « réticence à parler de questions assez peu glorieuses pour notre pays ». Il pose aussi le problème très clairement. L’abolitionnisme est pris entre deux légendes, écrit-il, l’une dorée qui en fait une forme de philanthropie désintéressée, l’autre sombre qui insiste sur son hypocrisie et sur son rôle moteur en faveur de la colonisation en Afrique et en Asie à la fin du XIXe p. 210. La légende sombre est développée notamment dans le livre de Françoise Vergès, Abolir l’esclavage : une utopie coloniale, Paris, Albin Michel, 2001,p. 209 : « L’abolitionnisme fut certes un mouvement de progrès. Et pourtant il amorçait un colonialisme républicain […] Réglementer, codifier, redéfinir, changer, moderniser, tel est la programme abolitionniste qui se fait complice de l’empire colonial tout en critiquant ses excès. ». La légende sombre est selon moi bien plus proche de la réalité, mais l’auteur la critique longuement et se montre parfois convaincant. Au fil des pages, sa démonstration révèle des liens étroits entre abolitionnisme et seconde colonisation, mais il en conclut qu’il a été davantage un alibi qu’un moteur de la colonisation p. 351, 450..
Les abolitionnistes auraient exagéré le rôle de l’Europe dans les fléaux qui ont frappé l’Afrique p. 288.. Thomas Clarkson et d’autres ont effectivement présenté les négriers comme la figure du mal. Mais l’interprétation que fait l’auteur des propos de Clarkson est contestable : il me semble que ce dernier n’affirme pas que l’esclavage en Afrique est le seul fait des Européens. Les abolitionnistes n’étaient pas complètement aveuglés par leurs valeurs et leurs croyances, ce que les défenseurs de l’esclavage aimaient à faire penser. Ils savaient sans doute que la traite et l’esclavage affectant le continent africain ne se réduisaient pas à la traite européenne p. 404..
Aussi, Olivier Grenouilleau exagère probablement le caractère mythique de l’Afrique des abolitionnistes, où selon eux, « à l’instar de sa végétation, tout ne serait que naturelle luxuriance » p. 407.. Ils ne la pensaient certainement pas comme un jardin d’Éden. Ils connaissaient probablement des personnages comme le souverain du Mali Mansa Moussa, célèbre pour avoir distribué de l’or à profusion sur la route du pèlerinage à La Mecque en 1324. La réalité est que le continent africain dispose de ressources considérables que les puissances coloniales se sont empressées d’exploiter : oléagineux, or, diamant, caoutchouc…
C’est ici que les facteurs économiques méritent d’être invoqués, sans pour autant forcément revenir à Éric Williams dont le travail est déjà ancien. L’essor du capitalisme industriel a coïncidé avec celui de l’abolitionnisme. Au cours du XIXe siècle, la science a progressivement levé les obstacles empêchant la conquête coloniale de l’intérieur de l’Afrique. Par exemple l’usage de la quinine contre le paludisme s’est généralisé à partir des années 1860. Le chemin de fer et la navigation à vapeur ont rendu possible le transport de matières lourdes sur terre comme sur mer. A l’intérieur de l’Afrique, l’hostilité de populations touchées par un renouveau du djihad et l’apparition d’États puissants ont finalement simplement retardé la mise en œuvre des projets de colonisation E. M’Bokolo, Afrique noire. Histoire et civilisations, Tome II, Paris, Hatier – Aupelf, 1992, p. 45-90..
L’abolitionnisme est selon moi à l’origine de la notion de mission civilisatrice, qui donne à la seconde vague de colonisation européenne un visage apparemment humain. Les abolitionnistes ont certes toujours voulu éviter la conquête militaire brutale. Mais à réclamer avec autant de force une intervention européenne en Afrique voire en Asie de l’ouest afin d’éradiquer complètement l’esclavage -vers l’Amérique, le monde arabe ou en interne-, ils ont rejoint les intérêts des États et des entreprises privées qui recherchaient notamment des débouchés.
Condorcet voulait déjà transformer des « comptoirs de brigands » en « colonies de citoyens » qui répandraient les idées des Lumières. Thomas Fowell Buxton appelait pour sa part à la « protection des naturels », et, s’il se défendait clairement de cacher ou de vouloir entraîner « un plan de conquête », il appelait ailleurs à une « grande et sainte croisade ». Au delà des ambiguïtés du discours, on discerne bien une volonté d’imposer une vision du monde ainsi que les prémices d’une ingérence humanitaire p. 410, 423, 424..
Olivier Grenouilleau estime que de vastes projets de domination politique « iraient à l’encontre des principes libéraux ». Autre ambiguïté, celle du libéralisme, à la fois politique et économique, qui trahit une certaine hypocrisie. Le libéralisme économique peut s’accommoder en réalité des situations de domination politique comme la dictature ou l’impérialisme colonial, allant à l’encontre de certains principes libéraux. Laurent-Basile Hautefeuille cité par l’auteur en appelait à la fondation de « vastes colonies agricoles […] en harmonie avec les idées libérales » p. 410, 416..
Était-il possible finalement d’éradiquer l’esclavage et de civiliser l’Afrique à la fin du XIXe siècle sans en passer par la conquête coloniale ? Dans une colonie conquise dès 1830, l’archevêque d’Alger Charles Lavigerie est devenu le champion de l’abolitionnisme globalisé, au nom de la papauté, ainsi qu’un acteur important de la colonisation voire de la christianisation en Afrique. Son action faisait écho à celle plus ancienne de la Church Missionary Society (CMS) en Afrique de l’ouest, dont l’idéologie reposait sur les trois « C » : christianisme, commerce, civilisation La CMS a elle-même formé dans les années 1820 le premier évêque anglican noir, Samuel Ajayi Crowther. Elle a pénétré à l’intérieur du pays yoruba en s’implantant notamment à Abeokuta et a entraîné l’annexion britannique de Lagos en 1861. B. Salvaing, Les missionnaires à la rencontre de l’Afrique au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 35-36, 52..
Olivier Grenouilleau conclut son dernier chapitre en posant cette autre question : « Hier comme aujourd’hui il n’y a pas forcément d’humanitaire « pur ». Est-ce pour autant un motif pour discréditer l’action humanitaire ? » p. 457-458.
Abolitionnisme, racisme et colonisation
La vie quotidienne des Africains, en Afrique et dans la diaspora, s’est-elle significativement améliorée après l’adoption des différents actes d’émancipation au fil du XIXe siècle ? Le travail forcé dans l’Afrique coloniale du XXe siècle, quelles que soient les formes qu’il a pu prendre, semble rappeler dans une large mesure celui des plantations esclavagistes américaines du siècle précédent. Des formes nouvelles de servitude existent également de nos jours. L’abolitionnisme impulsé par l’Occident entre la fin du XVIIIe et le premier XIXe siècle a-t-il véritablement constitué une étape décisive vers un progrès de l’égalité et un recul du racisme au sein de l’humanité ? Je me permets d’en douter.
Accorder la liberté et même l’égalité civile ne signifiait pas que l’on considérait l’autre comme un égal. Olivier Grenouilleau semble le penser pourtant p. 126, 404.. Il écrit que la liberté acquise par les esclaves de l’outre-mer français en 1848 « n’est pas immédiatement synonyme d’égalité » p. 94 (je souligne).. C’est pour le moins un euphémisme. Les esclaves affranchis ont certes obtenu la citoyenneté française et le droit de vote dès 1848. Mais ils n’ont jamais connu par exemple l’égalité de statut entre les territoires de la France métropolitaine et ceux de la France d’outre-mer. Celle-ci date de 1946, soit 98 ans plus tard, autrement dit une éternité. Il est vrai que la départementalisation de l’outre-mer français n’allait pas de soi. Le débat a été long et intense entre les partisans de l’indépendance et ceux qui voulaient comme Césaire rester français sous conditions.
Une faiblesse de l’ouvrage de Grenouilleau est ainsi qu’il manque d’une réelle analyse des liens entre abolitionnisme et racisme p. 205. Je me demande si l' »apogée du racisme scientifique » coïncide vraiment, comme l’écrit l’auteur, avec « les succès de l’abolitionnisme ». Elle s’est plutôt incarnée me semble-t-il dans la science nazie.. On peut affirmer que le racisme à l’encontre des Africains s’est précisément renforcé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une fois les abolitions décrétées, avec notamment le développement des sciences raciales, trahissant le sentiment de supériorité de l’Occident et véhiculant les préjugés racistes. La position d’infériorité des populations affranchies a été prolongée dans la majorité des esprits pour au moins un siècle. C’est au cours des vingt années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale qu’a eu lieu une importante prise de conscience des conséquences souvent terribles engendrées par les préjugés racistes, en Europe comme aux États-Unis.
Il faut par ailleurs selon moi éviter d’opposer les esclavagistes racistes aux abolitionnistes égalitaristes. Le profil du raciste « moral » n’est pas rare. Ainsi au milieu du XIXe siècle les anthropologues Robert Knox ou Franz Pruner-Bey s’opposaient à l’esclavage, une pratique qui n’était pas digne dans leur esprit d’une civilisation européenne supérieure à toutes les autres. Les abolitionnistes étaient tous également convaincus de la supériorité de la civilisation occidentale, le terme de civilisation étant presque toujours utilisé au singulier dans les trois premiers quarts du XIXe siècle. Ils étaient progressistes ou évolutionnistes. Croyant à l’échelle des êtres puis à la hiérarchie des races, ils considéraient que les Africains avaient encore du chemin à parcourir pour s’élever à la véritable civilisation. Ceux-ci étaient encore sauvages ou bien barbares. Beaucoup de nos contemporains -et Olivier Grenouilleau lui-même aussi peut-être p. 34-35, p. 208.– cèdent parfois à cet évolutionnisme, très présent dans les sources étudiées dans cet ouvrage.
Au delà des critiques, de mes divergences sur certains points de vue ou certaines formulations de l’auteur, je recommande cet ouvrage qui constitue une somme passionnante et très utile. C’est le fruit d’une réflexion remarquablement approfondie et d’un travail de synthèse particulièrement ardu mené à bien.













