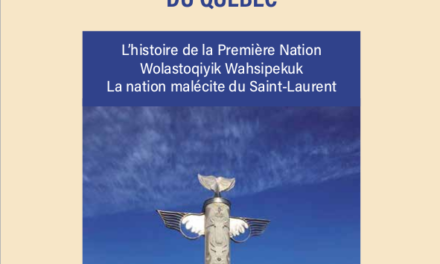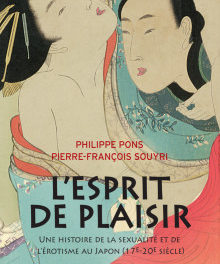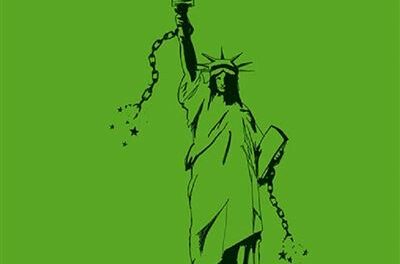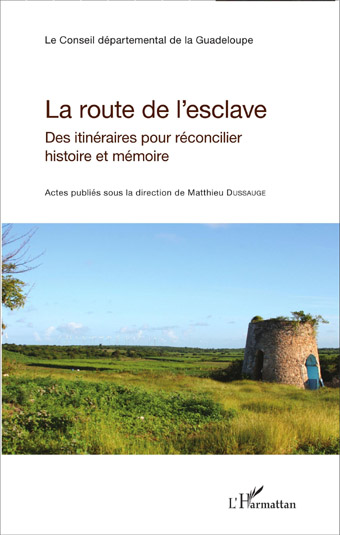
Quelques communications constituent de précieuses mises au point historiographiques sur l’histoire de l’esclavage et des abolitions qui distinguent les domaines dans lesquels la recherche a beaucoup progressé et les points sur lesquels il reste encore beaucoup à faire. Dominique Rogers, maître de conférences en histoire moderne à l’université des Antilles, après avoir notamment montré l’ampleur et la qualité des travaux consacrés aux résistances serviles, constate que « les historiens ont joué pleinement leur rôle scientifique en donnant les moyens de comprendre et d’expliquer l’expérience servile singulière des hommes et des femmes des sociétés caribéennes. » (p. 37)
L’historien du droit Jean-François Niort nous entretient du Code noir, sur lequel il a d’ailleurs publié en 2015 un précieux ouvrage aux éditions du Cavalier bleu, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, qui a fait l’objet d’un tir de barrage de la part de certains acteurs d’associations mémorielles, particulièrement virulents.
La communication très riche de Nelly Schmidt, grande spécialiste des mouvements abolitionnistes, évoque « Abolition et abolitionnistes de l’esclavage » dans une perspective critique et patrimoniale. Elle indique que « l’historiographie occidentale a pris peu de recul critique à l’égard des courants abolitionnistes » (p. 222)) qu’il convient d’étudier dans une perspective internationale et qu’elle « a peu retenu le rôle des captifs, des esclaves et de leur résistance dans les processus de suppression de la servitude. » (p. 223) Elle souligne que de nombreuses questions relatives aux abolitionnistes restent en suspens : par exemple, sur leur perception de « la politique d’extrême coercition mis en œuvre au lendemain de l’émancipation de ces colonies » (p. 229).
Quant à l’historienne Myriam Cottias, qui préside le Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE), issu de la loi du 21 mai 2001, dite « loi Taubira », par laquelle la France reconnaissait la traite et l’esclavage atlantique et dans l’océan Indien comme crime contre l’humanité, elle est la seule à évoquer les Mascareignes. L’éminent spécialiste de la question de l’esclavage à La Réunion qu’était Sudel Fuma devait présenter une communication à ce sujet mais il décédé tragiquement quelque temps avant la tenue du colloque qui lui a d’ailleurs rendu un hommage mérité.
Dominique Rogers considère, en revanche, que c’est dans le domaine de la transmission de ces avancées que le bilan semble mitigé. Elle constate que « dans la Caraïbe, la parole des historiens professionnels » a longtemps « été concurrencée par des discours dominants, instrumentalisant le passé servile pour des motifs divers. » (p. 37) Pour Jean-François Niort, objet d’une vindicte, l’espace public est saturé « par les différents discours mémoriels de la traite et de l’esclavage […] qui entrent souvent en contradiction avec les travaux scientifiques des historiens. » (p. 69) Et l’historien guyanais Jean Moomou de déplorer, quant à lui, une « concurrence des mémoires » (p. 108) que révèleraient par exemple, aux Antilles française, l’érection controversée d’une stèle commémorant l’arrivée des premiers Français en Guadeloupe ou la décapitation, en Martinique, d’une statue de Joséphine de Beauharnais. Et Marcel Dorigny de revenir, dans un passionnant tour d’horizon de l’esclavage et de la première colonisation dans le paysage parisien d’aujourd’hui, sur la « bataille mémorielle » (p. 247) qui eut lieu au tournant du XXIè siècle autour de la rue Richepance (ou Richepanse), du nom du général envoyé en 1802 en Guadeloupe pour y rétablir l’esclavage, rebaptisée sous le nom du Chevalier de Saint-George.
Le colloque convoque des intervenants qui ont une vision apaisée et nuancée des relations entre histoire et mémoire. Deux organes très connus sont notamment amenés à présenter leurs actions : le CNMHE présidé par Myriam Cottias et les Anneaux de la Mémoire. Le CNMHE déploie ses actions autour de trois axes, fidèle à la philosophie du projet « La Route de l’esclave » : transmettre et consolider les « connaissances sur l’histoire de l’esclavage (et notamment sur l’esclave -personne en situation d’esclavage, esclavisée- en tant qu’acteur et individualité dans un système de coercition) et des abolitions (résultant de l’action combinée des révoltes d’esclaves, des réflexions des abolitionnistes et des conditions économiques) », valoriser les « actions citoyennes » au sein de la société française autour de l’histoire et de la mémoire de l’esclavage, et établir des « espaces de dialogue et de connaissance autour des principales questions mémorielles qui occupent l’espace public français. » (p. 186). Une plateforme des lieux et actions de mémoire de l’esclavage (www.esclavage-memoire.com) a ainsi vu le jour en 2014.
Quant au programme « Mémoires libérées/TOSTEM » lancé au début de 2014 par l’association nantaise Les Anneaux de la Mémoire, fondée officiellement en 1991, il est « au croisement de deux approches : celle du travail d’histoire, du devoir de mémoire [sic] et celle des préoccupations de développement économique des partenaires africains et caribéens [Cameroun, Sénégal, Haïti, Antigua et Barbuda]. » (p. 200) L’objectif du programme consiste principalement à « mettre en valeur des sites et des lieux de mémoire déjà identifiés ou en cours d’identification » dans ces pays et à « développer un tourisme culturel d’histoire et de mémoire autour de ces sites et au niveau national. » (p. 204) C’est le cas par exemple de l’important travail qui s’est développé, depuis 1999, autour des Chefferies de l’Ouest-Cameroun.
La communication de Matthieu Dussauge (pp. 331-351), centrée sur le projet « La Route de l’esclave. Traces-mémoires en Guadeloupe » qu’il chapeaute, permet, en particulier, de prendre la mesure concrète d’une déclinaison locale d’un projet global. Il s’agit notamment, pour le contexte guadeloupéen, de donner plus de visibilité aux lieux de mémoire associés à l’histoire de l’esclavage : l’Unesco recommandant de se prémunir contre le risque de survaloriser par exemple les vestiges d’architectures coloniales au détriment de l’histoire des esclaves eux-mêmes, le projet s’est attelé à respecter « une juste proportion […] dans la typologie des sites. Si les sites dits de ‘production agro-industriels’ tels que les habitations sucreries figurent parmi les évidences indispensables, il a semblé essentiel de mettre également en valeur les lieux de résistance et les sites ‘naturels’ sur lesquels n’étaient pas nécessairement conservés des vestiges tangibles. » (pp. 334-335) Le projet guadeloupéen est le premier itinéraire du monde consacré à la mémoire de l’esclavage à recevoir le label « Route de l’esclave » de l’UNESCO. Pour Matthieu Dussauge, nul doute que cet itinéraire fondé « sur une stratégie alliant la recherche historique, la mise en valeur des patrimoines et la réalisation d’actions et de supports de médiation originaux [constitue] un outil de valorisation touristique unique dans la Caraïbe. » (p. 351)
La Guadeloupe est d’ailleurs, très logiquement, l’objet de nombreuses communications qui mettent en valeur le rôle de l’archéologie dans la connaissance de son passé esclavagiste. Tristan Yvon montre ainsi que l’archéologie peut grandement contribuer à la connaissance de l’habitat des esclaves, la partie de l’habitation consacrée à la production ayant jusqu’à présent davantage focalisé l’attention des historiens.
Quant aux archéologues Thomas Romon, Jérôme Rouquet et Patrice Courtaud, ils évoquent les cimetières d’esclaves en Guadeloupe dont un nombre sans cesse croissant ont été fouillés depuis une vingtaine d’années et dont la localisation apparaît rarement sur les plans d’époque et dans les archives. En Guadeloupe, seuls deux des six cimetières qui ont fait l’objet de recherches archéologiques ont livré une documentation suffisamment convaincante pour soutenir qu’il s’agit bien de cimetières d’esclaves : celui de l’Anse Sainte-Marguerite au Moule, « actuellement l’ensemble funéraire le mieux documenté de tout le continent américain avec les vestiges exhumés de plus de 250 sujets » (p. 162) et celui de la Plage des Raisins Clairs à Saint François. Les auteurs concluent en faveur de l’identification de ces cimetières comme lieux de sépultures d’esclaves, principalement en raison du fait que « des ensembles funéraires aussi importants n’aient pas laissé de trace dans les archives. » (p. 163)
Enfin, Hélène de Kergariou et Tristan Yvon évoquent un lieu de mémoire de l’esclavage, l’indigoterie de l’Anse à la Barque, et les modalités de sa possible mise en valeur. L’article rappelle que la culture de l’indigo s’est développée aux Antilles après 1630 et, qu’après un déclin très rapide, la quasi totalité des indigoteries a disparu dès 1735. Actuellement, le site est à l’abandon. Relativement difficile d’accès, il n’est pas entretenu par ses propriétaires et risque donc de disparaître. Le Conservatoire du littoral rencontre des difficultés pour acheter ce terrain. Une fois acquis, il faudra intervenir en tenant compte du fait qu’il s’agit d’ « un lieu de plusieurs mémoires » qui suppose que l’on n’impose pas « au visiteur une seule manière de se remémorer. » (p. 156)
De nombreuses communications nous convient enfin à une sorte de voyage autour du monde de lieux emblématiques, en général bien méconnus, de l’histoire de la traite et de l’esclavage.
Fabienne Viala nous emmène ainsi à l’IMS (International Museum of Slavery), le Musée International de l’Esclavage à Liverpool, inauguré en 2007. Situé sur les docks, « un lieu-mémoire du délit » (p. 257), au sein du musée du commerce naval, l’IMS constitue une « mise en pratique d’une mémorialisation de l’émotion » (p. 261). L’auteur évoque notamment la salle du Middle Passage « qui ne nous apprend ‘rien’ en termes de contenu informatif mais nous dit tout en termes de contenant émotionnel. La salle du Middle Passage devient un espace pour accueillir les émotions suscitées chez le visiteur par l’immersion dans la douleur scénographiée mais décontextualisée d’un individu dans l’enfer de la traite. » (p. 262)
En Amérique du Sud, c’est, par exemple, le « Museo Afroperuano » de Zaña au Pérou, « uno de los lugares de la costa norte del Peru que tiene una concentracion de familias de raices africanas y conserva viva la memoria del pasado esclavista. » Et son directeur, Luis Rocca Torres, de souligner : « La complejidad de las relaciones entre afrodescendientes y diversas etnias ha sido poco estudiada en los paises de la region andina. » ((p. 274)
Quant à l’emblématique Haïti, deux communications nous informent des actions menées. Il est question par exemple du musée Ogier-Fombrun, érigé en 1983 sur les ruines d’une habitation sucrière construite en 1760 par le colon Guillaume Ogier. Sa directrice relate l’expérience qui « se répète […] souvent quand on demande aux jeunes Haïtiens de définir l’esclavage. Ils répondent automatiquement ‘c’est le travail’. Pour ces enfants, ce n’est pas la notion de perte de liberté qui constitue l’esclavage, mais le fait même de travailler, de travailler pour l’autre, de travailler pour le ‘blanc’. » (p. 393).
Pour l’Afrique, Samuel Kidiba évoque les témoins matériels et immatériels des pistes caravanières au Congo Brazzaville. Le point d’intersection de toutes les pistes caravanières du Congo est la baie de Loango (port d’embarquement des esclaves). Là, selon l’auteur, sont passés plus de 2 millions d’esclaves, venus d’Angola, du Gabon, du Cameroun, des deux Congo, de la République centrafricaine et du Tchad. Il s’inquiète : « Les témoins immatériels sur les pistes au Congo disparaissent à une vitesse inquiétante. » (p. 328) Les défis à relever sont nombreux : « dresser une carte indicative des itinéraires, marchés, lieux de vente et de parquement des captifs » et entreprendre « un travail d’aménagement des vestiges identifiés » (p. 329)
L’ouvrage se termine par le bel article, riche et sensible, d’Emmanuel Gordien, président du CM98 (Comité marche du 23 mai 1998), « association mémorielle dont l’objectif premier est de réhabiliter, honorer et défendre la mémoire des victimes de la traite négrière et de l’esclavage colonial des anciennes colonies françaises » (p. 415). Il nous entretient des données qui ont permis à l’association de retrouver 120 000 noms portés par près de 80% de la population de la Guadeloupe et de la Martinique. Un atelier de généalogie et d’histoires de familles a même été créé dans le but de « rechercher ‘l’Esclave’, celui qui est à l’origine du Nom, qui est à la base de la Famille » (p. 420) L’association est également à l’origine de l’érection, effective depuis 2015, d’un Mémorial de noms d’esclaves antillais sur la plage de Ouidah, là où naquit le projet « La Route de l’esclave ».
Nous avons donc là un ouvrage qui ne manquera pas d’enrichir tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la mémoire de l’esclavage et ambitionnent de les réconcilier : ‘Si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble » (Edouard Glissant).