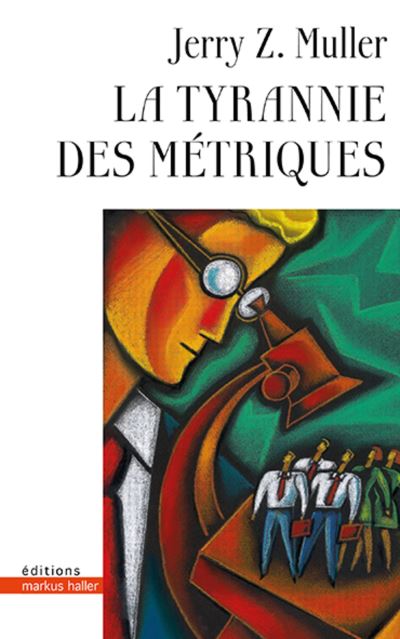Aujourd’hui, on a parfois tendance à tout mesurer et cela touche de multiples secteurs comme l’éducation, la police ou encore la médecine. Dans ce livre très argumenté, l’auteur, professeur d’histoire à la Catholic University of America à Washington, empoigne la question de façon globale. Comme il le dit lui-même, il n’entend nullement faire œuvre de nouveauté mais il souhaite synthétiser des données souvent dispersées.
L’obsession de quantifier
Dans l’introduction, Jerry Z. Muller explique clairement que certaines choses méritent d’être mesurées mais ce que l’on peut mesurer n’est pas toujours ce qui mérite d’être mesuré. Notre époque croit à la redevabilité quantifiée, à la rétribution des performances quantifiées. Le problème ne tient pas aux métriques mais à l’obsession métrique. Cela s’explique par le fait qu’on pense qu’un résultat chiffré est plus valable qu’un jugement, qui est perçu comme subjectif et intéressé. L’auteur s’est intéressé à ce sujet car, en tant qu’universitaire, il a vu apparaître dans son quotidien de nouvelles missions souvent chronophages et pas forcément utiles.
L’argument
Il s’agit d’abord de définir le terme de redevabilité : être redevable, c’est être responsable mais c’est aussi être quantifiable. Quant au terme de métrique, il définit un type de mesure quantifiable de la performance d’une organisation. L’auteur précise les implications de cette obsession : remplacer le jugement, rendre publique, le meilleur moyen de motiver consistant à lier performances et récompenses. Dans ce dernier cas, il faut quand même se rendre compte que l’obsession métrique est une incitation à la triche. L’auteur présente deux lois, celle de Campbell qui affirme que plus un indicateur quantitatif social est utilisé pour la prise de décision sociale, plus il a de chances de fausser les processus qu’il a pour objet de surveiller. Il développe aussi la loi de Goodhart qui montre que toute mesure utilisée à des fins de contrôle perd sa fiabilité. L’un des objectifs de son livre est de faire le tri entre les cas où l’utilisation des métriques se justifie, et ceux où cela est inutile ou contre-productif. L’auteur propose ensuite un chapitre très synthétique qui récapitule les défauts des métriques. Parmi ceux-ci il y a le fait qu’on mesure souvent ce qui se mesure le plus facilement ou encore qu’on a tendance à davantage mesurer les moyens que les résultats.
Le contexte
Jerry Z. Muller cherche ici à retracer les origines de l’obsession métrique, d’en expliquer la diffusion et la persistance, en dépit de ses échecs. Parmi les origines, il évoque les méthodes tayloriennes et explique que ces modes d’organisation se sont diffusés hors de l’usine. Autre origine d’un tel mouvement, celle des comptables, et notamment l’influence de Robert McNamara. Il revient ensuite sur les raisons du succès des métriques en pointant le fait qu’on se méfie du jugement. Les chiffres dégagent une impression d’objectivité. Au niveau politique, plusieurs tendances se rassemblent pour aller dans le même sens. Il est devenu également plus facile de collecter de l’information et on a donc eu tendance à collecter pour collecter. L’auteur revient ensuite sur la formule du « problème principal-agent ». Cela signifie qu’il existe un fossé entre les objectifs des institutions et ceux des personnes qui les dirigent et sont employées par elles. Il souligne aussi que les récompenses extrinsèques sont surtout efficaces dans des organisations commerciales. Il y a deux formes de savoir, l’une abstraite et formulée, et l’autre plus pratique et tacite. Parmi les autres critiques, retenons également que l’évaluation est l’ennemie de l’imagination.
Les études de cas
La troisième partie envisage plusieurs études de cas, que ce soit dans l’enseignement supérieur, l’école ou l’hôpital. Dans l’enseignement supérieur, l’augmentation du nombre de diplômés a pour conséquence de dévaluer les diplômes. Certains enseignants, et particulièrement ceux au statut précaire, peuvent avoir tendance à s’aligner sur ce que souhaite l’université. L’auteur montre que pour avoir plus de données, il faut plus de monde et donc plus de logiciels coûteux, ce qui est un sacré paradoxe quand on sait que l’objectif est de maîtriser les coûts.
Jerry Z. Muller pointe ensuite les dérives induites par les classements des universités. Une université moyennement classée dépense de fortes sommes pour se payer des pages de publicité car un des classements se fonde sur les avis des présidents d’université qui peuvent donc être influencés par le fait d’avoir entendu parler d’elle dans les médias. On retrouve la même dérive pour les publications universitaires car il vaut mieux publier cinq articles avec peu d’informations plutôt qu’un seul bien informé. Le chapitre suivant traite des écoles avec des pratiques métriques tout aussi critiquables. Les tests standardisés ont tendance à influencer les façons de travailler des élèves.
A l’hôpital
Pour l’auteur, c’est le lieu où le fait de mesurer s’est imposé le plus radicalement. L’OMS classe les systèmes de santé mais encore faut-il savoir ce qu’on mesure. Les questions de santé ne représentent que 25 % des facteurs pris en compte dans le classement. « La moitié des points récompense l’équité c’est-à-dire quand les individus payent tous pour leurs soins un même pourcentage de leurs revenus. » On peut s’interroger sur les chiffres de mortalité qui sont en grande partie influencés par des facteurs extérieurs au système médical. L’auteur évoque quelques succès rendus possibles grâce aux métriques, mais il pointe surtout les dérives. Si on commence à conditionner une partie de la rémunération des médecins à la survie de leurs patients, on s’aperçoit que certains risquent de ne plus être opérés pour ne pas faire baisser les bons chiffres du médecin. Ce dernier pourra se targuer de bons résultats mais le patient sera mort.
Dans la police et dans l’armée
Il faut d’abord rappeler que « la sûreté publique ne dépend qu’en partie de l’efficacité de la police ». Bien d’autres éléments sont à prendre en considération comme le système pénal ou encore les procureurs. Les chefs de police doivent afficher des taux de criminalité en baisse par tous les moyens. Si on veut montrer qu’on est actif, on peut arrêter cinq petits revendeurs de drogue chaque jour, alors que la vraie efficacité serait une enquête longue qui ferait tomber le chef. Pour l’armée, c’est un peu la même idée : faut-il des indicateurs fondés sur le volume d’interventions ou sur leurs effets ?
Dans le monde des affaires, de la finance et ailleurs
L’auteur envisage d’autres domaines comme celui de la finance et montre les cas où la rémunération à la performance fonctionne. Il revient aussi sur la crise de 2008 en soulignant que, si elle a des causes multiples, « certaines procèdent d’une volonté de substituer des métriques standardisées au jugement fondé sur un savoir local ». Les métriques peuvent être aussi des pièges dans les organisations à but non lucratif.
Quelles conclusions ?
Jerry Z Muller rassemble ce qui a été vu et liste les dangers des métriques. Chacun apparait en gras suivi d’un commentaire d’une dizaine de lignes en moyenne. Parmi eux, il relève donc la promotion du court-termisme, l’avalanche de règles ou encore l’innovation découragée. Le chapitre suivant dresse en revanche une liste de quelques exemples d’utilisations vertueuses des métriques mais surtout il propose un vademecum pour le décideur qui souhaite s’engager dans les métriques. A travers dix questions, c’est autant de points de vigilance à avoir avant de se lancer. Parmi elles retenons celle qui fait s’interroger sur « à quelles fins le mesurage est-il pratiqué ? …Qui est censé bénéficier de la transparence de l’information ? ».
C’est donc un livre très stimulant qui propose que tout un chacun réfléchisse clairement à l’utilisation des métriques. Abordant de nombreux domaines professionnels, il démontre bien combien elles ont envahi notre quotidien, mais il livre surtout une liste de réflexes et de questions à se poser pour les reconsidérer.