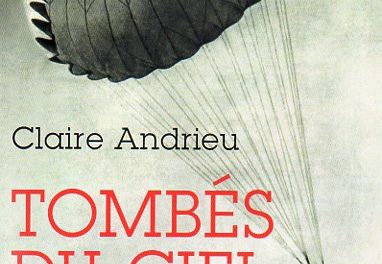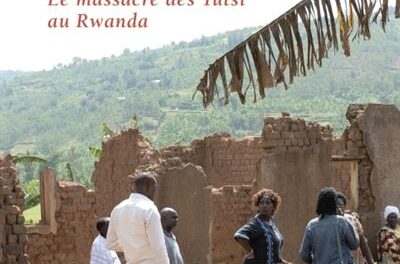Marco Grispigni (1957) est archiviste et spécialiste des mouvements sociaux et politiques italiens des années 1960 et 1970. Depuis 2000, il travaille à Bruxelles à la commission européenne.
L’auteur constate en introduction que les années 1970 sont restées dans la mémoire collective comme celles de la violence politique des « années de plomb ». Il regrette que bien peu de travaux mettent en lumière le rôle des mouvements sociaux qui ont contribué à de nombreuses réformes législatives dans les années 1970. Ce rappel étant fait, il choisit d’interroger les formes et les objectifs de la violence politique, les acteurs sociaux qui ont pratiqué cette violence et le caractère exceptionnel et particulier des évènements italiens. L’écriture de ce livre a été motivée, selon son auteur, par une profonde insatisfaction face à la multitude d’ouvrages consacrés à la violence politique, dont bien peu offrent une véritable vision d’ensemble de cette question. L’auteur passe en revue les thèses les plus fréquentes au sein de l’énorme bibliographie consacrée en Italie à ce sujet. La première fait généralement de la violence politique le schéma explicatif privilégié des « années de plomb » : la lutte armée et le terrorisme seraient une escalade, dans la continuité de théories et de pratiques nées pendant les années 1960. Marco Grispigni réfute cette thèse, qui ne permet pas selon lui de comprendre pourquoi les théories révolutionnaires ont débouché sur le terrorisme en Italie et pas ailleurs. Pour la même raison, il réfute la théorie selon laquelle le « péché originel » italien réside dans l’idée même de révolution qui serait propre au caractère national transalpin. Il regrette également le manque de contextualisation de nombreux travaux qui se sont intéressés au « langage », empreint de violence, des groupes d’extrême-gauche.
M. Grispigni s’arrête dans son introduction sur deux autres clés d’interprétation fréquentes. La première insiste sur les spécificités de l’année 68 en Italie. La seconde fait de la lutte entre les « Rouges » et les « Noirs » un entraînement à la pratique de la violence politique, facilitant le passage à l’acte. Ces deux démarches placent dans la deuxième partie des années 1960 l’émergence de traits censés être constitutifs de « l’anomalie » italienne. Ils s’opposent à ceux, dont l’auteur, qui font de l’attentat de la place Fontana à Milan, le 12 décembre 1969, son véritable point de départ.
Pour Marco Grispigni, les évènements de 1968 en Italie ne constituent pas une anomalie par rapport aux autres pays. En revanche, la confrontation sanglante entre extrémistes de droite et de gauche est bien une particularité italienne. Mais dans les années 67-68, au moment de l’explosion du mouvement étudiant, la confrontation avec les néofascistes n’est pas l’élément principal.
La thèse centrale de ce livre est l’impossibilité de comprendre « les années de plomb » italiennes, sans partir du drame de Piazza Fontana du 12 décembre 1969 et des enquêtes immédiatement lancées contre les «monstres anarchistes » accusés de l’attentat. L’ouvrage interroge également la « stratégie de la tension » et les responsabilités de certains appareils d’État, pour comprendre dans quelle mesure ces facteurs ont pu jouer un rôle dans le passage d’une partie des acteurs de mouvements sociaux vers la lutte armée. L’objectif du livre est donc, en recourant à une analyse comparative, d’interroger la spécificité italienne à travers une vision panoramique de la violence politique en Italie, pendant la longue période des mouvements contestataires. Au passage, l’auteur prend le soin d’expliciter le choix du vocabulaire et des notions employés, pour récuser le terme de « guerre civile », souvent utilisé pour qualifier cette période et justifier au contraire le terme de « terrorisme », applicable à la lutte armée de droite comme de gauche.
Dans le premier chapitre, Marco Grispigni mène une analyse comparative de la gestion de la rue et de l’ordre public, en France et en Italie, à partir des années de l’après Seconde guerre mondiale. En effet, la violence politique n’est pas née en 1968 et la pratique de celle-ci ne conduit pas inexorablement à la lutte armée et au terrorisme. Cette analyse lui permet de dégager un modèle commun aux deux États : une première étape d’épuration des éléments communistes au sein des forces de l’ordre (les C.R.S. français ou la « Celere » italienne) dans le contexte de la guerre froide ; une répression inflexible des mouvements sociaux assimilés à la subversion communiste (ex : grèves de 1947 en France, 1948 en Italie) et une forme de banalisation de l’usage des armes à feu ( évènements de Modène en janvier 1950 : 6 morts par balles chez les ouvriers italiens). A partir de 1950, l’usage des armes à feu devient l’exception en France mais il perdure en Italie (ex : Reggio Emilia en juillet 1960, 5 ouvriers tués par balles). Les divergences dans l’usage de la violence s’estompent cependant si l’on prend en compte la violente répression menée par l’État français dans le contexte de la guerre d’Algérie ( massacre du 17 octobre 1961, carnage de la station de métro Charonne le 8 février 1962…).
L’analyse comparée de la violence politique de 1945 au début des années 1960 conduit l’auteur à rejeter l’hypothèse d’une spécificité italienne.
Le deuxième chapitre aborde l’irruption de nouveaux acteurs, les jeunes, à la fin des années 1960 dans le monde occidental. Elle constitue une discontinuité par rapport aux mouvements sociaux précédents. Le recours à la violence dans la jeunesse de l’époque peut être assimilé à un « mode de communication », qui permet d’attirer l’attention des médias dans la « société du spectacle ». C’est aussi un véritable rite de passage. La violence politique de la jeunesse revêt donc une dimension existentielle, caractérisée par une altérité radicale par rapport au système dominant.
Le choix d’interpréter l’ensemble des comportements violents dans une perspective uniquement politique ne permet pas de distinguer la violence subversive et celle du terrorisme organisé. A contrario, il ne faut pas nier ou minorer la dimension politique et révolutionnaire de cette violence au profit d’une interprétation uniquement culturelle, générationnelle. Il y a, selon l’auteur, une interaction de ces deux aspects de la violence politique. De plus, pour l’Italie, ce dernier considère que l’antifascisme militant de la jeunesse de gauche peut expliquer une certaine forme de militarisation des mouvements sociaux mais qu’il ne permet pas de comprendre le passage à la lutte armée.
Le troisième chapitre est consacré l’année 1968. Il repose lui aussi sur une analyse comparative afin d’invalider la thèse d’un particularisme italien. L’auteur démontre que la violence et la répression des mouvements de 1968 par les forces de l’ordre se retrouvent en Italie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Les nouveaux acteurs de ces mouvements, les jeunes, contraignent les forces de l’ordre à modifier la gestion de l’ordre public. Les effectifs augmentent, de nouveaux outils et matériels sont utilisés contre les étudiants et les manifestants. Si les barricades de ces derniers apparaissent volontairement spectaculaires, les interventions des forces de police sont elles aussi marquées par une forme de théâtralité . Cela n’enlève rien au caractère dramatique et violent des évènements. L’auteur réfute également la théorie d’une spécificité italienne liée à la longueur du conflit, tout comme celle liée au rôle de la pensée révolutionnaire marxiste et des mouvements d’extrême-gauche dans le mouvement.
Selon Marco Grispigni, rien ne valide l’hypothèse de l’exceptionnalité du cas italien en 1968.
La quatrième partie de l’ouvrage est toute entière consacrée à l’attentat de la place Fontana à Milan, le 12 décembre 1969, qui fit 16 morts et 88 blessés. Pour l’auteur, « l’anomalie italienne » réside dans cet attentat et dans le télégramme envoyé par le préfet de Milan au Président du conseil à 22h, qui pointait la responsabilité des anarchistes. Cette promptitude à désigner les coupables correspondait selon lui à une volonté d’orienter l’enquête afin de mettre fin à un nouveau « Biennio rosso ». L’exception italienne réside dans la gestion étatique d’attentats sanglants, dans la responsabilité des appareils d’État et dans leur tentative d’entraver la recherche de la vérité.
L’attentat de Piazza Fontana marque la « fin de l’innocence » pour les mouvements contestataires face au terrorisme de l’extrême-droite, sans doute responsable de six attentats entre 1969 et 1974, qui firent 50 morts et 346 blessés. La certitude d’une implication d’une partie des services de l’État s’est très vite répandue dans l’opinion publique. Cet attentat marque alors un tournant fondamental, il précède chronologiquement le terrorisme et la lutte armée.
Des nombreuses interprétations des évènements proposées par les spécialistes de la période, seule celle reposant sur la théorie du complot a réussi à dépasser le milieu des spécialistes et à susciter un écho médiatique. Elle voit dans la stratégie de la tension et dans le terrorisme de gauche un seul et même dessein, qui de Piazza Fontana en 1969 à l’assassinat d’Aldo Moro en 1978, a pour but d’empêcher le PCI (Parti Communiste Italien) d’accéder au pouvoir.
L’autre théorie, qui nie purement et simplement l’existence des « mystères » de l’histoire contemporaine italienne est jugée tout aussi réductrice. Pour Grispigni, ces deux théories ne peuvent en aucun cas rendre compte de la complexité des évènements et de leur enchaînement.
Pour l’auteur, l’Italie de la fin des années 1960 connaît une conflictualité sociale et politique radicale, souvent violente. L’importance du PCI dans la vie italienne a conduit une partie de l’establishment à réagir, par, entre autres, l’élaboration d’une stratégie criminelle de maintien de l’ordre. L’attentat de Piazza Fontana marquerait à la fois le début et la fin de la « stratégie de la tension ». En effet,la prise de distance de ceux qui avaient utilisé les mouvements néofascistes avec ces derniers débouche sur une nouvelle série d’attentats commis par l’extrême-droite. Elle précipite dans la lutte armée une frange extrémiste et révolutionnaire de gauche, née lors des révoltes des années antérieures. Piazza Fontana serait ainsi le moment de la véritable rupture italienne avec les autres pays concernés par les vagues de contestation .
Le cinquième chapitre se concentre sur le rôle et les actions des néofascistes, acteurs qui semblent avoir été effacés des mémoires collectives mais dont le rôle a été prouvé par de nombreux travaux. Ceux-ci contredisent la mémoire victimaire de ces mouvements néofascistes. Dans ces années, le choix de devenir néofasciste n’est ni difficile, ni à contre-courant.
Les études montrent que certains des jeunes néofascistes ont connu une certaine confusion politique et crurent possible de rejoindre les contestataires lors des évènements de 1968, dans une grande révolte générationnelle. Ils ont été rapidement rappelés à l’ordre par les caciques du MSI (Mouvement Social Italien).
L’attentat de Piazza Fontana révèle l’existence de connivences entre des secteurs de l’appareil d’État et les mouvements néofascistes (Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale). Pour l’opinion de gauche, il existe une menace néofasciste qui suscite un antifascisme militant à l’extrême-gauche, (avec par exemple le slogan « tuer un fasciste n’est pas un crime »). Le passage d’un antifascisme militant vers la lutte armée et le terrorisme ne procède cependant d’aucun automatisme.
Le dernier chapitre de l’ouvrage est spécifiquement consacré aux années 1970, les « années de plomb ». Jusqu’en 1974, la violence terroriste fut d’abord le fait des mouvements néofascistes. A partir de cette date, le problème central devient celui du terrorisme de gauche.
Les forces de l’ordre reviennent dans la décennie 70 au mode répressif des années 50, même si l’usage des armes à feu demeure occasionnel. Ce choix d’une politique de confrontation a provoqué la mort de 19 personnes entre 1970 et 1979. L’agressivité croissante des cortèges, l’emploi de cocktails molotovs puis d’armes à feu à partir de 1977, précipitent l’introduction de nouvelles techniques de maintien de l’ordre.
En France, le ministre de l’intérieur Raymond Marcellin, réactive la loi du 10 janvier 1936 autorisant la dissolution des ligues. En 1970, la loi « anti-casseurs » est votée, elle lui permet de frapper la Gauche prolétarienne. En Italie, les organisations de la gauche extra-parlementaire ne sont pas dissoutes même si l’État y a un temps songé. Il recule sous la pression de la police qui craint un risque de basculement dans la clandestinité.
L’auteur compare ensuite le rapport à la violence de certains de ces mouvements.
Potere Operaio était organisé comme l’avant-garde du prolétariat sur le modèle léniniste, avec en son sein, un mouvement clandestin, le FARO. On retrouve le même type d’organisation chez Autonomie ouvrière après la dissolution de Potere Operaio en 1973. La militarisation des actions politiques menées par ces deux organisations conduisent le plus souvent à transformer la violence des cortèges en une violence offensive contre des cibles sensible. La trajectoire de Lotta Continua (LC), organisation la plus importante a l’extrême-gauche, a été différente. Lotta Continua avait un mode d’organisation très éloigné du modèle léniniste de Potere Operaio. Elle connaît une militarisation forte à partir de 1972, mais entre 1973 et 1974, LC s’oppose à l’option clandestine des Brigades Rouges (BR). Après la dissolution de l’organisation, le journal Lotta continua s’oppose à la lutte armée. Au moment de l’affaire Moro en 1978, le journal se définit comme « ni avec l’État ni avec les BR ».
De leur naissance jusqu’en 1972, les actions des BR sont assez similaires à celle des autres groupes. A partir de l’enlèvement des dirigeants de la Sit Siemens en 1972, les principaux membres des BR sont arrêtés. Mais, l’organisation renaît de ses cendres, se réorganise, attire de nombreux nouveaux militants et décide de porter « l’attaque au coeur de l’État ». Cette capacité à surmonter de graves revers est aussi une particularité du terrorisme de gauche italien.
L’ouvrage de Marco Grispigni est un livre engagé dans lequel l’auteur défend ses thèses et analyses avec conviction, souvent avec persuasion. On peut toutefois regretter l’absence d’une véritable conclusion. La bibliographie, très largement basée sur des ouvrages en italien, est indiquée dans les notes de bas de page. Une bibliographie en fin d’ouvrage, thématique ou par chapitre, aurait été la bienvenue. Enfin, s’il tente d’offrir une vision globale de la question traitée, l’ouvrage nécessite pour le lecteur français d’avoir une assez bonne connaissance du contexte politique italien des années 1960 et 1970. Ce livre n’en demeure pas moins très intéressant et agréable à lire. Il propose des pistes de réflexion intéressantes et originales. Dans la profusion des livres publiés en France pour l’anniversaire des évènements de 1968, il permet de décentrer notre point de vue. En s’appuyant sur une analyse comparative, trop rarement menée, il revient de façon convaincante, sur le caractère politique de la violence des ces « années de plomb ».