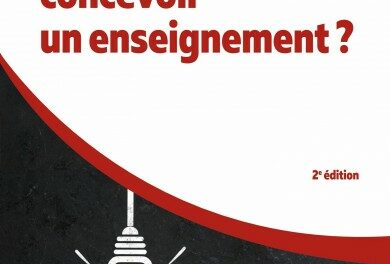La loi Fioraso (2013), en désirant réserver dans les filières STS (Sections de Techniciens Supérieurs) et les IUT (Institut Universitaire Technologique) des places aux élèves issus de bac pro et technologiques, ramène sur le devant de la scène cet « autre enseignement supérieur » peu présent dans les médias. C’est à ces oubliés que Sophie Orange a consacré sa thèse de doctorat. Récompensée par le Prix Louis Gruel en 2012, son texte sort chez PUF dans la collection Education et Société dirigée par Agnès van Zanten.
Les sections de techniciens supérieurs (STS) existent depuis 1961. « Ces petites formations, nichées dans le grenier des lycées, sont paradoxalement apparues, tantôt comme une solution aux maux universitaires, tantôt comme une de leurs causes. » (p. 1) La sélection à l’entrée en STS ne signifie pas qu’elles aspirent, comme les CPGE, les meilleurs élèves, ni qu’elles les détournent de l’université. L’essentiel des élèves de STS sont de « nouveaux étudiants » (Blöss et Erlich, 2000) issus de bacs pro ou techno. Première génération de bacheliers, ils viennent de familles appartenant aux milieux populaires. Leur arrivée dans l’enseignement supérieur rompt avec la figure mythique de l’étudiant hérité et urbain (Bourdieu et Passeron, 1964).
L’existence d’un plafond scolaire ?
Une cohorte de 900 étudiants représentatifs des étudiants de STS de l’académie de Poitiers a été suivie pendant trois ans par questionnaires. Des entretiens semi-directifs ont aussi été conduits avec des étudiants afin d’alimenter une étude ethnologique. Cette étude longitudinale permet de montrer que le projet de poursuites d’études (post BTS), partagé par 53,5% des jeunes lors de leur entrée en STS, s’émousse au fil de la scolarité. Deux ans plus tard, 27,8% des étudiants de l’effectif de départ poursuivent effectivement des études. Si ces chiffres peuvent être interprétés comme une révision à la baisse des ambitions des étudiants, Sophie Orange propose de les mettre en relation avec le peu de passerelles qui existent entre les BTS et les autres filières du supérieur. Elle pose aussi l’hypothèse, dans la lignée des travaux de socialisation scolaire (Durkheim, 1938), que l’école (le lycée) formate les jeunes à ne pas pousser davantage leurs études. Une sorte de « plafond de verre » réduirait leurs marges de manœuvre pour poursuivre des études.
Faire correspondre offre et demande
Le choix d’un BTS par les jeunes est le résultat de plusieurs critères. L’éloignement des centres d’études universitaires constitue le plus souvent un obstacle à l’inscription à l’université. S’inscrire en STS est une solution pour faire face aux coûts matériel et financier des études. Les STS maillent le territoire et sont souvent la formation géographique la plus proche. « En contribuant de la sorte au processus de promotion scolaire, les STS, sorte d’enseignement secondaire prolongé, semblent avoir joué un rôle similaire à celui qu’a pu jouer l’enseignement primaire supérieur sous la Troisième République, le CET et le lycée professionnel dans les années 1960-1970 (Maillard, 2005) ou encore les antennes universitaires délocalisées des universités dans les années 1990 (Beaud, 2003, Convert, 2003) ». (p. 23) Il semble aussi que la localisation géographique de la formation soit centrale dans les choix d’une filière de STS par les jeunes. De plus, la connaissance des études supérieures par ces jeunes se limite souvent à la formation locale, grâce au prosélytisme des enseignants de BTS au sein de leur établissement. Le bouche à oreille joue pour beaucoup aussi. Un étudiant de STS sur deux a un membre de sa famille qui a obtenu ou qui est en train de préparer un BTS. Le rôle des pairs est central pour des jeunes issus des catégories populaires. Ils se rendent entre copains aux journées Portes Ouvertes et décident de postuler groupés à un type de BTS alors que ceux issus des CSP + sont davantage accompagnés par leurs parents. Leur choix est plus individuel. A défaut d’avoir des parents qui peuvent les initier, leur connaissance de l’enseignement supérieur est très partielle et souvent erronée. Toute projection vers la fac chez les jeunes de Bac pro et technologique fait l’objet d’une autocensure : « La fac, ce n’est pas pour moi ».
Une fois qu’un jeune a choisi une filière de STS, encore faut-il que sa candidature soit retenue ! Car, contrairement aux dires des enseignants de BTS, un véritable tri s’opère à l’entrée en STS. Les critères académiques (l’excellence) ne sont pas premiers. Une sélection est faite sur la personnalité du postulant. Les observations faites par Sophie Orange en commission de sélection rendent compte d’une prime à l’étudiant local. La préférence pour les candidats locaux est clairement affichée. Elle est vue comme un gage de la probabilité de leur venue dans l’établissement. La chasse au démissionnaire potentiel occupe l’essentiel du temps des commissions. L’éloignement géographique, un passé scolaire peu en rapport avec la spécificité du BTS, un niveau scolaire trop brillant sont jugés suspects : « Celui-là, c’est bien, mais il ne viendra pas. » « Les STS visent les candidats restants : ceux qu’aucune autre formation sélective ne convoite et qui ne convoitent aucune autre filière » (p. 78)
Une vie d’étudiant au rabais ?
Même si les STS procurent aux élèves une carte d’étudiant, elles les tiennent à distance de ce statut. Les formations sont localisées dans les lycées. Le cadre de fonctionnement en est très proche. Pour qu’une césure soit faite avec l’enseignement secondaire, il est nécessaire que les salles de classe des STS soient à l’écart, que les STS aient un emploi du temps différent. Ce n’est pas toujours le cas et les jeunes ont l’impression d’être encore des élèves. Le travail est très encadré. C’est d’ailleurs ce qui plaît aux jeunes qui y sont inscrits. L’orientation très professionnelle se fait au détriment des savoirs généraux. L’absence de l’histoire-géo est regrettée par 36,2% des étudiants. Elle arrive en seconde position après le sport (54,7%). « L’inégale distribution des savoirs dispensés en STS dispensés en STS, entre savoirs théoriques et savoirs professionnels, accentue la séparation entre ces étudiants et ceux des autres filières du supérieur. » (p. 108) Les jeunes regrettent aussi de ne pas pouvoir bénéficier des services présents habituellement sur les campus (médecine préventive, restau U…). La vie au sein de la STS est perçue de manière différenciée par les élèves urbains et ruraux. Les ruraux sont souvent internes et participent davantage à la vie de la classe. Ils se vivent comme étudiants, en accédant à l’autonomie par la décohabitation. Dans les petites villes où il n’y a pas d’antenne universitaire, être inscrit en STS participe au sentiment de faire partie de « l’élite locale » et consolide l’identité étudiante de la section.
Ce texte limpide, parfaitement argumenté, est un régal de lecture. L’auteure réussit à faire vivre ces étudiants au fil de son texte. Toutefois, il est étonnant que la question du travail salarié des étudiants de BTS (travail le week-end ou la nuit) ne soit pas apparue dans les entretiens et les questionnaires qu’elle a menés. Ce n’est pourtant pas un élément négligeable dans le profil des étudiants. Au-delà de cette remarque, issue d’observations et d’échanges avec des élèves de ces sections, cette étude est d’une remarquable qualité et devrait être lue par les enseignants travaillant avec ces sections pour une meilleure connaissance de leur public. Sophie Orange conclue son étude sur la spécificité de cet enseignement supérieur. « Les récents rapports sur l’échec à l’université ne proposent d’ailleurs pas autre chose qu’un travail actif d’aiguillage puis de confinement des bacheliers professionnels et technologiques vers les BTS. » (p. 191) Si les places réservées à ceux-ci dans les STS leur permettent de réussir et d’envisager une poursuite d’études, pourquoi devrait-on s’en plaindre ?