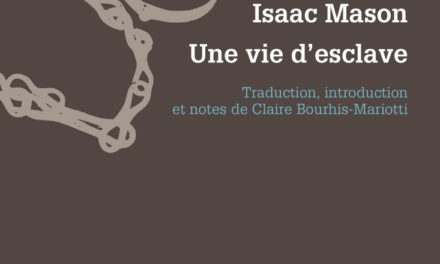Les États-Unis qui examinent le bilan de la présidence de Barak Obama depuis 2008, du point de vue de la politique étrangère, de la politique intérieure, et des questions institutionnelles.
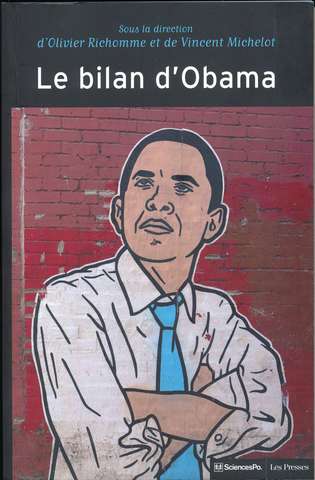
Si la présidence de Barak Obama qui prend ses fonctions le 20 janvier 2009 a suscité beaucoup d’espoir, car elle a mis fin à une occupation de la Maison-Blanche par les républicains qui a duré 28 ans sur 40. Pendant ce temps, des mutations idéologiques, notamment autour de la fiscalité de la place de l’État ont occupé le débat partisan.
Contrairement à ce que l’on a pu croire, surtout en France, l’administration de George Bush de 2000 à 2008 ne s’est pas traduite par une diminution de l’influence de l’État fédéral. Avec le département de la sécurité nationale, l’administration républicaine a créé la plus grosse administration fédérale depuis la consolidation du ministère de la défense en 1947.
À l’extérieur des frontières américaines comme à l’intérieur, notamment sur la gestion du camp de Guantanamo, le président Bush a poussé jusqu’au bout le modèle institutionnel d’une nouvelle présidence impériale, basé sur l’unilatéralisme et sur la plus grande méfiance à l’égard des institutions internationales dès lors qu’elles sont susceptibles d’émettre des réserves sur les choix que les États-Unis estiment prioritaires.
Lorsque Barak Obama s’installe la Maison-Blanche, il arrive avec un programme ambitieux, qui permettrait de sauver l’État-providence, avec notamment l’adoption d’une réforme de la couverture santé. Le président Obama souhaite également remettre en cause l’unilatéralisme et redonner une forme de normalité à la politique étrangère des États-Unis.
Les débuts de la présidence de Barak Obama se déroulent et référence au modèle de Franklin Roosevelt, parvenu lui aussi à la Maison-Blanche en 1933, au plus fort d’une crise économique largement comparable à celle de 2008. Le parallèle est également possible avec la période qui commence à la mort de Kennedy, sous la présidence Johnson lorsqu’il faut à la fois réconcilier la construction de l’État-providence et la conduite de la guerre du Vietnam au nom de la lutte contre le communisme. La guerre d’Afghanistan dont hérite Barak Obama, mais qu’il souhaite étendre, au nom du principe d’une guerre juste, sera dans une certaine mesure le boulet qui aurait empêché de mener jusqu’au bout les réformes sociales, notamment pour ce qui concerne l’assurance-maladie. D’après les auteurs de l’ouvrage, la référence à Roosevelt, à Johnson, et dans une moindre mesure
Dès son arrivée au pouvoir, par l’intermédiaire des mouvements tea parties, les conservateurs font clairement entendre qu’ils veulent que Barak Obama soit le président d’un seul mandat. La radicalité de la campagne pour les primaires républicaines en cours le montre très nettement.
Coton à ce que l’on pourrait croire, la vie politique aux États-Unis et violente. Les franges radicales de la droite républicaine contestent au président sa légitimité constitutionnelle à la magistrature suprême en entretenant un débat délétère sur l’authenticité de sa citoyenneté.
La crise héritée de l’administration précédente que Barak Obama doit affronter est beaucoup plus complexe que celle de 1929. Les conservateurs qui s’opposent aux mesures de réformes proposées par les démocrates développent une rhétorique guerrière et nationaliste que leurs homologues n’avaient pas dans les années 30. Une fois l’enthousiasme de l’élection passé, l’idée selon laquelle les réseaux citoyens qui ont contribué à porter Obama à la Maison-Blanche continueraient de fonctionner et introduiraient un changement de paradigme politique, en faisant pression sur les élus traditionnels, s’est très vite effondrée. Cela a eu pour conséquence un très vif désenchantement qui s’est traduit par un échec aux élections intermédiaires de 2010.
Enfin, les institutions possèdent un pouvoir de contrainte important, et cela est vrai avec la constitution américaine comme avec celle de la Ve République en France qui est pourtant plus « plastique ».
Barak Obama, contrairement à son prédécesseur, ne souhaite pas d’une présidence administrative qui limiterait l’exercice des contre-pouvoirs prévus par la constitution. Il essaye de légitimer le congrès, mais sur les questions capitales comme la santé, la fiscalité, l’immigration, il reste soumis à l’obtention d’un compromis, avec un congrès qui devient en partie hostile à partir de 2010, le tout sous le contrôle d’une cour suprême dont l’équilibre idéologique ne s’est pas trouvé modifié depuis la dernière nomination du président Bush en 2006.
Dans le domaine de la politique étrangère, la question de la guerre a été traitée sous l’angle de la responsabilité. Il faut savoir terminer une guerre, serait le mot d’ordre d’un président démocrate, alors que les précédentes guerres dans lesquelles les États-Unis sont intervenus, guerre de Corée égard du Vietnam ont été commencées à par des démocrates mais terminées par des républicains. Il est clair qu’en ce qui concerne les républicains en Irak comme en Afghanistan, on ne voyait pas dans leur proposition de campagne pour 2008 deux termes clairement affichés ou de conflit dans lesquelles les États-Unis étaient engagés.
Le président Obama a fait le choix, notamment en Libye lors de l’intervention militaire occidentale contre Kadhafi d’une action limitée, de soutien à l’OTAN, dans un contexte où les États-Unis ne jouent pas un rôle de premier plan. De la même façon, la poursuite de l’objectif d’élimination « chirurgicale » de Bin Laden, objectif atteint en 2011, est caractéristique d’une posture moins spectaculairement guerrière que celle des culottes de peau républicaines.
Dans la politique proche-orientale, le discours du Caire le 4 juin 2009 a suscité un grand espoir mais celui-ci a été vite déçu par l’intransigeance du gouvernement Israélien. La pression exercée par les groupes de pressions pro Israélien, surtout à partir des élections de la mi-mandat a été extrêmement efficace.
Très clairement l’un des auteurs des différentes contributions qui composent l’ouvrage, Justin Vaïsse, parle de l’Europe reléguée de Barak Obama. Cela se traduit par une intervention beaucoup plus modeste dans les affaires européennes, par une sorte d’indifférence à l’égard de la France, même si l’actuel locataire de l’Élysée a essayé dans le cadre de sa précampagne présidentielle d’instrumentaliser ses relations avec le « chef du monde libre ».
Dans le domaine de la politique intérieure et dans le cadre de cette présentation, quelques mots rapidement sur les politiques sociales et la réforme de l’assurance-maladie, dans un article de Maurizio Vaudagna. La réforme du système américain d’État-providence intégrant une assurance-maladie efficace et complète est l’un des buts des démocrates et des progressistes depuis les années 30. Très clairement, la réforme de Barak Obama, et avant cela la tentative de Bill Clinton, s’inscrit dans la recherche d’une troisième voie entre le public et le privé, la libre concurrence la régulation, le marché l’État. Très clairement, cette politique nouvelle apparaît comme moins généreuse que les modèles proposés au lendemain de la seconde guerre mondiale d’État-providence par l’administration Truman, tout comme en France et en Angleterre. Cette fois-ci, les personnes bénéficiant de l’assistance et des aides sociales se voient imposer des contreparties. À la veille de l’élection de Barak Obama, une réforme de l’assurance-maladie aux États-Unis devient inévitable. Le nombre d’Américains sans assurance-maladie continue de croître au rythme de 1 million par an et le prix des assurances privées ne cesse d’augmenter. La population des États-Unis est très ambiguë à propos de ce projet. Elle semble y être favorable sur le principe mais ne semble pas prête à en payer le coût en matière de régulation et surtout d’augmentation des impôts que cela implique. L’opposition entre démocrates et républicains sur cette question se situe entre la responsabilité personnelle, pour les républicains qui considèrent que faire appel à l’aide de l’État est un signe de faiblesse, et la responsabilité partagée qui repose sur la collaboration de l’individu, de l’employeur, et enfin de l’État. Au final, l’État a pu intervenir en imposant des limitations aux mesures restrictives des caisses d’assurance-maladie, qui ne peuvent plus imposer des limites d’âge et autre plafonds de remboursement est défini certaine prestation essentiel pour lesquelles aucune participation ne peut être exigée. La réforme a certes amélioré la situation d’une partie de la population, en conservant un service public de santé pour les pauvres, les personnes âgées et les enfants. L’État impose son contrôle l’obligation de souscrire un assurance-maladie, en offrant des subventions et des incitations, et en encadrant la compétition de marché. Mais ces assurance-maladie alternatives ne permettent pas d’atteindre les buts égalitaires de protection sociale publique puisque la qualité de la police d’assurance des soins médicaux dépend encore pour une large part des revenus des assurés.
Les pertes en termes de sièges au congrès pour Obama en 2010 ont démontré à quel point la réforme de l’assurance-maladie était devenu un enjeu extrêmement partisan.
Au moment où le président Obama a commencé sa campagne pour sa réélection, il bénéficie davantage des divisions du camp républicain que d’une adhésion franche et massive à ses projets. Toutefois, la brutalité de la campagne pour les élections primaires dans le camp de ses adversaires, devrait lui faciliter la tâche. Mais il est clair qu’il aura un bilan à assumer, et que celui-ci est qualifié par les 15 auteurs des différentes contributions qui composent cet ouvrage, de bilan en demi-teinte, ce qui nous ramène à l’éternelle opposition entre le verre d’eau à moitié plein et à moitié vide.