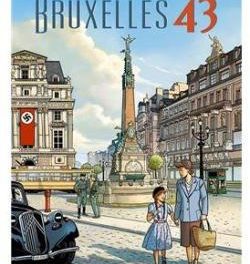« Le « moment » est cet instant du temps où l’avenir semble hésiter et où, finalement, l’histoire bascule vers un futur que les choix du présent engagent sans en mesurer tous les développements ». Refusant les narrations téléologiques qui « rendent impossible la compréhension des contemporains », les organisateurs du colloque ont voulu, selon l’expression d’Antoine Prost, « rendre à l’année 1940 son incertitude ». Ils ont donc privilégié « les moments où l’histoire bascule, les décisions qui orientent l’avenir, à l’insu parfois de leurs auteurs, les commencements de Vichy et de la Résistance ».
Le second axe du colloque était de « rechercher l’articulation entre le national et le local, en jouant sur les échelles d’analyse ». il s’agissait de saisir « le moment 1940 » à la fois par en-haut, en analysant les événements politiques, et par en-bas, en étudiant les réalités locales et départementales, celles du Loiret, département ordinaire, plus agricole qu’industriel, mais aussi département qui fut un objectif militaire pour ses ponts sur la Loire et, de ce fait, gravement sinistré, département, enfin, où s’installe comme préfet un ingénieur des ponts et chaussées pionnier dans les plans urbains de reconstruction des villes détruites.
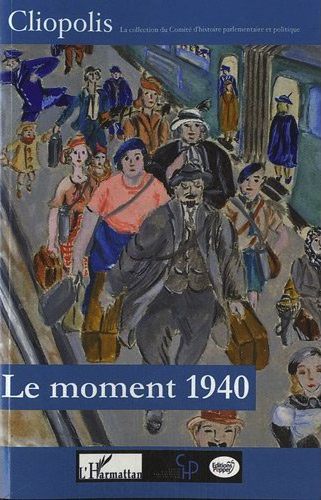
Les actes publiés aujourd’hui comprennent 19 chapitres répartis en quatre parties : l’étrange défaite, la mort de la République, Vichy et l’Anti-France, un département à l’heure allemande. S’y ajoutent une brève introduction, une conclusion, trois index (noms propres, noms de lieux, thèmes) et une chronologie.
Stanley Hofman a qualifié cet ouvrage posthume d’« analyse la plus pénétrante et la plus juste de notre défaite ». Marc Bloch veut comprendre, mais il veut aussi témoigner pour les Français qui devront en tirer les leçons. L’ouvrage se compose de deux parties : le témoignage et les réflexions du militaire (mobilisé à sa demande, Marc Bloch a charge du ravitaillement en essence de l’armée du Nord) ; l’examen de conscience du citoyen.
Avec une lucidité forte Marc Bloch démontre que la défaite militaire a des causes exclusivement militaires : erreurs stratégiques, incohérence de la doctrine, insuffisance et défaillance des hommes et surtout des chefs. Ils sont incapables de s’adapter, paralysés devant l’imprévu, aveuglés par la doctrine de l’École de guerre (analyse qui rejoint celle faite par de Gaulle 15 ans plus tôt déjà). La lourdeur administrative dilue les responsabilités. Les capitaines, commandants et colonels sont gâtés par 20 ans de vie de garnison ; les généraux sont vieillis et leur pensée sclérosée ; ils sont aussi au plus haut niveau (Pétain et Weygand) rongés par « l’esprit de parti et les basses ambitions politiques ».
Mais les responsabilités sont aussi à chercher dans les profondeurs de la société française : fléchissement de l’esprit citoyen (« épargner le sang des jeunes » comme le veut Daladier relève selon lui « d’une pitié un peu molle »), oubli par les syndicats ouvriers des intérêts nationaux, « palinodies » du parti communiste, pacifisme des instituteurs (qui « ont travaillé inconsciemment à faire des lâches »), médiocrité et perversité de la presse, immense faillite de la bourgeoisie qui se laissa aveugler par le parti pris, désespéra de la patrie et finit par estimer naturel que la France soit battue.
La critique est cruelle souligne l’auteur, mais n’est pas un réquisitoire, c’est un constat. Il s’agit dit-il « d’un livre magnifique, la meilleure incitation à une compréhension du désastre ».
François Cochet (Université de Metz). La campagne de France
François Cochet insiste plus particulièrement sur quelques points mis en évidence par le renouveau historiographique impulsé par les historiens étrangers ; l’essentiel étant de montrer que la défaite n’était pas inéluctable.
A partir de 1926 on pense la ligne Maginot ; son objectif est de couvrir la mobilisation et d’amener les Allemands à attaquer la France par la Belgique. Il s’agit d’économiser des hommes, mais on y consacre trois armées entières. Gamelin ne veut pas prendre l’offensive, il veut attendre, aller chercher les Allemands en Belgique avec 10 divisions dont cinq britanniques ; mais il ajoute la variante Breda qui nécessite trente divisions et comporte de grands risques.
Côté allemand, rien n’est joué d’avance. Les premiers plans prévoient effectivement d’attaquer par la Belgique et ce plan initial est repoussé à 30 reprises car beaucoup d’officiers sont réticents à attaquer la France. Le plan Manstein-Guderian n’est adopté que le 13 février (c’est un choix de Hitler qui illustre le processus de décision typique de la dictature par sa rapidité).
Les forces s’équilibrent en ce qui concerne les blindés et les chars français sont d’excellente qualité. C’est la doctrine d’emploi qui va faire la différence. Les manques français sont à chercher dans l’aviation, l’artillerie antichar et antiaérienne, les transmissions (catastrophiques, on se méfie du phonique), la logistique (ravitaillement en essence par camions-citernes), les moyens de franchissement. Mais il y a des manques allemands aussi : des munitions pour trois mois au plus ; la mainmise sur les Sudètes fut essentielle car le matériel saisi permit aux Allemands d’équiper quinze divisions.
Une succession de miracles côté allemand et de nombreuses occasions manquées côté français (ne pas exploiter l’information de la concentration de blindés dans les Ardennes ; ne pas attaquer les Allemands sur leur flanc quand ils foncent vers la Somme) permettent de comprendre la défaite.
Il reprend à son compte les thèses de l’historien allemand Karl-Heinz Frieser (Le Mythe du Blitzkrieg) qui affirment que le Blitzkrieg fut moins le résultat d’une préparation que le fruit des événements sur le terrain et du zèle de quelques généraux (tels Heinz Guderian ou Erwin Rommel). Il insiste sur l’énorme concentration de feu à Sedan qui fait penser à Verdun le 21 février 1916 : 600 avions sur sept kilomètres de front écrasent deux divisons françaises.
On observe des cas de combativité forte côté français et des cas de panique côté allemand. Les chefs français sont défaillants et commandent trop loin de leurs troupes ; les chefs allemands sont réactifs ; ils ont été formés à prendre des responsabilités et des initiatives.
Marie-Claude Blanc-Chaléard (Paris X Nanterre). Les étrangers dans l’armée
La France compte plus de 2,5 millions étrangers en 1939 ; de nombreux réfugiés républicains espagnols sont arrivés depuis peu. Beaucoup de ces étrangers « veulent en découdre » ; ils veulent défendre la France qui les a accueillis ; ils veulent combattre le nazisme. La communication porte essentiellement sur les étrangers qui ont souscrit un engagement volontaire dans l’armée française en 1939. Ils furent près de 80 000.
Ce type d’engagement a été prévu et des décrets d’avril et mai 1939 ont créé des régiments de marche de volontaires étrangers (RMVE), afin de permettre une incorporation qui ne soit pas dans la Légion. « Le processus de l’engagement est apparu très vite comme une machine à contraindre et à décourager les étrangers ». Les cadres de l’armée sont fortement xénophobes et se méfient de ce potentiel « ennemi de l’intérieur », souvent juif et subversif ! Les engagements vont se faire dans la Légion, dans des compagnies de prestataires (qui ne combattent pas) ou dans deux RMVE principalement (un 3e était en cours de création et un 4e fut envisagé).
Les moins mal vus par l’Armée sont les Espagnols ; ils constituent une part importante des engagés volontaires ; les Allemands et assimilés restèrent dans des camps dans des conditions indignes. Globalement, un tiers des engagés furent espagnols, un tiers furent des juifs d’Europe centrale, le dernier tiers rassemble des dizaines de nationalités.
Les Polonais furent regroupés à Coëtquidan et les Tchèques à Agde. Le 21e et le 22e RMVE furent constitués au camp de Barcarès avec 10 000 hommes de 40 nationalités, surtout espagnols et juifs. Ils étaient mal équipés, n’avaient presque pas d’armes et ne reçurent que très peu de formation militaire ; par dérision les Allemands les appelèrent les « régiments ficelles ». Antisémitisme et xénophobie des cadres de l’Armée rendirent l’ambiance délétère.
Quand ils furent engagés (à Narvik et sur quelques lieux de la bataille de France), ils combattirent et eurent de fortes pertes. Les Espagnols que les Allemands firent prisonniers se virent refuser le statut de combattants et furent déportés à Mauthausen où ils arrivèrent dès le 6 août 1940. Beaucoup de prisonniers juifs furent envoyés dans les Stalags et échappèrent à la solution finale.
Philippe Nivet (Université Jules Verne de Picardie). Les populations civiles : le cas de la Somme en 1940
Abbeville est bombardé le 10 mai, Amiens le 18 puis le 19 mai. Une évacuation massive des populations n’avait pas été prévue ni même envisagée (en dehors d’un plan de dispersion de la population amiénoise), au contraire le département devait accueillir et organiser le transit des populations du Nord et du Pas-de-Calais. Le 17 mai, le général commandant la Place d’Amiens lance un appel au calme et refuse au préfet un ordre d’évacuation. Le 19 mai, les autorités civiles appellent la population à rester en ville et à continuer ses activités. On observe la différence avec mars 1918 : Amiens avait alors été bombardé et l’administration municipale avait facilité les départs. Mais dans la nuit du 19 mai, certaines autorités quittent la ville, ce qui est perçu comme un abandon par la population. C’est le début de l’exode : la population part vers l’Ouest, par des itinéraires aléatoires. Beaucoup iront jusqu’à Lorient où les relations avec la population bretonne seront bonnes (à la différence de ce qu’elles furent lors de la Première Guerre mondiale comme l’a montré Philippe Nivet dans une étude, Les Boches du Nord). 5000 Amiénois seulement restent en ville.
Le retour est encouragé sitôt l’armistice signé mais il se heurte à des obstacles nombreux ; le plus pénible étant l’interdiction par l’occupant des retours dans ce qui est devenu la zone interdite, au nord du département. Des camps d’accueil firent ouvert sur la limite de cette zone, et des filières de passage clandestin s’organisèrent. En novembre 1940, 83% de la population était rentrée. De fortes tensions apparurent entre ceux qui revenaient et ceux qui étaient restés. Les premiers eurent tendance à accuser les seconds d’avoir pillé leurs domiciles. Or ceux qui étaient restés avaient travaillé au déblaiement des ruines et considéraient ceux qui étaient partis comme de lâches fuyards.
Philippe Tanchoux (Université d’Orléans). Le sort des collections des musées nationaux en 1940
Diverses conventions protègent les biens culturels. Des projets d’évacuation ont été élaborés, avec transport par la route en direction des châteaux du Val de Loire. En 1939, on évacue avec succès : 51 convois acheminent des œuvre d’arts vers Chambord qui sert de « gare régulatrice », puis Cheverny, Valencay et d’autres lieux dans l’Orne, la Sarthe etc. Mais l’invasion va au-delà de ce qui avait été envisagé et il faut évacuer plus au sud. L’objectif des autorités françaises est au premier semestre de 1940 de sauver les œuvres d’art de la destruction, au second semestre il est de les sauver de l’appropriation allemande. Mais l’attitude ambiguë de Vichy est signalée à l’égard des collections juives.
Seconde partie : La mort de la République
Serge Berstein (IEP Paris). Le gouvernement de Pétain du 16 juin au 10 juillet 1940
Le 16 juin 1940, la défaite est acquise. Le gouvernement a quitté Paris pour les châteaux de la Loire puis pour Bordeaux. Paul Reynaud est président du conseil depuis mars. Il est dépourvu d’autorité (il a été investi avec une voix de majorité, après qu’Herriot ait procédé à quelques corrections…) ; il est dépourvu de majorité (sa majorité repose sur le parti radical qui ne lui pardonne pas d’avoir évincé Daladier, homme fort du gouvernement) ; il est virtuellement démissionnaire (il a donné sa démission le 9 mai et l’a reprise le lendemain en apprenant l’offensive). Il a procédé à deux remaniements en faisant entrer deux hommes supposés incarner la victoire (Pétain et Mandel) et a nommé un nouveau généralissime (Weygand). Le Parlement s’est ajourné le 5 juin.
Au sein du gouvernement, les débats portent sur l’issue à donner à la défaite : faut-il que l’armée capitule, laissant libre le gouvernement de continuer la guerre, y compris depuis l’Afrique du Nord, ou faut-il demander l’armistice. Dans le premier cas les militaires endossent la responsabilité, dans le second, ce sont les politiques : c’est évidemment la position de Pétain et de Weygand. A Bordeaux, Laval et Adrien Marquet (le maire de Bordeaux) aidés de quelques autres appuient la position de Pétain. C’est Camille Chautemps qui va donner le coup de grâce aux partisans d’une continuation de la guerre, en proposant que soient demandées aux Allemands les conditions de l’armistice, et en soutenant qu’elles seront tellement insupportables, que la décision de continuer la guerre s’imposera à tous !
Reynaud démissionne ; il aurait plaisanté en proposant à Lebrun de choisir Pétain pour son successeur ; toujours est-il que Lebrun suit le conseil et est ravi de voir Pétain sortir une liste de ministres déjà prête ! Il s’agit en apparence d’un gouvernement de défense nationale qui va du PSF (Ybarnégaray) à la SFIO (deux socialistes, avec accord de Blum). En réalité, les forces politiques sont disloquées ; le 22 juin Pétain fait entrer Laval et Marquet, demande les conditions d’armistice et annonce qu’il faut cesser le combat. « Tout est joué, plus rien ne s’oppose à l’avancée de la Wehrmacht ».
S. Berstein insiste sur l’acharnement des chefs militaires à s’exonérer de toute responsabilité dans la défaite et à la faire porter sur les politiques ainsi que sur leur volonté obstinée de refuser tout combat hors de la métropole et d’accepter l’armistice quel qu’en soit le prix. Il affirme la thèse du complot contre la République : il fallait empêcher le départ des pouvoirs publics en Afrique du nord car c’est alors vers eux que se serait déplacée la légitimité républicaine et il serait alors devenu impossible de transformer les institutions. La mort de la IIIe République était dès lors programmée et les manœuvres politiques dans les jours qui précèdent le vote du 10 juillet eurent pour but « d’installer en France un régime de type fasciste collaborant avec l’occupant ».
Antoine Prost (Professeur émérite d’histoire contemporaine. Centre d’Histoire sociale du XXe siècle, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne). La controverse juridique : 16 juin ou 10 juillet
Antoine Prost propose un changement de perspective, une relecture juridique de l’événement : la République est-elle morte dès le 16 juin ou seulement le 10 juillet ? Il pose d’abord le fait qu’en droit positif, tout gouvernement est légitime, la question de la légitimité du gouvernement Pétain ne se pose donc pas. En droit naturel, il est possible de distinguer le caractère légal du caractère légitime. Un gouvernement peut sortir de la légalité tout en restant légitime.
Quand est-on sorti du cadre républicain ? Le 11 juillet 1940 à coup sûr quand Pétain promulgue ses actes constitutionnels ; le gouvernement est illégal et illégitime (la loi de 1884 affirme que la forme républicaine ne peut faire l’objet d’une révision). Les deux votes du 9 et du 10 juillet 1940 ont respecté les formes constitutionnelles (il y a lieu de réviser la constitution décident les deux Chambres par deux votes séparés, puis l’Assemblée nationale vote le texte confiant à Pétain les pleins pouvoirs constitutionnels). On peut en contester la légalité avec deux arguments : les pressions exercées sur les députés d’une part, le fait que les parlementaires n’avaient pas le droit de se débarrasser du pouvoir constitutionnel. C’est donc la façon de réviser la constitution qui est en cause.
C’est René Cassin qui, en 1943, a défendu la thèse qui fait remonter au 16 juin la fin de la légalité républicaine. Le 10 juillet résulte du complot d’un gouvernement nommé le 16 juin. Ce gouvernement a demandé et signé l’armistice. La signature de l’armistice est un acte de trahison qui soumet la France et son gouvernement aux exigences du vainqueur. Cet acte de trahison rend illégal le gouvernement qui l’a commis. « Pour les Français libres qui poursuivent la lutte, et pour les résistants qui la reprennent, il est indispensable que l’armistice soit illégal, sinon leur combat ne serait qu’une rébellion dépourvue de toute légitimité. » Si l’armistice était légal, les résistants seraient des francs-tireurs et les Allemands auraient le droit de les fusiller. La date du 16 juin est « une fiction juridique politiquement nécessaire » car elle légitime le choix de ceux qui ont refusé de cesser le combat
Robert Franck (Paris I Panthéon-Sorbonne). Le gouvernement de Vichy sous le regard des étrangers
L’émotion est générale à la nouvelle de l’effondrement de la France. C’est une rupture de l’équilibre européen et international. La réaction première et générale en apprenant l’effondrement c’est la compassion, la pitié, la surprise, la déception, voire la colère. « Une lumière qui se voile » dit un diplomate étranger. En Roumanie (qui est alors dépecée), il y a des manifestations hostiles devant les consulats allemand et italien et des manifestations de soutien devant les consulats français et britannique. Aux Etats-Unis, on a d’emblée peur pour le Royaume-Uni. Il est intéressant d’observer que les États étrangers n’auront pas de compassion pour les morts de Mers el Kébir et que par la suite on craindra de voir le gouvernement venir s’installer en zone occupée. Roosevelt estime que Montoire menace 160 ans d’amitié franco-américaine. L’Italie, l’Espagne et le Japon craindraient plutôt de voir la France trop favorablement traitée.
R. Franck montre que le gouvernement de Vichy a mené une politique de l’image en envoyant des argumentaires aux ambassadeurs et consuls qui devaient s’en inspirer pour promouvoir l’image de la France. Trois thèmes sont défendus : la France est souveraine, elle n’est pas inféodée à l’Allemagne ; ses institutions sont originales et ne sont pas une copie de celles des dictatures ; le statut des Juifs est une nécessité car les Juifs ont « une mentalité particulière », et doivent être éloignés de certaines carrières (l’argumentaire affirme même que le statut les protège d’un antisémitisme violent !). R. Franck conclut en disant que Vichy a perdu la bataille de l’opinion à l’étranger dès la fin de 1940, mais que de Gaulle est loin de l’avoir gagnée.
Olivier Loubes (classes préparatoires littéraires Toulouse). Le procès de Jean Zay. Faire justice de Vichy année 1940
Jean Zay était natif d’Orléans et député du Loiret. Ses filles ont récemment confié les archives de Jean Zay aux Archives nationales. Olivier Loubes, élève de Pierre Laborie, travaille depuis 20 ans sur Jean Zay.
Jean Zay avait été arrêté une première fois le 17 juin 1940 et relâché le 18 avec une lettre d’excuses de Pétain ; arrêté au Maroc le 8 août, il avait bénéficié d’un non lieu devant le tribunal militaire de Mekhnès. Il est condamné le 4 octobre 1940 par un tribunal militaire, après une très courte délibération pour « désertion en présence de l’ennemi ». C’est le « premier procès politique réussi par Vichy », en effet celui de général de Gaulle s’est déroulé en l’absence de l’accusé et celui de Mandel a débouché sur un non lieu. Le procès de Jean Zay a laissé peu de place dans la mémoire collective, « il n’a pas eu accès à une reconnaissance de type universalisante ».
Le procès s’est déroulé dans une apparente légalité et dans le respect des règles de l’instruction ; mais la condamnation était programmée. Olivier Loubes montre les trois dimensions de ce procès : un procès militaire pour désertion (il n’y a rien dans le dossier , comme Vichy ne veut pas parler du Massilia que Jean Zay voulait rejoindre, on l’accuse de désertion en présence de l’ennemi ce qui, juridiquement, permet de le condamner sans parler de ce qui se passera après) ; c’est le procès du parlementarisme et du Front populaire dont Jean Zay a été ministre ; c’est un procès devant l’opinion, pour exclure du corps social un franc-maçon et un juif.
Ce procès permet d’expliquer la défaite (les vrais responsables sont les politiques républicains, juifs et francs-maçons), de reconstruire l’union nationale (en stigmatisant l’ennemi de l’intérieur), de légitimer Vichy (Vichy existe parce qu’il légifère).
Troisième partie : Vichy et l’Anti-France
Jean-Pierre Azéma. L’évolution du régime du 10 juillet au 24 décembre 1940
Durant l’été Vichy doit gérer les retombées de la convention d’armistice, voir partir les prisonniers, supporter la ligne de démarcation. Vichy proteste, palabre, gémit… en vain. Il faut ancrer le régime nouveau. Vichy improvise deux créations : les Chantiers de la jeunesse et les Comités d’organisation.
Un régime se met en place qui est autoritaire, xénophobe, répressif, mais qui n’est pas fasciste (refus de la guerre et de l’expansion territoriale, refus du parti unique). Il s’agit d’une variante d’un régime autoritaire à fondement charismatique.
La Révolution nationale est un pot pourri de maurrassisme, de « nationalisme révolutionnaire », de catholicisme intransigeant, de non conformisme des années 1930. Vichy condamne l’individualisme, rejette l’égalitarisme, pratique un nationalisme fermé, installe le corporatisme, forme des chefs.
Vichy est un régime xénophobe qui pratique l’exclusion, l’antisémitisme d’Etat et ouvre des camps d’internement. Il bénéficie du soutien de l’Eglise catholique. C’est Pétain qui donne l’impulsion décisive à la collaboration d’Etat, moins durant l’entrevue (où il n’a pas dit grand-chose) que dans son message du 30 octobre. Il a réfléchi six jours et s’est engagé clairement dans la voie qui lui permet de mener la Révolution nationale. A la fin de l’année 1940, les bases sont bien mises en place d’un régime autoritaire, répressif, anticommuniste, xénophobe et de collaboration politique.
Pierre Allorant (Université d’Orléans). Reconstruction nationale et urbanisme technocratique : l’action pionnière du préfet Morane
Le préfet arrive dans un département détruit par les bombardements. Son action va s’inscrire dans un double objectif : résorber le chômage par le déblaiement et la reconstruction, utiliser l’opportunité des destructions pour reconstruire en innovant et en rénovant.
P. Allorant qualifie Morane d’ingénieur de la « reconstruction nationale ». Il a derrière lui une carrière qui le prépare à cette tâche de reconstruction : il est ingénieur des Ponts, il a travaillé sur les ponts de la Seine, il a fait partie de l’entourage de Raoul Dautry. Il fait venir à ses côtés une escouade de jeunes urbanistes et architectes. L’équipe est soudée et enthousiaste, elle prépare des plans d’aménagement et souhaite la création d’un ministère de l’Urbanisme. Il s’efforce, avec son collaborateur Jean Royer, de convaincre l’opinion publique : il pratique un « urbanisme de la persuasion » afin de lui faire accepter un urbanisme plus moderne, une reconstruction qui ne soit pas à l’identique. Il ouvre un concours d’idées pour la reconstruction du Val de Loire, fixant dans le cahier des charges l’emploi de matériaux régionaux et l’appel à l’artisanat local.
Les plans de reconstruction prévoient de préserver le patrimoine pittoresque des petites villes du Val de Loire : il s’agit de mettre à profit les destructions. L’ambition est plus grande et s’inscrit dans le cadre de la Révolution nationale : la reconstruction doit être « totale, matérielle et morale », il faut lutter contre la macrocéphalie parisienne, restaurer la fierté locale et provinciale. Il s’agit enfin de reconstruire Orléans pour fonder la région. Il veut faire du neuf avec un centre ville détruit sur 17 hectares ; le parcellaire ancien ne sera pas restauré, ce qui n’est pas facile à faire admettre à une population qui veut retrouver ses rues. Mais il faut, dit le préfet, « dépasser l’égoïsme des propriétaires » et faire prévaloir l’intérêt public.
P. Allorant conclut en qualifiant ces projets de régionalistes, technocratiques et antidémocratiques… projets qui seront repris dans les années 1960.
Annette Wieviorka (CNRS, UMR-IRICE Paris I Panthéon-Sorbonne). Le parti communiste français en 1940
Il n’est pas possible d’inscrire l’action du PCF, qui est la « Section française de l’internationale communiste dans une chronologie strictement française. Pour le parti communiste, il n’y a pas de « moment 1940 », il se situe entre deux « moments », celui du pacte germano-soviétique (août 1939) et celui de l’entrée en Résistance (juin 1941).
« Surprise et trouble assez profond » écrit Thorez dans ses carnets en apprenant la signature du pacte ; il faut « se taire » dit Mounette Dutilleul, une militante proche de Thorez, et aussi mentir ajoute A. Wieviorka. Dans un premier temps, rien ne transparaît de ce trouble et le parti reste sur une ligne antifasciste. Les députés votent les crédits militaires, les militants obéissent à la mobilisation : Guyot revient pour cela de Moscou, Thorez part ainsi que tous les cadres intermédiaires qui sont alors jeunes. Le 7 septembre Dimitrov, Staline et Molotov rédigent une directive du Komintern définissant la guerre comme impérialiste et ne concernant pas les communistes. Le PCF qui a voté les crédits de guerre doit inverser sa politique. Le PCF adopte la nouvelle ligne. Il est interdit le 26 septembre et la répression s’abat sur lui.
Thorez se trouvait bien aux armées et aurait sans doute souhaité y rester. C’est pour éviter l’arrestation que son entourage vient le chercher le soir du 3 octobre. Il aurait pu rester à Bruxelles ; c’est Fried, représentant du Komintern qui craint son arrestation et qui insiste pour qu’il soit appelé en URSS.
Une négociation secrète est menée par Tréand, en plein accord avec Duclos, avec Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne à Paris, pour faire paraître légalement un journal communiste. Thorez désapprouve. Mais il est néanmoins sur une ligne attentiste, comme en témoigne le « fameux appel du 10 juillet 1940 ». Ce texte n’a rien à voir avec un appel à la résistance, comme l’a longtemps affirmé le PCF. Il stigmatise les responsables de la défaite, prône une révolution sociale et n’appelle pas à la lutte contre l’occupant.
Alya Aglan (Paris X Nanterre, IEP Paris). La Résistance, année zéro
Le refus des premiers résistants est multiforme, désordonné, sporadique ; ils ont une impression de solitude. A. Aglan évoque les petits groupes qui forment une nébuleuse et énonce leurs actions : rédaction et diffusion de papillons, de tracts et de journaux, les premiers sabotages. Elle cite les toutes premières missions de la France libre. Les Allemands prennent ces actions au sérieux et réagissent rapidement. Elle propose de définir cette première résistance comme un « réflexe de survie, appuyé sur la conscience d’un passé partagé, porteur d’un projet d’avenir qui s’esquisse chemin faisant et qui choisit des formes opérationnelles en fonction des priorités du moment ».
Quatrième partie : Un département à l’heure allemande
Gaël Eismann (Université de Caen-Basse Normandie). Les Allemands dans le Loiret en 1940
Gaël Eismann a soutenu une thèse de doctorat, sous la direction de Jean-Pierre Azéma, en 2005 à l’IEP de Paris. Cette thèse a éét éditée chez Tallandier sous le titre Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée (1940-1944). Fondé sur les archives allemandes de l’Occupation, ce livre étudie le rôle du Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) qui est la pièce centrale du système d’occupation allemand, installé à Paris, à l’hôtel Majestic.
Pour la période qui va de l’invasion à l’armistice, elle s’appuie sur les travaux d’Yves Durand : les forces allemandes en campagne vivent sur l’habitant, procèdent à des réquisitions et commettent des exactions. Par la suite, les troupes d’opération restent aux points stratégiques avec des effectifs en diminution continuelle. Le MBF qui se met en place exerce les droits de la puissance occupante, contrôle et surveille l’administration et l’économie. Il superpose son administration à la pyramide de l’administration française. Le département du Loiret est le siège d’une Feldkommandantur établie à Orléans et de deux Kreiskommandanturen à Orléans et Montargis. Il y a 8 à 18 fonctionnaires dans les Feldkommandanturen, selon les départements, le personnel des Kreiskommandanturen se limite à l’état-major du commandant.
Le maintien de l’ordre et la répression sont assurées par des troupes de sécurité, la Feldgendarmerie (une trentaine d’hommes), la GFP à partir de novembre 1940. Dès août 1940 s’installe une antenne du SIPO-SD avec une mission de surveillance de l’opinion publique. Les Allemands interviennent immédiatement pour réprimer tout acte de résistance naissante. Un tribunal militaire siège dans le département. La répression est très forte dès le début de l’occupation.
Benoit Verny (classes préparatoires littéraires Orléans). L’arrivée du préfet Morane à Orléans
Jacques Morane n’est pas un politique, il n’est pas de la carrière. C’est un polytechnicien, un ancien de l’école des Ponts, un technocrate. Il arrive le 25 juin dans un département qui a souffert des bombardements et où les moyens de communications sont inexistants, c’est le chaos et il se montre « un technocrate hyperactif ». Il négocie avec les Allemands (dont il parle la langue) pour débloquer des stocks alimentaires, obtenir de l’essence etc. Il mobilise la population, s’appuie sur des ingénieurs, des élus municipaux, publie quatre numéros d’un bulletin d’information. Son activité est efficace dans la mesure où le retour à la normale est assez rapide.
Il fait l’apprentissage de la politique et implante le régime de Vichy. Il exerce une forte influence sur les maires ; ses rapports (il reste jusqu’en octobre 1942) montrent son manque de culture et la force de ses préjugés. Il fait aussi l’apprentissage de la collaboration : d’abord une collaboration d’urgence, ensuite un progressif renoncement devant les exigences allemandes. De renoncement en renoncement, il accepte l’inacceptable.
Jean-Marie Flonneau (ancien professeur classes préparatoires littéraires, Orléans). Entreprises et populations face aux restrictions dans le Loiret
En 1939, le Loiret est un département agricole et rural de 344 000 habitants, en cours d’industrialisation et d’urbanisation (Orléans compte 94 000 habitants et Montargis 27 000). 43% de la population active est encore employée dans le secteur primaire ; une vingtaine d’entreprises emploient plus de 100 salariés. Durant la drôle de guerre, pour les entreprises et pour la population, la situation reste proche de la normale : le rationnement est encore peu perceptible. La population n’a pas été préparée aux moments difficiles qu’elle va vivre.
Puis c’est le choc de l’invasion et des bombardements, le département compte 13 700 prisonniers de guerre. Les Allemands ont la volonté de remettre l’économie en route rapidement ; quelques initiatives locales et celles de l’administration préfectorale vont dans le même sens. Le rationnement se met en place de manière irrationnelle, sans plan d’ensemble. Vichy pratique le dirigisme avec tâtonnement. A l’automne 1940, les prélèvements et les achats allemands sont encore limités. L’auteur présente les différentes catégories de la population et quelques exemples de ration. A la fin de l’année la ration moyenne ne fournit que 1220 calories. La part de l’alimentation dans le budget des familles est alors de 50 à 70% mais 30% des familles ne peuvent s’alimenter suffisamment. Ces restrictions brutales sont un vrai traumatisme.
Les travaux de déblaiement réduisent le chômage. Le préfet affirme que le retour à la normale est effectif à l’automne, mais on observe de grosses différences selon les branches. Plusieurs entreprises pratiquent une « collaboration survie opportuniste ».
Patrick Clastres (classes préparatoires littéraires, Orléans. Centre d’histoire de Sciences Po). Saison sportive et temps de guerre. Un autre récit orléanais pour l’année 1940
Dans les années 1930, le sport connaît une quadruple marginalisation : spatiale (peu de stades, de piscines etc. On fait du sport dans les parcs, les forêts, les bords de Loire, les terrains vagues etc.), temporelle (on pratique le dimanche et pendant une saison qui varie selon les sports), sociale (pratique de jeunes, pas de vétérans, sports différents selon les classes sociales), culturelle (peu de place accordée au sport dans la presse).
Il y avait à Orléans une trentaine de sociétés sportives se réclamant de la neutralité, une quinzaine relevant des patronages de France et quelques sociétés se réclamant de la gauche et de la laïcité. La mobilisation est un véritable choc car beaucoup de sportifs partent à la guerre. L’espace régional des sports se rétrécit, se replie sur lui-même. On maintient les manifestations sportives jusqu’au dernier moment : le 9 juin seulement on repousse les manifestations prévues ! Et la reprise est rapide : si la saison théâtrale a repris le 13 octobre, les concours de gymnastique ont repris dès le 8 août ! Les patronages catholiques passent à l’offensive et s’efforcent de prendre une influence plus grande.
Eric Cénat (historien, comédien et metteur en scène). Vie et survie du théâtre municipal d’Orléans en 1940
Avant guerre le théâtre provincial traverse une crise profonde. Il y 52 théâtres à Paris et 51 dans tout le reste de la France. Le cinéma est 10 à 20 fois moins cher et bien plus attirant. Le théâtre d’Orléans est exploité par la municipalité et en grave déficit. La saison 1939-1940 est presque normale avec ses 57 représentations ; elle se termine quand survient l’invasion.
Le directeur du théâtre, Léon Niel, choisit de rouvrir le théâtre au prix de lourds sacrifices. La municipalité supprime toute subvention, il doit équilibrer son budget ; les salaires sont diminués de 50 %. Les Allemands favorisent le maintien d’une saison théâtrale et n’exercent pas immédiatement une censure du contenu. Mais le double étau de la censure vichyste et de la censure allemande va se resserrer autour du directeur qui se refuse néanmoins à la démission sans pour autant accepter de « vendre son âme ». Dans ces conditions, la saison 1940-1941 reprend dès octobre et connaît 80 représentations !
L’ouvrage se termine par une courte présentation de Beaugency en 1940, par Jacques Asklune, Président de la Société archéologique et historique de Beaugency, aujourd’hui décédé, puis par une conclusion de Julian Jackson, figure de style imposée qui s’efforce (et parvient) à citer en sept pages toutes les communications !
Par la qualité des intervenants, la précision des informations, la finesse des analyses, la diversité des thèmes abordés, la densité des références bibliographiques, la prise en compte des recherches les plus récentes, « Le moment 1940 » est un ouvrage essentiel.