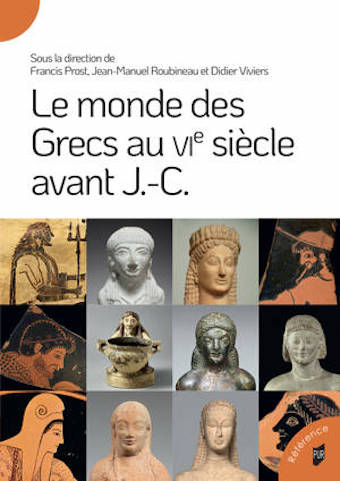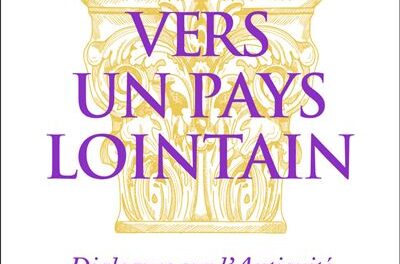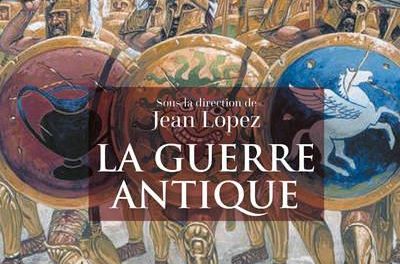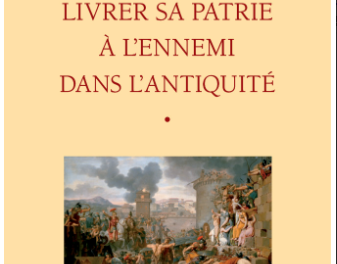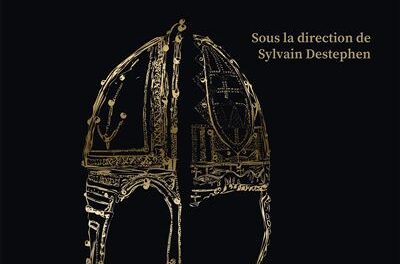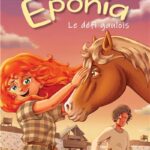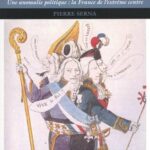Lorsque nous évoquons le monde grec ancien, les premières images qui nous viennent à l’esprit appartiennent à l’histoire de la Grèce classique, c’est-à-dire aux Ve et IVe siècles avant J.-C. Les Guerres médiques et la bataille de Marathon, le développement des cités et leurs aménagements urbains, les rivalités entre Sparte et Athènes lors de la Guerre du Péloponnèse, ou encore des personnages comme Périclès sont autant d’exemples qui nous raccrochent aisément au monde grec ancien. Le VIe siècle, moins connu, « est noyé dans le flot continu des siècles qui l’entourent ». « Survivance d’une époque archaïque finissante » et « antichambre » d’une époque classique glorieuse, le VIe siècle a longtemps été laissé de côté par les savants.
L’une des raisons tient à l’état de la documentation. Face à une « pénurie, même relative », des sources de la tradition manuscrites et de l’épigraphie, les historiens ont préféré porter leur attention sur les siècles suivants. Les archéologues se sont, quant à eux, davantage concentrés sur les siècles antérieurs car la documentation « semble déjà trop importante » pour dresser un tableau uniquement archéologique du VIe siècle. L’autre raison est liée à la périodisation traditionnelle de l’Antiquité, où le VIe siècle se retrouve « coincé » entre une période archaïque et une période classique longtemps présentée comme l’apogée de la culture grecque.
Afin de remédier à cette faiblesse historiographique, Francis Prost, Jean-Manuel Roubineau et Didier Viviers ont dirigé Le monde des Grecs au VIe siècle avant J.-C., paru au Presses universitaires de Rennes en 2024, dans la collection Référence dont l’objectif est de présenter des ouvrages dont l’objet d’étude est abordé de manière exhaustive. Plus d’une vingtaine d’historiennes et d’historiens, qu’ils soient chercheurs, professeurs ou archéologues, ont participé à cette entreprise historiographique.
Un ouvrage ambitieux
À contre-courant des travaux d’historiens et d’archéologues, les auteurs souhaitent montrer à travers cet ouvrage qu’il est possible de réaliser une histoire du monde des Grecs au VIe siècle av. J.-C. en utilisant une grande variété de sources écrites et visuelles. Bien que certaines d’entre elles aient été élaborées aux siècles suivants, les contributeurs ont cherché à « adosser autant que possible les analyses aux documents du siècle lui-même et proposer une lecture du VIe siècle », car les directeurs insistent sur le fait que ce siècle « gagne à être historicisé ». Toutefois, les auteurs ne réduisent pas le VIe siècle à une figure emblématique (Solon, Thalès, Pythagore, ou Clisthène) mais préfèrent parler d’« un long VIe siècle » en se référant à la définition de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Ainsi certaines parties de l’ouvrage présentent un VIe siècle qui peut « durer cent, cent dix ou cent trente ans, et inclure la fin du VIIe siècle et/ou les premières décennies du Ve siècle, en fonction de la logique propre au phénomène historique envisagé dans chaque chapitre ».
Les auteurs ont choisi d’organiser l’ouvrage en trois parties afin d’étudier successivement les communautés à travers les fonctions qui les structurent, les milieux sous l’angle des espaces et des paysages, et enfin les interactions, qu’elles soient économiques, sociales ou culturelles. Toutefois, les auteurs n’ont pas envisagé « d’embrasser tous les aspects du siècle », car l’ambition de l’ouvrage réside avant tout dans « l’évocation d’un ensemble suffisamment cohérent » et non dans la recherche de l’exhaustivité.
Des communautés, des espaces et des interactions
Les historiens commencent par explorer les différents acteurs sociaux du monde grec au VIe siècle av. J.-C. et leurs pratiques spécifiques. Cette première partie présente successivement les figures du paysan et son rapport à la terre, de l’artisan face à la commande, du marchand confronté au risque, du soldat pratiquant le métier des armes, de l’athlète aspirant à la couronne, du tyran exerçant le pouvoir politique, du magistrat appliquant la loi, du sage interrogeant la nature, et enfin du dieu recevant l’offrande. Cette approche par types sociaux permet de dresser un tableau complet des différentes activités et fonctions qui structuraient la société grecque au VIe siècle, depuis les activités économiques de production et d’échange jusqu’aux formes d’exercice du pouvoir, en passant par les pratiques guerrières, sportives, intellectuelles et religieuses.
Dans la deuxième partie, les auteurs abordent la dimension spatiale du monde grec, analysant la structuration des territoires et les modalités de circulation. L’étude commence par les paysages et territoires pour se poursuivre avec l’examen des éléments caractéristiques de l’espace urbain grec : colonnes et colonnades, acropole, agora et remparts. L’attention est ensuite portée sur l’espace funéraire et la tombe comme lieu significatif, avant de conclure sur les moyens de transports terrestres et maritimes permettant la circulation des personnes et des biens. Cette partie met ainsi en lumière l’organisation spatiale caractéristique des cités grecques au VIe siècle, la monumentalisation progressive des espaces urbains et les infrastructures qui permettaient la mobilité au sein du monde grec et au-delà.
La dernière partie s’intéresse aux écarts sociaux et aux systèmes qui structuraient les relations entre différents groupes dans le monde grec. Les auteurs examinent d’abord les oppositions statutaires (libres/esclaves), de genre (époux/épouses), les pratiques érotiques, les différences générationnelles (jeunes/vieux) et sociales (agathoi/kakoi), pour ensuite analyser les formes de sociabilité et de communauté. Dans les derniers chapitres, les historiens explorent les systèmes d’échange (monnaie et dette), de communication (texte, autorité, écrit et voix), ainsi que les modalités de relation avec l’extérieur (rencontres, face-à-face, distances et confins). Cette partie révèle ainsi la complexité des relations sociales et des systèmes de valeurs qui organisaient la société grecque du VIe siècle, entre hiérarchies traditionnelles et innovations institutionnelles, avec une attention particulière aux instruments matériels (la monnaie) et symboliques (l’écriture), qui transformaient alors profondément les interactions sociales et culturelles.
Pour conclure, Le monde des Grecs au VIe siècle av. J.-C. est un ouvrage dense (752 pages) et d’une grande richesse. Le lecteur peut naviguer au gré de ses envies en utilisant la table des matières très détaillée. Il pourra ainsi y puiser des informations dans l’un des 27 chapitres, sur des thématiques portant sur les acteurs, les milieux et les interactions. Cet ouvrage est par conséquent un formidable manuel abordant avec une grande précision un VIe siècle av. J.-C. trop souvent méconnu ou simplement présenté de manière réductrice comme étant le siècle de Solon à Clisthène.
Par ailleurs, les auteurs n’ont pas cherché à comparer les siècles entre eux, mais le VIe siècle est surtout étudié pour lui-même, sans tentative de revalorisation par rapport à ceux qui le précèdent ou qui le suivent. Quant à l’objet livre en tant que tel, les pages sont épaisses et le texte suffisamment aéré, apportant ainsi un confort de lecture. Certains chapitres sont ponctués d’illustrations en couleurs d’une grande qualité. Nous trouvons à la fin de l’ouvrage une bibliographie exhaustive du sujet sur plus de 80 pages. C’est donc un ouvrage à lire et à posséder pour toutes les personnes qui s’intéressent au monde grec ancien. Pour ma part, j’ai particulièrement apprécié les chapitres consacrés aux marqueurs et aux paysages urbains.