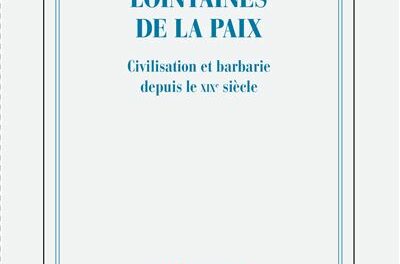Ce nouveau numéro du Mouvement social comprend six articles mais aussi un hommage à Maurice Agulhon rédigé par Michel Pigenet, professeur à l’Université de Paris I et président de la toute jeune association pour l’histoire des mondes du travailLe sommaire complet est disponible sur le site de la revue, http://www.lemouvementsocial.net/. Dans son texte, intitulé « Maurice Aguhlon au défi des classements », Michel Pigenet insiste assez logiquement, alors que Maurice Agulhon est connu et reconnu comme spécialiste de l’histoire politique de la France, sur les liens de celui-ci avec Le Mouvement social, l’histoire sociale en général et l’histoire du mouvement ouvrier en particulier, rappelant que Maurice Agulhon lui-même se considérait comme un praticien de cette dernière, notamment parce qu’il avait publié un livre, tiré d’une partie de sa thèse, sur le Toulon ouvrier de la première moitié du XIXe siècleAGULHON Maurice, Une ville ouvrière au temps du socialisme Utopique. Toulon de 1815 à 1851, Paris et La Haye, Mouton, 1970, 368 pages..
Ce nouveau numéro du Mouvement social comprend six articles mais aussi un hommage à Maurice Agulhon rédigé par Michel Pigenet, professeur à l’Université de Paris I et président de la toute jeune association pour l’histoire des mondes du travailLe sommaire complet est disponible sur le site de la revue, http://www.lemouvementsocial.net/. Dans son texte, intitulé « Maurice Aguhlon au défi des classements », Michel Pigenet insiste assez logiquement, alors que Maurice Agulhon est connu et reconnu comme spécialiste de l’histoire politique de la France, sur les liens de celui-ci avec Le Mouvement social, l’histoire sociale en général et l’histoire du mouvement ouvrier en particulier, rappelant que Maurice Agulhon lui-même se considérait comme un praticien de cette dernière, notamment parce qu’il avait publié un livre, tiré d’une partie de sa thèse, sur le Toulon ouvrier de la première moitié du XIXe siècleAGULHON Maurice, Une ville ouvrière au temps du socialisme Utopique. Toulon de 1815 à 1851, Paris et La Haye, Mouton, 1970, 368 pages..Cinq des six articles sont répartis en deux dossiers. L’un, par ailleurs objet de l’éditorial de Sophie Choveau, porte sur les liens entre « Science, invention et industrie au XIXe siècle » tandis que l’autre traite des débats sur l’enseignement et les militantismes étudiants au XXe siècle.
« Science, invention et industrie au XIXe siècle »
Dans ce premier dossier, on peut lire une étude de Guillaume Carcino sur Louis Pasteur sous-titré : « La science pure au service de l’industrie. » L’auteur n’apporte pas des faits nouveaux et il n’utilise pas d’archives qui auraient été jusque là inexploitées : « Nous n’avons pas la prétention d’écrire ici une histoire inédite de Pasteur […]. Nous nous proposons d’ordonner différemment les archives à disposition pour produire un récit dissonant par rapport aux écrits habituels, qui n’abordent bien souvent que les questions jugées « scientifiques » » (p. 9). Il montre en particulier comment toute la carrière de Pasteur est associée à des recherches qui servent l’industrie, qu’il s’agisse de celles sur la pébrine du ver à soie ou sur les levures, sans que pour autant cela n’entre en contradiction avec le concept de « science pure » que défend Pasteur, qui refuse par ailleurs la distinction entre recherche théorique et recherche appliquée : « Ce refus de toute distinction entre sciences théoriques et sciences appliquées est très vif, car, pour Pasteur, l’enjeu est de convaincre que c’est de l’activité du scientifique que proviennent directement les bienfaits du monde moderne – ce qui lui permet de revendiquer davantage de temps pour la science » (p.23). Ses différentes découvertes lui permettent d’atteindre cet objectif et d’incarner, au terme de sa vie, « les espoirs qu’on a placés dans la science depuis 1850 : travail et connaissance désintéressée, […] bénéfice matériel pour l’ensemble du corps social, profit économique généralisé, victoire sur la maladie et la mort » (p. 26). Cet article méritera assurément d’être prolongé par la lecture de la thèse de l’auteur, intitulée L’invention de la science. Une nouvelle foi à l’aube de l’âge industriel en France, à paraître au Seuil.
Dans le même dossier, Nicolas Sueur aborde la question de l’innovation pharmaceutique au XIXe siècle à travers le cas des « spécialités. » Il s’agit de produits « préparés à l’avance et en quantité suffisante pour être vendus dans différentes officines » (Sophie Choveau, citée par Nicolas Sueur, p.27), forme de médicament qui n’existait pas auparavant. Jusque là, le pharmacien préparait lui-même les médicaments qu’il vendait à ses patients. Par ailleurs, les « spécialités », produites en grande quantité dans des usines ou des ateliers de grande ampleur, font entrer la pharmacie dans l’âge industriel et dans celui de la société de consommation. Lorsqu’elles s’imposent comme la « norme médicamenteuse après 1900 » (p.28), elles ont fini par entraîner une transformation de la « notion même de médicament. Celui-ci ne doit pas simplement se contenter de soigner le malade mais lui offrir justement quelque chose de spécial en terme d’efficacité, de coût, de goût, de couleur, de forme, de confort et de facilité d’usage. De ce fait ce sont aussi les frontières entre logiques thérapeutiques, industrielles et commerciales qui tendant à s’estomper » (p. 46).
Débats sur l’enseignement et les militantismes étudiants au XXe siècle
Dans ce dossier, Clémence Cardon-Quint étudie l’action d’une association de spécialistes de l’enseignement secondaire, forme de militantisme enseignant qui a fait l’objet de beaucoup moins de recherches que le syndicalisme. Elle montre comment la « Franco-Ancienne », c’est-à-dire la Société des professeurs de français et de langues anciennes, a tenté de défendre conjointement l’enseignement du grec et du latin et l’enseignement secondaire entre 1946 et 1978, en vain. La réforme Haby et l’avènement du collège unique sonnent le glas de ce combat.
A partir de son travail de thèse de science politique, dans un article intitulé « Des militants en costume cravate. Regard socio-historique sur l’engagement des dirigeants étudiants de la MNEF (1973-1986) », Camilo Argibay présente la socialisation de ces étudiants particuliers en montrant que celle-ci est double : il s’agit à la fois d’une « socialisation militante » mais aussi d’une « forme de socialisation au métier politique » qui s’opère à travers « l’apprentissage des échanges et des interactions régulières avec les salariés, avec des décideurs publics, des responsables ministériels et des cadres de partis politiques » (p. 107).
Enfin, Yves Verneuil revient sur « La polémique sur la gémination des écoles publiques dans le premier tiers du XXe siècle. » La gémination des écoles « consiste à réunir une école de garçons et une école de filles afin de constituer une école mixte à une ou plusieurs classes » (p. 48). La législation en vigueur, sur laquelle Yves Verneuil revient en détail, prévoit l’existence d’écoles mixtes dans les communes de moins de 500 habitants, ou dans celle de plus de 500 habitants avec une autorisation du conseil départemental, en fixant des règles précises : filles et garçons doivent être séparés dans les salles de classe, sans qu’il ait pour autant existé de cloisons amovibles comme la légende le voudrait, et la cour de récréation doit elle-même être coupée en deux. En réalité, la mixité avait été envisagée uniquement pour des raisons pratiques, pour les communes n’ayant pas les moyens d’ouvrir deux écoles distinctes pour filles et garçons. La gémination est cependant mise en œuvre dans des communes peuplées de plus de 500 habitants. L’Eglise catholique en profite pour s’emparer de la question et développer un mouvement d’opposition à la gémination qu’elle présente comme le cheval de Troie de la coéducation généralisée. La hiérarchie et les militants catholiques, au moins les plus radicaux, se fondent sur un argumentaire qui n’est pas sans rappeler celui utilisée ces derniers temps dans le contexte des polémiques nées autour de la mise en œuvre du « Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école. » En 1936, « Dans son style radical, Ecole et famille renchérit : la gémination ne serait qu’un premier pas avant la coéducation intégrale, l’enseignement sexuel par le couple éducateurIl était prévu, en principe, de confier prioritairement les écoles mixtes à des couples d’instituteurs., le nudisme en classe sous couvert d’hygiène » » (p. 62). Un tel discours existe du reste dans le camp laïque, au moins avant la Première Guerre mondiale puisqu’un inspecteur général, Gabriel Compayré, peut écrire en 1906 dans la Revue pédagogique que la coéducation aurait pour effet de « dénaturer le caractère de chaque sexe, [d’] efféminer les jeunes hommes, [de] viriliser les femmes, [de] détourner les uns et les autres de leur vraie destination dans le monde » (p. 52). Une loi de 1933 donne une base légale à la gémination et surtout l’évolution de la société, y compris dans les milieux catholiques, rend l’opposition à la gémination de plus en plus inaudible.
La fin de l’histoire est connue : la mixité finit par s’imposer partout. Revenir sur les arguments des partisans de la gémination et de ses opposants, comme le fait Yves Verneuil dans cet article, permet cependant de réfléchir à la façon dont l’école se transforme dans une perspective historienne. Comme le suggère Yves Verneuil, la mixité s’est imposée sans que la coéducation ne soit véritablement pensée dans la mesure où le principal argument en faveur de la gémination était pédagogique. Celle-ci devait permettre d’obtenir de meilleurs résultats en regroupant les élèves par classe d’âge. « Insister sur l’intérêt pédagogique de la gémination est aussi un moyen d’éluder la discussion sur le principe de la coéducation, au sujet duquel les républicains sont eux-mêmes divisés. C’est l’optique qui, le plus souvent, sera privilégiée dans la seconde moitié du XXe siècle, au risque de généraliser la mixité sans réfléchir aux moyens d’une coéducation véritable. » (p. 69)
Histoire coloniale ou histoire de la république ?
Au début de février 1900, des ouvriers agricoles des plantations sucrières du nord-est de la Martinique cessent le travail. Rapidement, le mouvement de grève s’étend à toute l’île et aux raffineries de sucre. Le 8 février, une manifestation d’environ 400 ouvriers au François est violemment réprimée par l’armée ; huit ouvriers agricoles sont tués et quatorze blessés. L’île s’embrase : la grève devient générale et des maisons de planteurs ainsi que des plantations sont incendiées. Dans un article intitulé « StrikinglyRemarquablement. French ». Martinique, agitation ouvrière et politique métropolitaine au tournant du siècle », Christopher Church, professeur à l’université du Nevada, ne revient pas sur ces événements à proprement parler. Il étudie leur impact en métropole, à travers en particulier les débats politiques qu’ils ont entraînés dans la presse et à la chambre où l’affaire aurait pu provoquer la chute du gouvernement Waldeck-Rousseau. Après avoir montré l’ampleur de cet impact et la façon dont les événements martiniquais entrent en résonance avec les débats métropolitains sur la question ouvrière, les socialistes établissant un parallèle avec la fusillade de Fourmies, ou sur celle des « races », une partie de la droite et de l’extrême droite dissertant sur la « question noire », il conclut : « Les événements en métropole – la lutte entre les socialistes et les conservateurs, l’agitation ouvrière et la crise de l’identité française – ne furent pas seulement influencées par les colonies ; les colonies furent plutôt elles-mêmes partie prenante de ces événements. » (p.124)