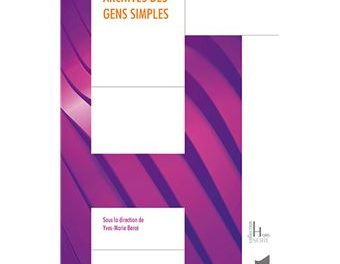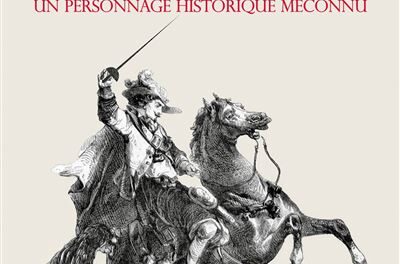Le livre de Sylvie Daubresse, ingénieur de recherches au C.N.R.S. (Centre d’étude d’histoire juridique, Université de Paris II- Assas), marque sans aucun doute une date importante dans l’historiographie du parlement de Paris. Ce livre est la réécriture d’une thèse soutenue en Sorbonne en 2000. Le directeur du travail initial, le professeur Denis Crouzet, signe d’ailleurs la préface du présent ouvrage. Celui-ci veut examiner à nouveaux frais les relations entre le pouvoir royal et le parlement de Paris entre 1559 et 1589, période particulièrement tumultueuse. Il s’agit de faire « l’analyse des fondements théoriques, des cadres institutionnels du pouvoir mais aussi des pratiques à l’intérieur des structures administratives de l’État ». L’objectif avoué de l’auteur est de « nuancer [la] vision conflictuelle des relations entre le Parlement et le Prince » (p. 9). Sylvie Daubresse se démarque ainsi d’emblée d’analyses qui ont plutôt eu tendance à souligner la vigueur de l’opposition parlementaire (voir notamment Jean-Louis Bourgeon, « La Fronde parlementaire à la veille de la Saint-Barthélemy », Bibliothèque de l’École des Chartes, tome 148, 1990, pp. 17-89 ; Sarah Hanley, Le Lit de justice des rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, trad. fr., Paris, Aubier, 1991 ; Marie Seong Hak-Kim, Michel de L’Hôpital. The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious Wars, Kirksville [Missouri], Sixteenth Century Essays & Studies, 1997). La démonstration de l’auteur s’appuie en particulier sur un dépouillement très impressionnant des registres et des minutes du parlement conservés au Centre historique des Archives nationales (série X). De manière surprenante, la présentation des sources, détaillée dans la thèse tapuscrite, a été réduite dans l’ouvrage final (voir pp. 6-8 et 511 et suivantes). Les registres du conseil du Parlement civil constituent la principale source de l’étude (sous-série X1a 1591 à 1716). Les registres secrets, où étaient notés le détail des délibérations, les oppositions, les réserves des magistrats et des gens du Roi à l’enregistrement forcé des édits, les procès-verbaux des mercuriales, n’ont pas été conservés.
L’auteur décrit d’abord, dans des prolégomènes intitulés « De la conscience du Parlement à la ‘civilité’ des lois », les formes que revêtent les liens entre la cour de justice et le pouvoir royal. La procédure de l’enregistrement est ainsi soigneusement analysée (p. 21 et suivantes), de la présentation des édits, ordonnances ou déclarations à la publication et à la transcription dans les registres du Parlement. Elle est régulièrement émaillée de remontrances parlementaires auxquelles répondent des jussions royales. Le roi peut notamment exiger qu’on lui communique les registres ou le billet des délibérations. En dernier recours, il arrive que le souverain se déplace en personne et demande qu’on lui obéît. Le parlement de Paris exerce ainsi un rôle essentiel dans le processus gouvernemental. Représentant la majesté royale, il a un devoir de conseil et de médiation. Selon les termes célèbres d’Étienne Pasquier (1529-1615), le Parlement est « l’alambic » par lequel passent les édits et décrets royaux, « chose pleine de merveille que dès lors que quelque ordonnance a esté publiée et vérifiée au Parlement, soudain le peuple françois y adhère sans murmure […] » (passage de Les Recherches de la France, livre II, chapitre IV, cité p. 58).
La première partie de l’ouvrage analyse d’une part l’attitude du Parlement vis-à-vis du mouvement réformé et d’autre part les réactions de l’institution parisienne aux politiques religieuses successives du pouvoir royal. Les premiers chapitres s’appuient notamment sur les travaux de Linda Taber, auteur d’une thèse restée inédite (Royal Policy and Religious Dissent within the Parlement of Paris, 1559-1563, Ph.D. Stanford University, 1991). En 1559, le parlement de Paris est vivement critiqué pour sa modération à l’égard des protestants. Le 10 juin, les chambres assemblées tiennent une mercuriale en présence du roi Henri II. Plusieurs conseillers sont arrêtés à l’issue des débats. Anne Du Bourg est condamné et exécuté en place de Grève, le 23 décembre suivant. Pour nombre de hauts-magistrats cependant, l’« hérésie » constitue une « menace contre l’ordre social » (p. 74). A la politique de conciliation religieuse proposée par le pouvoir royal à partir de 1560, le parlement de Paris oppose réticence et perplexité. Il défend la réforme de l’Église et proclame que l’unité de l’État dépend de l’unité religieuse. Les remontrances, imprimées, à l’édit du 17 janvier 1562 citent des « exemples extraits de l’histoire du Bas-Empire romain qui révèlent l’échec de la pluralité religieuse » (p. 96). L’Édit n’est enregistré, le 5 mars, que « per modum provisionis dumtaxat […] ». Chez les parlementaires, la peur de l’hérésie n’a d’égale que la hantise des désordres et de l’anarchie (p. 119). L’année 1563 constitue une véritable année de crise dans les relations entre le parlement de Paris et le pouvoir royal. L’édit d’Amboise (19 mars 1563) est certes enregistré dès le 27 mars par le Parlement, en présence du cardinal de Bourbon et du duc de Montpensier, appelés « pour imposer fermement [le texte] à une population parisienne très hostile à toute conciliation religieuse » (p. 131). Mais les réticences des magistrats poussent Charles IX à déposséder les parlements de la connaissance des causes touchant l’application de l’édit. Le roi confie cette charge aux baillis et sénéchaux, aux juges des présidiaux et prévôts des maréchaux ainsi qu’à des personnes de confiance, choisies parmi les gouverneurs, les maîtres des requêtes et les conseillers du Parlement (pp. 136-137). Les parlementaires parisiens refusent également d’admettre en leur sein des membres protestants. Ils se mettent ainsi « à l’écart du travail de la paix » (p. 144). De manière spectaculaire, c’est au parlement de Rouen, le 17 août 1563, que le roi décide de proclamer sa majorité et d’annoncer un second édit (daté du 16 août) confirmant celui d’Amboise. Le chancelier Michel de L’Hospital se livre à une critique sévère des parlements. C’est une humiliation pour l’institution parisienne. La vérification de l’édit du 16 août est très discutée. Le roi donne alors, le 13 octobre 1563, un règlement « pour le faict de la justice », qui sonne comme un rappel à l’ordre. Sylvie Daubresse ne surestime pas ce qui pourrait apparaître comme un acte d’autorité. Elle y voit plutôt un « rituel » avec ses figures attendues (p. 166).
De 1564 à 1574, les rapports entre le parlement de Paris et le pouvoir royal sont à la mesure des fluctuations voire des revirements de la politique religieuse. En l’absence du roi, qui parcourt le royaume avec sa mère et toute la cour entre janvier 1564 et mai 1566, le Parlement est chargé d’assurer l’ordre à Paris. Les paix de Longjumeau (23 mars 1568) et de Saint-Germain (8 août 1570), qui marquent la fin des deuxième et troisième guerres de Religion, sont rapidement enregistrées. Les magistrats cèdent pourtant tardivement à l’exigence royale de prêter serment à l’édit de 1570 : ils obtempèrent le 21 mars 1571, plusieurs mois après l’ordre de Charles IX, daté du 29 août précédent. En 1570 comme en 1563, le roi fait appel à certains parlementaires pour faire appliquer l’édit de pacification. Sur cette question, les travaux de Francis Garrisson (Essai sur les commissions d’application de l’édit de Nantes. Première Partie : règne de Henri IV, Montpellier, Déhan, 1964) et de Jérémie Foa (« Making Peace : The Commissions for enforcing the Pacification Edicts in the Reign of Charles IX (1560-1574) », French History, tome 18, 2004, pp. 256-274) peuvent permettre de compléter le bref panorama dressé par l’auteur. Sylvie Daubresse accorde un plus large développement à l’attitude du parlement de Paris pendant et après la Saint-Barthélemy. Elle rejette la théorie de Jean-Louis Bourgeon qui postulait une grève des parlementaires. « Après le mariage [de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, le 18 août 1574], le silence tombe sur les registres du Parlement », pendant une semaine (p. 194). « Faute de sources sûres et détaillées », il est donc impossible de « tirer des conclusions fiables et définitives » (p. 195). Vraisemblablement, les registres du parlement de Paris ont été expurgés de tous les souvenirs du massacre, du vivant même de Charles IX. On sait cependant que le roi se rend au palais, le 26 août 1572, pour tenir un lit de justice. Il tente de justifier le recours à la violence et assume l’entière responsabilité de l’élimination des chefs huguenots. Le premier président de Thou approuve l’action royale. Quelques mois plus tard, le 8 août 1573, l’édit de Boulogne, qui accorde la liberté de culte dans trois puis quatre villes, est enregistré sans difficulté (p. 200).
A maints égards, les relations entre le Parlement et le pouvoir royal sont plus tendues sous le règne d’Henri III (1574-1589). L’institution se plie certes – avec plus ou moins de bonne volonté – aux variations de la politique religieuse, de l’édit de Beaulieu (6 mai 1576) au traité de Nemours (7 juillet 1585), qui ôte aux réformés la liberté de conscience et de culte. La chambre mi-partie, instance d’appel créée par l’édit de mai 1576 et chargée de juger les procès où les protestants sont parties, est imposée par le pouvoir royal. Elle semble, selon les mots de Pierre de l’Estoile (1546-1611), « si odieuse à la cour que, si le roy n’y fust venu lui-mesmes, elle n’y eust jamais esté publiée » (passage cité p. 206). L’édit de Poitiers est enregistré en octobre 1577 mais « sans approbation de la religion » et par provision. La paix de Fleix (26 novembre 1580) est approuvée en janvier 1581. Les magistrats parisiens participent au travail de la paix en dehors du ressort du Parlement. Sylvie Daubresse rappelle ainsi que plusieurs conseillers sont envoyés à Bordeaux, Agen, Périgueux et Saintes, sièges successifs de la Chambre de l’Édit de Guyenne entre janvier 1582 et juin 1584. Antoine Loisel, avocat au parlement de Paris, y remplit ainsi la charge d’avocat du roi. Le traité de Nemours impose aux magistrats un complet revirement. Après avoir évoqué la politique gallicane du parlement de Paris – la question de la réception des décrets du concile de Trente est bien connue depuis les travaux d’Alain Tallon -, Sylvie Daubresse souligne qu’il faut avant tout lire, dans les relations entre Parlement et pouvoir royal, des approches complémentaires : le premier cherche à préserver l’unité religieuse dont dépend, selon lui, directement l’unité de l’État ; le second se place dans l’action et tente une politique de concorde. D’une certaine manière, le parlement de Paris – qui se veut le porte-parole des oppositions – sert d’écran, de « tampon » entre le roi et la capitale (p. 242).
La deuxième partie de l’ouvrage est « essentiellement consacrée aux besoins financiers du pouvoir royal et à ses conséquences » (p. 10). Les quatre chapitres qui la composent forment un ensemble dont la cohérence n’est pas évidente. L’auteur évoque d’abord la place du parlement de Paris dans le « corps » du royaume. S’inspirant notamment des travaux de Denis Crouzet, Sylvie Daubresse consacre d’excellents développements aux rapports entre le Parlement et le chancelier Michel de L’Hospital (pp. 261-267). Si beaucoup d’éléments les rapprochent, ils se séparent sur un point : le parlement de Paris ne transige pas sur les principes, en particulier l’idée d’unité religieuse, alors que le chancelier, placé dans l’action, veut l’adéquation de la loi à la condicio temporum. L’auteur rappelle également la très haute idée que se font de leurs fonctions les magistrats. Dans Alençon ou remonstrance faicte en l’Eschiquier d’Alençon en l’an 1576, Antoine Loisel compare les arrêts rendus par le Parlement à des oracles (texte analysé p. 305).
Dans un deuxième temps, Sylvie Daubresse rend compte de l’opposition, vaine il est vrai, du parlement de Paris à la création de nouveaux offices. Les chapitres suivants évoquent les cinq dernières années du règne d’Henri III (1584-1589). Le long et minutieux travail de vérification du Parlement, sa dénonciation continuelle des dérives des finances de la monarchie s’apparentent à une « forme de contrôle politique » (p. 413). L’attitude du Parlement vis-à-vis de la Ligue n’est pas sans ambiguïté. Quelques magistrats sont attirés par le mouvement parisien. D’autres affichent ostensiblement leur fidélité au roi. La plupart restent silencieux.
Au total, le livre de Sylvie Daubresse – dont on a donné seulement quelques aperçus ici – devrait faire date. L’ampleur des sources dépouillées ne manque pas de susciter l’admiration. On peut regretter toutefois que le lecteur ne soit pas mieux guidé dans un ouvrage aussi dense. Les faits se succèdent sans que les interprétations et les hypothèses soient toujours bien mises en valeur. Il reste que Sylvie Daubresse apporte des lumières nouvelles sur les pratiques institutionnelles dans la France de la seconde moitié du XVIe siècle. L’auteur refuse de réduire à une somme de conflits plus ou moins durs les rapports entre le parlement de Paris et le roi. Elle ne fait pas non plus de la cour supérieure une institution condamnée à une vaine rhétorique, une « façon de siffloter dans le noir », selon le mot d’Orest Ranum, ou encore ce « vain bruit qu’autorisait l’usage », d’après Alexis de Tocqueville (citations, p. 413). L’auteur conclut subtilement : « Les éclats de colère et les âpres discussions révèlent un système de contrôle et de balance qui ne menace en rien le régime monarchique » (p. 476). On retrouve ainsi les analyses de Michel de Waele, auteur d’une étude sur Les Relations entre le parlement de Paris et Henri IV (Paris, Publisud, 2000) entre 1589 et 1599, et les hypothèses, en son temps audacieuses, de Jonathan Dewald, dont la thèse, parue en 1980, porte sur les magistrats du parlement de Rouen (The Formation of a Provincial Nobility : The Magistrates of the Parlement of Rouen, 1499-1610, Princeton, Princeton University Press, 1980). L’ouvrage de Sylvie Daubresse, muni d’un important appareil critique (près de 2200 notes), enrichi par quelques pièces justificatives, par une présentation fournie des sources et de la bibliographie ainsi que par un index de qualité, constitue une mine de renseignements et une réflexion stimulante sur le fonctionnement de l’État sous l’Ancien Régime.