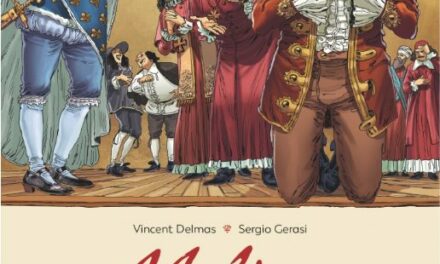Les auteurs de ce numéro hors-série de la revue trop méconnue Histoire et archives, toutes trois membres du Centre d’étude d’histoire juridique (Université de Paris II, UMR CNRS 7184), ont choisi de présenter « l’histoire du parlement de Paris dans les circonstances, relativement rares et cependant répétées, où il fut amené à exercer son activité hors de Paris » (p. 7). Du début du XVe siècle à la veille de la Révolution, le parlement a été transféré en province, à plusieurs reprises, de Poitiers à Troyes en passant par Tours et Pontoise. L’histoire générale de ces translations constitue une porte d’entrée dans les archives si riches du parlement de Paris.
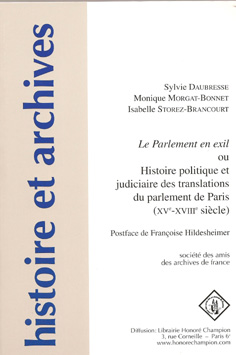
L’avant-propos signé par Isabelle Storez-Brancourt, bien connue par ses travaux sur le chancelier d’Aguesseau, replace les débats dans la très importante production historiographique, depuis les travaux de Charles Desmaze (1854) jusqu’aux toutes dernières publications. L’auteur distingue deux démarches de la recherche, celle de l’histoire politique et celle de l’histoire du droit (p. 11). Le premier volet permet d’isoler notamment d’importantes études signées par des scientifiques anglo-saxons (notamment sur le lit de justice, sur le cérémonial, sur la Fronde). Isabelle Storez-Brancourt s’attarde particulièrement sur la question de l’« idéologie » parlementaire (p. 24-25). Lorsqu’il traite de l’activité judiciaire de l’institution parisienne, le chercheur se heurte bien vite à un « océan documentaire » (p. 10), susceptible de décourager les meilleures volontés. Il s’agit ici de se situer au croisement des thématiques développées ces dernières années. Évaluer le rôle politique du parlement, sans plaquer d’emblée la fonction de « simple opposition à la monarchie », travailler sur l’activité judiciaire de l’institution en s’appuyant sur une documentation relativement limitée, tels sont les objectifs fixés au seuil de l’ouvrage (p. 31).
Translation ou transfert ?
L’introduction (Isabelle Storez-Brancourt, p. 33-115) revient d’abord sur la définition du terme de « translation ». Le terme doit être absolument distingué des commissions extraordinaires de justice (par exemple, la « Chambre ardente » de l’Affaire des poisons, 1679-1680) et des Grands Jours (tels ceux qui se tiennent à Clermont, en Auvergne, entre 1664 et 1666). Après avoir évoqué une série de « déménagements » du parlement à l’intérieur de Paris, Isabelle Storez-Brancourt revient sur deux transferts en province datant du XVe siècle, à Vendôme (1458) puis à Noyon (1477). En 1458, il s’agit d’expédier le procès du duc et pair Jean II d’Alençon, finalement condamné à mort pour crime de lèse-majesté, convaincu qu’il est « d’intelligence avec l’Anglois ». Si cet épisode ressemble plutôt à « une délégation de la cour, une commission extraordinaire de justice », il n’en est sans doute pas ainsi aux yeux du roi Charles VII, qui envisage un véritable transfert du parlement (p. 73 et suivantes). En 1477, le duc de Nemours, Jacques d’Armagnac est jugé et condamné à mort. Cette fois, la cour a été transférée dans un contexte de méfiance réciproque entre l’institution et le roi Louis XI.
Ces deux événements ne constituent pas cependant les épisodes de translation les plus importants aux yeux des commentateurs et compilateurs de l’Ancien Régime (p. 89). L’histoire commence véritablement à Poitiers, au début du XVe siècle, entre 1418 et 1436, avec les dix-huit années d’exil du parlement. C’est Monique Borgat-Bonnet qui traite de ce sujet (p. 119-300). « Un nouveau parlement est créé le 22 juillet 1418 par des lettres patentes de Charles VI ». Trois jours plus tard, ce parlement « bourguignon » tient à Paris sa première séance. La réponse du camp armagnac ne tarde pas. Le dauphin Charles, également lieutenant général du royaume depuis 1417, institue la cour de parlement à Poitiers, par une ordonnance rendue à Niort le 21 septembre 1418 (p. 125, 143 et suivantes). Paradoxe évident, le parlement de Poitiers, cour souveraine concurrente de celle de Paris, « est pourtant bel et bien considéré par la mémoire de l’institution comme une translation de celui de Paris, et l’historiographie la plus récente s’est appliquée, avec succès, à le démontrer » (Isabelle Storez-Brancourt, p. 92). Après avoir défini « le cadre institutionnel du parlement royal à Poitiers », Monique Borgat-Bonnet dresse le bilan de dix-huit années d’activité, distinguant les années d’installation (1418-1420), les « années delphinales » de la signature du traité de Troyes à la mort de Charles VI (1420-1422) et les années royales (1422-1436). L’auteur propose une approche analytique des actes du parlement siégeant à Poitiers (p. 172 et suivantes). Elle aborde notamment la question des rapports de l’institution avec le « parlement anglo-bourguignon » (p. 228 et suivantes). Le dernier chapitre de cette partie est consacré à une affaire particulière, le procès de deux familles poitevines qui s’affrontent pour la seigneurie de Touffou (p. 255-285).
Sylvie Daubresse, dont la thèse sur le parlement de Paris entre 1559 et 1589 a fait date, prend alors le relais (p. 301-536). L’auteur traite ici de la translation de l’institution parisienne à Tours à la toute fin du règne d’Henri III, alors que la Ligue enregistre de multiples succès. La décision remonte à février 1589. Le roi enjoint à tous les officiers de la cour de se rendre « en icelle nostredite ville de Tours dans le quinzième jour du mois d’avril prochain », sous peine de la perte de leur charge (texte de l’édit de Blois, p. 512-513). La première séance a lieu le 23 mars 1589. Seuls six conseillers, dix maîtres des requêtes et un avocat du roi sont présents (p. 316 et 514-517). Après l’assassinat d’Henri III, l’édit de translation est confirmé par les lettres patentes du 23 août 1589 (p. 339 et 517-518). À la fin de 1590, le nombre des hauts magistrats qui siègent à Tours se monte à 51, soit trois fois plus qu’aux tous débuts (p. 441 et 532-533). À cette date fonctionne également une chambre de justice à Châlons-en-Champagne. Dans le prolongement d’actes signés en 1589, des lettres patentes datées du 6 octobre 1590 ont ordonné à divers conseillers de « s’assembler en sa ville de Chaalons, pour y tenir la chambre de justice et de parlement qui y a esté établie » (texte cité p. 423). Selon toute apparence, cette chambre, dont le ressort a été précisément défini (autour de la Champagne et jusqu’en Picardie), a les mêmes prérogatives que le parlement de Tours (p. 422-4423). L’attitude de ce dernier à l’égard du « prétendu » parlement ligueur, resté à Paris, est présentée pour les années 1589-1590 (voir notamment p. 466). C’est à partir de l’analyse de l’activité judiciaire en 1589-1590 (1854 actes dépouillés, pour un total de 374 séances, dans trois registres du conseil cotés X1a 9230-9232 aux Archives nationales, p. 384-385) que Sylvie Daubresse ouvre de nouvelles pistes de recherche, complétant ainsi les travaux d’Édouard Maugis (1914) ou ceux de Michel de Waele (2000). « Assurer la continuité de la justice », « annuler les procédures des juridictions interdites », « reprendre en main les anciennes villes ligueuses », « procéder à des saisies », « installer des officiers non suspects », tels sont les principaux aspects exposés ici (p. 361 et suivantes). À la fin de 1589 et au début de 1590, l’heure du « retour à la normale » a bien sonné. Les succès militaires du roi, tout particulièrement la victoire d’Ivry (mars 1590), n’y sont pas pour rien (p. 413-422). Dans un discours célèbre du 13 novembre 1589, le premier président Achille de Harlay associe le parlement de Tours au « pharos Alexandrin, estant la guide aux mariniers pour arriver à bon port » (p. 307, 348 et 605). Finalement, la démonstration de Sylvie Daubresse ne s’éloigne pas trop de ces propos, qu’elle a placés en exergue de son travail. En dépit de difficultés nombreuses, le parlement de Paris transféré à Tours « s’est efforcé de jouer le rôle capital qu’il avait eu lors des guerres civiles et étrangères du Moyen Âge : celui d’imposer la paix protectrice du roi et l’obéissance aux sujets » (p. 510).
Translation sous la Fronde
Dans la dernière partie de l’ouvrage, Isabelle Storez-Brancourt présente l’« histoire politique et judiciaire des translations sous la Fronde et au XVIIIe siècle » (p. 537-731). L’auteur revient d’abord sur les sources utilisées. Elle présente longuement divers recueils de la série U des Archives nationales, notamment ceux de Jean Le Nain, maître des requêtes en 1642, mort en 1698 à 85 ans, auteur de la célèbre Table, « document hors pair » bien connu des historiens du parlement (p. 553-555 et 750-751), ou encore les papiers de Jean Gilbert Delisle, commis au greffe jusque dans les années 1740, dont on retrouvé au moins 127 recueils de toute taille (p. 541-548 et 749-750). L’auteur considère d’abord la période de la Fronde et d’abord la « non-translation » de 1649, lorsqu’il est envisagé de transférer le parlement à Montargis, décision finalement non mise en œuvre (p. 557-581). En revanche, la déclaration royale du 31 juillet 1652 ordonnant la translation du parlement à Pontoise est appliquée. Comme dans les cas précédents de Poitiers et de Tours, on assiste à un schisme parlementaire. Les magistrats qui obéissent au roi, très minoritaires, sont ridiculisés par les mazarinades (p. 614-616). Ils s’affirment néanmoins comme « le » parlement (p. 602). Ils n’agissent pas seulement comme une chambre d’enregistrement et jugent bel et bien des procès (p. 631). Entre Paris et Pontoise, on observe un « jeu de procédures » décrit finement par l’auteur (p. 638). L’expérience se termine le 22 octobre 1652, avec la réunion du parlement à Paris, aux conditions imposées par Louis XIV (p. 611). Entre juillet et décembre 1720, sous la régence de Philippe d’Orléans, en pleine période d’« acrobaties financières » (p. 650), le parlement de Paris est de nouveau transféré à Pontoise. Isabelle Storez-Brancourt s’appuie ici sur une « source unique en son genre », le Journal… de Jean-Gilbert Delisle, dont on attend bientôt une édition (p. 660 et suivantes). Le dernier chapitre revient sur les translations de 1753 (à Pontoise, de nouveau) et de 1787 (à Troyes). La première est liée à la question janséniste, la seconde à la politique fisco-financière engagée pour résoudre le déficit du Trésor (p. 685). Si les circonstances de ces transferts sont bien connues par divers travaux (John Rogister, Yves Combeau, Jean Egret, Bailey Stone), l’auteur montre une activité faible en 1753 comme en 1787 : la justice est bien « en panne » (p. 704). Parlements transférés, magistrats exilés ou relégués sur leurs terres, tout cela ne sert finalement qu’à renforcer « l’opinion parlementaire » (p. 719). De ce point de vue, on lira avec profit, en complément du présent ouvrage, un article récent de Julian Swann (« Disgrace without Dishonour : the internal exile of French Magistrates in the Eighteenth Century », Past and Present, n°195, mai 2007, p. 87-126).
Ce numéro hors-série d’Histoire et archives se termine par une postface de Françoise Hildesheimer (p. 733-740). Il est complété par une présentation des « sources et de la bibliographie » (p. 741-795) et par un index des noms de personnes et de lieux (p. 797-838). On ne peut que saluer cette parution, particulièrement stimulante en dépit de quelques répétitions imposées sans doute par un dialogue à trois voix. Les auteurs ont su retrouver, à partir d’un angle d’attaque original, les grandes problématiques labourées par l’historiographie parlementaire. On ne peut que souhaiter, comme le suggère d’ailleurs en passant Sylvie Daubresse (p. 311-313, au sujet des transferts de divers parlements de province en 1589), que ce mode d’approche soit étendu à l’ensemble du royaume.