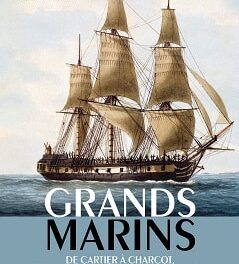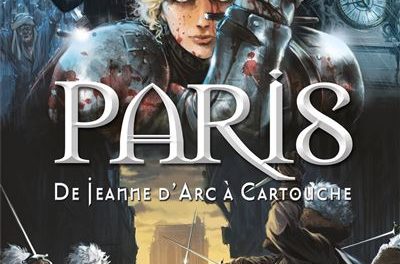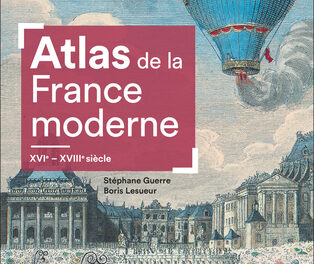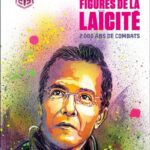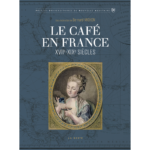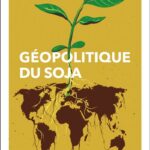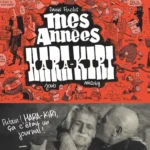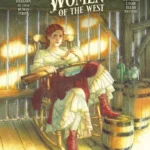Fanny Cosandey, maître de conférences et directrice de centre à l’EHESS, était jusqu’ici connue pour L’absolutisme en France. Histoire et historiographie (Seuil, 2002), un petit livre fort utile qu’elle avait coécrit avec R. Descimon, ainsi que pour sa thèse sur les reines de France dont la « Bibliothèque des histoires » avait déjà assuré l’édition en 2000. Désormais, il faudra compter avec ce troisième ouvrage, consacré aux préséances depuis Henri II jusqu’à Louis XIV. Mais, plutôt que de brosser un énième portrait d’un univers ordonné, l’auteur s’intéresse à l’arrière-scène, aux querelles de hiérarchie entre grands seigneurs, à ces moments où la belle harmonie curiale est mise à mal par quelques récalcitrants, aux difficultés du monarque, « maître des rangs », à ne pas se laisser emprisonner par ses arbitrages…
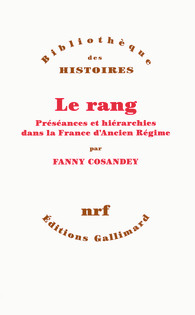
La première partie, « L’historique du rang », s’ouvre sur un constat simple: quel que soit le siècle, témoins et mémorialistes ont la nostalgie des anciens temps. La cour, c’est toujours mieux avant.
Si la vieille égalité chevaleresque entre le roi et ses seigneurs imprègne encore les esprits, comme du temps de Charlemagne et de ses douze pairs, elle n’est plus qu’un vestige du passé. Une pyramide de dignités a remplacé la Table ronde. Chaque divertissement royal, chaque cérémonie d’Etat (sacres, entrées de ville, lits de justice, funérailles), est là pour ordonner la noblesse. Mais c’est supposer que la noblesse forme un tout cohérent et figé, là où les hiérarchies peuvent être bousculées par le jeu des mariages ou du service auprès du roi. Dans l’affaire, l’arbitrage du monarque devient indispensable mais comment l’éclairer et le faire accepter? Henri II, à l’occasion de son sacre, fournit à la postérité deux réponses. Tout d’abord, il fit collecter toutes les preuves écrites attestant des titres et prérogatives de ses grands seigneurs. Puis, il fit archiver les places tenues par les uns et les autres lors d’anciennes cérémonies, afin de s’en référer comme des précédents. En somme, c’est le fait du prince tempéré par le droit et l’usage.
Les derniers Valois ajoutent deux pierres à l’édifice. La première consiste à élever les princes du sang, même sans apanage, devant les ducs et pairs, principe couronné en 1577 par un édit royal. La seconde étend le protocole à la vie ordinaire du souverain, au point de nécessiter la création de l’office de grand maître des cérémonies en 1585, qui a autorité sur le grand maître et les maîtres d’hôtel ordinaires.
L’arrivée des Bourbons ne modifie pas ces structures patiemment édifiées. Henri IV, qui dans ses journées ne s’embarrasse guère de protocole, fonde la promotion inlassable de sa progéniture adultérine sur la valeur de son sang. Ainsi, César, devenu duc de Vendôme en 1598, est de toutes les cérémonies royales, depuis le baptême du Dauphin jusqu’au sacre de Marie de Médicis en 1610, et à chaque fois, à une position fort enviable, juste après les princes du sang. Marie de Médicis et son fils Louis XIII, plus sourcilleux, vont plus loin encore. La première développe les marques de respect dues aux reines et à leurs familles d’origine et le second étend le protocole même aux moments où le souverain est absent. Sur la forme par contre, le long règlement général est remplacé par le brevet, nominatif, circonstanciel et révocable. Le cardinal de Mazarin obtient par ce moyen une position suréminente par rapport aux princes de sang ou le droit de lever une compagnie de gardes.
On s’en rend compte, tous les éléments de la toute-puissance de Louis XIV sont déjà là, avant même son règne personnel. Louis XIV n’invente pas mais pousse à la perfection l’existant. Surtout, il s’implique personnellement, tant dans l’organisation de son quotidien que dans le règlement des litiges de préséances. Mais à force de se poser en gardien intransigeant des usages, Louis XIV, pour garder l’initiative, doit trouver de nouveaux domaines où sa faveur ne butte pas encore sur le précédent, la coutume, ou la règle. Ainsi, Marly n’est pas le lieu où, contrairement à ce que l’on a pu dire, le roi retrouvait avec ses amis, la simplicité d’une vie sans protocole, mais bien le moyen de marquer sa faveur pour tel ou tel en dehors des prescriptions normées en vigueur à Versailles.La seconde partie aborde ce que les relations de cérémonies destinées à la publication se gardent bien de commenter, à savoir les querelles de préséances. Ces querelles sont cependant très précisément consignées dans les archives des maîtres des cérémonies et ont justifié bien des condamnations morales et satiriques de la cour, depuis les mazarinades jusqu’aux écrits de Voltaire. En leur temps, ces querelles ont motivé des procès, des rivalités voire des haines entre les familles concernées sur plusieurs générations.
Quatre histoires sont développées.
On s’en rend compte, tous les éléments de la toute-puissance de Louis XIV sont déjà là, avant même son règne personnel. Louis XIV n’invente pas mais pousse à la perfection l’existant. Surtout, il s’implique personnellement, tant dans l’organisation de son quotidien que dans le règlement des litiges de préséances. Mais à force de se poser en gardien intransigeant des usages, Louis XIV, pour garder l’initiative, doit trouver de nouveaux domaines où sa faveur ne butte pas encore sur le précédent, la coutume, ou la règle. Ainsi, Marly n’est pas le lieu où, contrairement à ce que l’on a pu dire, le roi retrouvait avec ses amis, la simplicité d’une vie sans protocole, mais bien le moyen de marquer sa faveur pour tel ou tel en dehors des prescriptions normées en vigueur à Versailles.La seconde partie aborde ce que les relations de cérémonies destinées à la publication se gardent bien de commenter, à savoir les querelles de préséances. Ces querelles sont cependant très précisément consignées dans les archives des maîtres des cérémonies et ont justifié bien des condamnations morales et satiriques de la cour, depuis les mazarinades jusqu’aux écrits de Voltaire. En leur temps, ces querelles ont motivé des procès, des rivalités voire des haines entre les familles concernées sur plusieurs générations.
Quatre histoires sont développées.
Voici le résumé des deux premières.
La première concerne le sort réservé aux princes étrangers lors du mariage de Charles IX de 1570. En l’espèce, trois ducs, Nemours, Guise et Nevers, sortis de maisons souveraines étrangères sont concernées et s’inquiètent de leur rang par rapport au duc de Longueville, un Orléans par la main gauche qui détient le titre de prince. Plusieurs fois sollicité, le roi finit par décider que Nemours, également prince de Savoie, se retrouverait en deuxième position après Longueville parce qu’il n’a pas encore ses terres du duché-pairie en propre. Consolation toutefois pour Nemours, il est devant Guise et Nevers. Mais Guise rappelle qu’il est lui un duc et pair à part entière et que si son propre père par le passé a cédé le pas à Longueville, c’était du temps où il espérait que Longueville épouserait sa fille et surtout, c’était à un moment où l’homme avait la faveur du roi. Or en 1570, on n’en est plus là. Longueville dans l’affaire rappelle qu’il a le rang de duc depuis plus longtemps qu’aucun des trois autres et qu’il est fondé à avoir la prééminence de ce seul fait. Au fur et à mesure des tractations, le duc du Nevers, quatrième selon l’ordre du roi, se sent de plus en plus méprisé et craint pour la réputation de sa propre maison alors qu’il est le premier puîné de sa maison, ce que ne sont ni Guise, ni Longueville. A l’arrivée, malgré les efforts d’apaisement du roi, le duc de Nevers, vexé de sa quatrième place, décide de ne pas venir au mariage et interdit à sa femme de le remplacer.
La seconde concerne la dispute entre le garde des Sceaux et le duc d’Epernon lors d’un conseil en 1618. Le garde des Sceaux, Guillaume Du Vair, est passé devant les ducs et pairs qui s’en sont plaints au roi par l’intermédiaire des ducs de Montmorency et d’Epernon. Le garde des Sceaux rappelle alors que, selon ses lettres de provision, il a le même rang que le chancelier et qu’il peut présider à toutes les cours de Parlement et de compagnies souveraines. Par ailleurs, il glisse que les sceaux sont plus anciens que tous les duchés-pairies. Epernon proteste que c’est faux, que d’ailleurs la charge de garde des Sceaux n’est qu’une commission récente et qu’il veut bien être fouetté dans les cuisines du roi si au Parlement, le garde des Sceaux reçoit les égards qu’il prétend mériter. Les esprits s’échauffent. Louis XIII intervient et quitte le conseil. Finalement, le duc d’Epernon quitte la cour et rejoint Marie de Médicis alors en rébellion contre son fils. Cette querelle est caractéristique de la rivalité entre les détenteurs de qualités féodales et les détenteurs d’une charge, entre le fief et l’office, la noblesse d’épée et les robins.
La première concerne le sort réservé aux princes étrangers lors du mariage de Charles IX de 1570. En l’espèce, trois ducs, Nemours, Guise et Nevers, sortis de maisons souveraines étrangères sont concernées et s’inquiètent de leur rang par rapport au duc de Longueville, un Orléans par la main gauche qui détient le titre de prince. Plusieurs fois sollicité, le roi finit par décider que Nemours, également prince de Savoie, se retrouverait en deuxième position après Longueville parce qu’il n’a pas encore ses terres du duché-pairie en propre. Consolation toutefois pour Nemours, il est devant Guise et Nevers. Mais Guise rappelle qu’il est lui un duc et pair à part entière et que si son propre père par le passé a cédé le pas à Longueville, c’était du temps où il espérait que Longueville épouserait sa fille et surtout, c’était à un moment où l’homme avait la faveur du roi. Or en 1570, on n’en est plus là. Longueville dans l’affaire rappelle qu’il a le rang de duc depuis plus longtemps qu’aucun des trois autres et qu’il est fondé à avoir la prééminence de ce seul fait. Au fur et à mesure des tractations, le duc du Nevers, quatrième selon l’ordre du roi, se sent de plus en plus méprisé et craint pour la réputation de sa propre maison alors qu’il est le premier puîné de sa maison, ce que ne sont ni Guise, ni Longueville. A l’arrivée, malgré les efforts d’apaisement du roi, le duc de Nevers, vexé de sa quatrième place, décide de ne pas venir au mariage et interdit à sa femme de le remplacer.
La seconde concerne la dispute entre le garde des Sceaux et le duc d’Epernon lors d’un conseil en 1618. Le garde des Sceaux, Guillaume Du Vair, est passé devant les ducs et pairs qui s’en sont plaints au roi par l’intermédiaire des ducs de Montmorency et d’Epernon. Le garde des Sceaux rappelle alors que, selon ses lettres de provision, il a le même rang que le chancelier et qu’il peut présider à toutes les cours de Parlement et de compagnies souveraines. Par ailleurs, il glisse que les sceaux sont plus anciens que tous les duchés-pairies. Epernon proteste que c’est faux, que d’ailleurs la charge de garde des Sceaux n’est qu’une commission récente et qu’il veut bien être fouetté dans les cuisines du roi si au Parlement, le garde des Sceaux reçoit les égards qu’il prétend mériter. Les esprits s’échauffent. Louis XIII intervient et quitte le conseil. Finalement, le duc d’Epernon quitte la cour et rejoint Marie de Médicis alors en rébellion contre son fils. Cette querelle est caractéristique de la rivalité entre les détenteurs de qualités féodales et les détenteurs d’une charge, entre le fief et l’office, la noblesse d’épée et les robins.
Que révèlent ces récits et leurs règlements ? Tout d’abord, il existe une « grammaire du rang » dont les tenants et les aboutissants sont très largement implicites. Quelques critères simples ont valeur de loi générale : l’âge (ancienneté dans le titre et du titre lui-même, place d’aîné ou de cadet…), le titre (les princes d’abord, les ducs ensuite, puis les marquis et les comtes…) et le sexe (les femmes après les hommes). A cela s’ajoutent des éléments de circonstance comme la nature de la cérémonie considérée : à l’église, c’est la hiérarchie ecclésiastique qui prime, l’archevêque passe devant l’évêque, mais au parlement, un évêque pair de longue date passera devant un archevêque dont la pairie est plus récente. Ensuite, il y a une « temporalité du rang ». Le rang se fonde et se justifie par des précédents. Cela explique les tensions lors de grandes cérémonies car la moindre nouveauté fait jurisprudence, même si d’un règne à l’autre, il y a des ajustements. Ainsi, le titre de petite-fille de France accordé à la Grande Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans, tient beaucoup à l’étroitesse du nombre d’enfants de France sous Louis XIII. De même, l’élévation des bâtards vient compenser le faible nombre d’héritiers légitimes à l’époque d’Henri IV ou à la fin du règne de Louis XIV. La complexité du problème a justifié la constitution d’archives privées et royales, la consultation et le travail de spécialistes du droit et d’érudits.La troisième partie, « Princes et souverainetés », part des procès de rang pour évoquer la figure du roi arbitre et juge. Cette partie met en tension les espaces intermédiaires où le rang est fragile, notamment quand il faut distinguer les princes du sang entre eux. En effet, la loi salique n’est qu’un « argument de référence » mais elle ne permet pas de rendre compte de toutes les situations, notamment quand il s’agit de bâtards, quand une fille légitimée devient princesse du sang comme Mademoiselle de Blois devenue princesse de Conti en 1680. De même, le rang produit par le service politique auprès du roi (Conseil, parlement, grands offices) présente aussi son lot de questionnements. La quatrième partie, « Société », évoque les initiatives de tous ceux qui, comme le roi, tirent parti des événements pour exprimer leurs rangs. Cela passe certes par les préséances et le port des insignes (bâton, manteaux, sièges…) mais aussi par la manifestation de sa frustration en cas d’affront, ce qui peut conduire jusqu’à la violence. Le roi doit parfois décréter des moments où le rang ne s’exprimera pas pour ménager les susceptibilités. Dans la mesure où la place que l’on occupe est liée au montant des gratifications que l’on espère recevoir du roi, on comprend l’enjeu matériel de ces querelles. Le développement se clôt par un chapitre consacré aux hiérarchies féminines. Ces deux dernières parties ont repris plusieurs raisonnements issus des premières.S’il fallait retenir les passages essentiels pour le lecteur pressé, la partie II avec ses quatre études de cas et ses chapitres sur « la grammaire du rang » et « l’atelier des mémoires », est particulièrement intéressante. Les études de cas, très vivantes, peuvent être utilisées en classe, ne serait-ce que pour incarner une leçon sur la cour. Dans la partie III, le chapitre neuf « Sujets et politique » donne un cadre institutionnel à la fois précis et utile. Enfin, la conclusion revient sur les situations où les sources évoquent moins de querelles de préséances, notamment concernant l’Eglise ou les diplomates. Elle pointe un élément important : la hiérarchie n’est pas un classement figé, elle est une « appréhension d’un système marqué par la fluidité ».