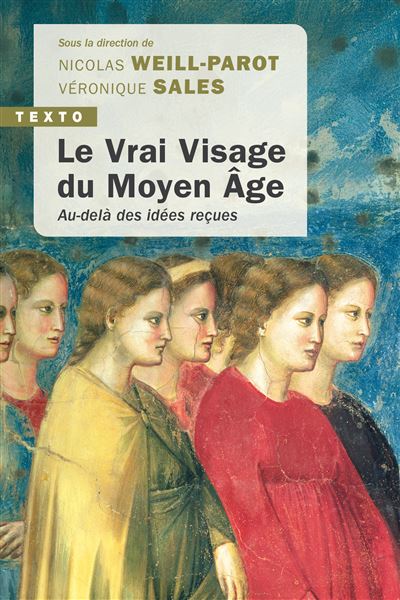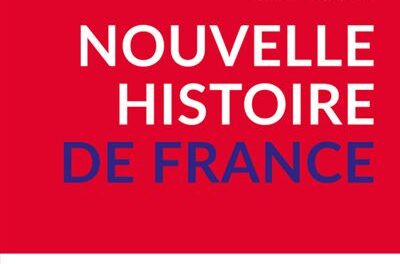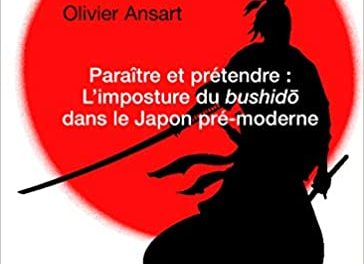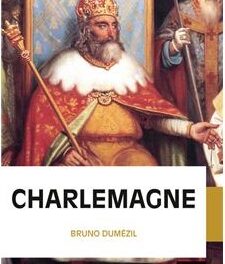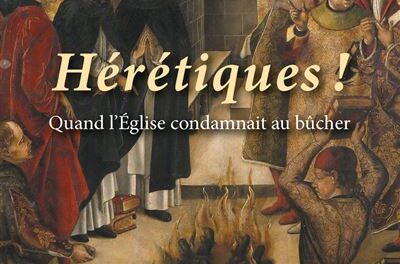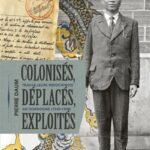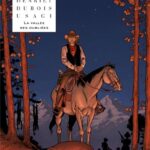Le vrai visage du Moyen Âge, dirigé par Nicolas Weill-Parot et Véronique Sales, initialement paru en 2017, est réédité dans sa version de poche chez Tallandier. L’ouvrage entend débarrasser cette période des caricatures et idées reçues qui persistent encore, qui se sont forgées sur une temporalité longue : dès l’époque médiévale, au siècle des Lumières, au XIXe siècle ou plus récemment au travers de la littérature ou du cinéma. L’ouvrage réunit vingt-deux spécialistes internationalement reconnus et adopte le format de l’entretien : chaque chapitre, centré sur un thème précis, interviewe un historien, offrant un exposé clair, rigoureux et vivant. L’ambition est double : décrire les idées reçues, retracer leur genèse et leur évolution dans le temps, puis restituer ce que l’état actuel de la recherche permet d’en dire. Une bibliographie indicative clôt l’ouvrage, bien que l’on puisse regretter que la réédition n’ait pas enrichi les références postérieures à 2017.
Des approches multiples
La richesse de l’ouvrage tient à la variété des thèmes abordés, allant de la médecine à l’université, de l’hygiène à la traduction, des innovations techniques à la sorcellerie, mais aussi à des figures sociales comme le serf, la femme ou le chevalier. Les croisades, les Templiers, l’Inquisition et Jeanne d’Arc, objets familiers du grand public, bénéficient de mises au point solides. Nicolas Carrier propose une synthèse brillante sur le servage, Jacques Verger sur l’université et Danielle Jacquart sur la médecine, montrant la diversité et la profondeur des approches.
Les échelles d’analyse sont également variées : certains chapitres se concentrent sur le royaume de France, tandis que d’autres adoptent une perspective occidentale et parfois mondiale. Jacques Paviot évoque les voyages et la découverte de l’Amérique avant Colomb, et Patrick Gautier Dalché examine l’état des connaissances géographiques. Catherine Verna insiste sur la circulation des techniques. Ces différents éclairages démontrent l’ouverture intellectuelle et matérielle d’un Moyen Âge souvent réduit à un enfermement dans l’imaginaire collectif. Gabriel Martinez-Gros « inverse » le regard sur les croisades et rappelle que ces expéditions militaires et religieuses n’étaient pas perçues comme un événement central par le monde musulman mais comme un conflit parmi d’autres.
Des mythes tenaces
De nombreuses idées reçues persistent, alors que la recherche historique montre une réalité beaucoup plus nuancée.
La coexistence entre musulmans, chrétiens et juifs en Al-Andalus n’était pas une tolérance totale et désintéressée, mais régie par le statut de dhimma, qui accordait certains droits aux communautés non musulmanes tout en les soumettant à des obligations comme le paiement de l’impôt de capitation et des restrictions sociales et religieuses. Les Templiers, loin des légendes d’un trésor fabuleux, devaient principalement gérer leurs richesses administratives et leur rôle bancaire et militaire. Le statut des serfs n’était pas uniforme : bien que subordonnés juridiquement à leur seigneur, certains bénéficiaient de droits et d’opportunités économiques réelles. Les croisades ne consistaient pas en une entreprise coloniale mais répondaient à des motivations religieuses, politiques et militaires complexes. Le fameux droit de cuissage, souvent attribué aux seigneurs sur leurs paysannes, relève davantage d’un mythe que d’une réalité documentée. Les femmes, loin d’être exclues de la société médiévale, occupaient des rôles spécifiques dans les sphères domestiques, religieuses, économiques et parfois politiques selon leur statut et leur milieu. Le mythe d’une « civilisation cathare » autonome dans le Sud de la France est également trompeur : il s’agissait plutôt de communautés religieuses marginales, réprimées par l’Église et la monarchie. L’Inquisition, quant à elle, n’a pas brûlé tous les hérétiques ; les procédures étaient longues et complexes, et les exécutions concernaient une minorité des cas. De plus, contrairement à une idée répandue, les personnes éduquées au Moyen Âge ne croyaient pas que la Terre était plate, la sphéricité de celle-ci étant connue depuis l’Antiquité et enseignée dans les écoles médiévales. Boris Bove, qui conclut le volume, nuance l’image traditionnelle de la fin du Moyen Âge, souvent réduite à une succession de catastrophes, en soulignant la complexité des dynamiques sociales et politiques.
Débats historiographiques et perspectives critiques
Le recueil prend aussi la forme d’un état des lieux historiographique, c’est-à-dire qu’il fait le point sur la manière dont les chercheurs ont travaillé sur ces sujets.
Certains auteurs critiquent les analyses de Guy Bois, notamment son interprétation des sociétés médiévales en termes de luttes de classes et de structures économiques héritée du marxisme. Ils s’éloignent ainsi de cette grille de lecture pour proposer d’autres approches de l’histoire sociale et économique tout en insistant sur leurs dynamiques.
Franck Collard relie la question du roman national à la réflexion sur la France en tant qu’État-Nation, tout en la mettant en perspective avec le monde médiéval. Il privilégie une approche d’histoire connectée, d’après lui, attentive aux circulations et aux interactions plutôt qu’aux grandes fresques globalisantes. Jacques Paviot adopte une démarche similaire en interrogeant la World History et la notion de voyage, mettant l’accent sur les liens entre les sociétés. À plusieurs reprises, les auteurs se démarquent ainsi de l’histoire-monde telle qu’elle est incarnée par Patrick Boucheron, dont l’Histoire mondiale de la France (dont une nouvelle édition va paraître aux éditions du Seuil) suscite chez Franck Collard des critiques appuyées, malgré la richesse stimulante de cet ouvrage collectif.
En conjuguant rigueur scientifique et clarté pédagogique, Le vrai visage du Moyen Âge réussit à déconstruire les stéréotypes tout en restituant la richesse d’un millénaire fondateur. Ni « âge sombre », ni « paradis perdu », le Moyen Âge apparaît comme une époque de mutations profondes, d’innovations et d’échanges. La variété des thèmes, l’effort constant de contextualisation et la confrontation aux grands débats historiographiques font de ce recueil un outil de référence pour comprendre comment se fabriquent nos représentations du passé.