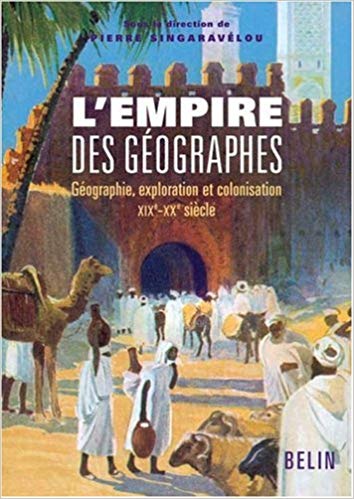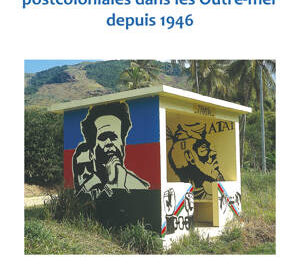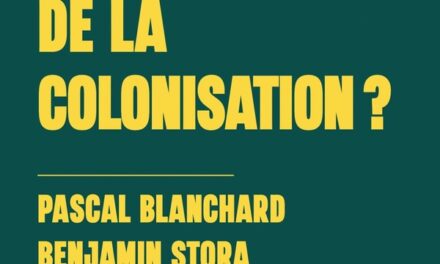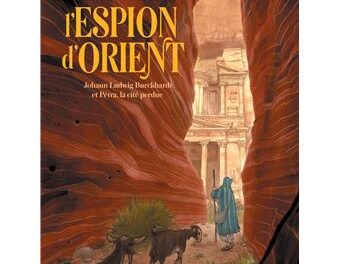Paul Claval, par ses « réflexions sur la géographie de la découverte, la géographie coloniale et la géographie tropicale » analyse le passage de l’une à l’autre en prenant en compte plusieurs facteurs et plusieurs rythmes. D’une part, la manière d’appréhender l’espace comme savoir géographique a varié. Elle s’est transformé progressivement, mais en profondeur, sous l’effet de l’écriture : « à la vue horizontale ou oblique du voyageur qui parcourt un pays s’ajoute la vision verticale de celui qui regarde la carte comme du ciel ». Une carte qui autorise les grandes découvertes, qui facilite le raisonnement stratégique, qui contient des savoirs généralement collectés par les administrations à partir de la deuxième moitié du 18ème siècle (désormais intégrant des relevés qui ne relèvent plus seulement de la toponymie mais des sous-sols, de la végétation, de la démographie…). Lorsqu’à l’exploration succède la mise en place d’une administration régulière, l’élaboration des savoirs géographiques dans les espaces coloniaux se transforme rapidement. Dès 1923, Demangeon signale que dans les possessions britanniques, l’administration était opératoire bien avant l’arrivée des premiers colons… modifiant en cela les conditions dans lesquelles les savoirs scientifiques pouvaient s’élaborer. La révolution vidalienne marque un autre tournant : la mutation méthodologique opérée par Vidal de La Blache, le travail de terrain, l’enquête, dépasse l’oeuvre de simple vulgarisation ou de simple propagande coloniale jusqu’alors assignée à la géographie. Faire apparaître les logiques de mise en valeur spécifiques de territoires par les sociétés vernaculaires par une géographie de contact et de terrain apport alors quelque chose de spécifique à la connaissance des pays colonisés : « c’est l’essence même de la géographie tropicale » selon Paul Claval. Parallèlement, force est de prendre en compte, sans nécessairement qu’elles jouent un rôle dominant dans l’expansion européenne, les représentations nées de la construction d’un imaginaire occidental sur l’ailleurs (marqué d’abord par le mythe du « sauvage », puis du « bon sauvage », puis par l’orientalisme…), représentations qui accompagnent les géographes, représentations souvent invalidées par la multiplication des contacts individuels noués sur place.
La géographie : « une science de la colonisation » ?
Claude Blanckaert s’oppose à la vision nuancée développée par Paul Claval sur le rôle des géographe au temps de la colonisation. L’auteur définit la géographie « coloniale » comme se partageant entre un pôle économique (agriculture, industrie, exploitation minière etc…) et un pôle d’érudition, lui-même éclaté entre les sciences de la nature set les humanités (histoire, archéologie, linguistique, ethnographie etc…). Evoquant le « pacte colonial de la géographie », l’historien aime à rappeler que l’on sait « depuis Bacon que le savoir et le pouvoir vont de pair » : « de l’information à l’opération, de la connaissance au profit escompté ou réalisé (financier mais aussi stratégique), l’équivoque semble accompagner toute l’histoire de la (ou des) géographie(s) ». Ainsi la géographie comme « science coloniale » est-elle sollicitée tout à la fois comme outil de rationalisation des conflits, instrument de la « stéréotypisation » du faciès, des comportements et du genre de vie des autochtones et comme lobby mêlant l’intérêt de la science à son application pratique. « Tout se tient » ponctue l’auteur qui cite Carole Reynaud-Paligot : « la pensée géographique des années 1890-1920 demeure très proche des problématiques raciologiques développées par les anthropologues » (dans La République raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930), PUF, 2006) ; et Olivier Soubeyran qui, à propos de l’école vidalienne parle d’« amnésie du phénomène colonial » (dans Imaginaire, sciences et discipline, L’Harmattan, 1997)
Dans une seconde introduction, le coordonnateur de l’ouvrage, Pierre Singaravélou, tente une synthèse par l’approche historiographique. Si des intellectuels comme Aimé Césaire ont stigmatisé le déterminisme qui a souvent structuré les travaux des géographes français sur les espaces outre-mer, plusieurs questions font aujourd’hui débat : existe-il un seul et même discours géographique sur l’empire par exemple ? les savoirs géographiques coloniaux relèvent-ils d’une épistémologie spécifique (alors même que l’auteur précise « les géographes, contrairement aux historiens, se sont très tôt intéressés aux origines coloniales de leur discipline »…) ? de quelle nature sont les interactions concrètes entre la production de savoirs et les pratiques du pouvoir en situation coloniale ? les usages politiques, économiques et militaires des savoirs géographiques sont-ils identiques au Sénégal, au Vietnam, en encore en Océanie ? la géographie de l’exploration, puis la « géographie coloniale » puis la « géographie tropicale » renvoient-elles à des épistémologies distinctes ou au contraire, comme l’affirment les Postcolonial Studies, à une même filiation intellectuelle ? Un tour d’horizon historiographique esquisse des éléments de réponse. « Cet ouvrage pose un nouveau jalon en faveur d’une histoire sociale et intellectuelle de la géographie en situation coloniale » termine l’auteur, « sa décolonisation n’est plus à faire ».
Les lieux de production de la « géographie coloniale »
Quatre contributions structurent cette partie, envisageant divers lieux de la production des savoirs géographiques. Isabelle Surun propose une lecture théorique et historiographique de l’exploration européenne en Afrique au 19ème siècle. Daniel Nordman aborde ensuite les thèses d’Augustin Bernard soutenues à la Sorbonne en 1895. Une soutenance sur la Nouvelle-Calédonie, vivement félicitée bien que l’auteur ne s’y soit jamais rendu. La soutenance a fait l’objet de deux rapports adressés au recteur d’académie compilés et analysés dans l’ouvrage. Emmanuel Sibeud s’est attaché à la Société de l’Afrique occidentale française en 1907-1908 voyant en elle plus un lieu d’apprentissage que de production de la géographie coloniale. Jean-François Klein reste dans le monde de l’érudition et des sociabilités savantes en approchant la Société de géographie de Lyon prise entre « la soie et la Croix », envisagée au contact de pressions d’ordre économique, de la part de la Chambre de Commerce, et d’ordre religieux (missions catholiques).
Les usages politiques et militaires de la géographie en situation coloniale
A travers le cas marocain, Mustapha Chouiki montre le flou qui marque la production d’un savoir géographique provenant d’un groupe somme toute très hétérogène d’amateurs et/ou géographes attitrés (militaires, académiciens, administrateurs, enseignants). Hélène Blais montre que la géographie militaire n’a pas pour objet de priorité les colonies. C’est la défense du territoire métropolitain qui prévaut à partir de 1870. Toutefois, l’exemple pris de la carte d’état-major du territoire algérien, montre que les colonies, échiquiers stratégiques secondaires jusqu’en 1914, sont abordées après 1918 par certains géographes comme des théâtres d’opérations potentiels à part entière. Une position en quelque sorte validée par la seconde guerre mondiale.
Géographies littéraires et vernaculaires
Cette partie sur les représentations, sur l’imaginaire colonial, intéresseront peut-être davantage les collègues du secondaire qui trouveront à l’instar de la première contribution, matière à puiser dans des textes et sources iconographiques riches et renouvelées. Ainsi l’article de Jean-François Staszak (« Que savait-on de Tahiti en 1890 ? Paul Gauguin et la géographie coloniale ») est-il accompagné d’ extraits de roman (Pierre Loti), d’analyses géographiques (Elisée Reclus), de correspondance (Paul Gauguin), de gravures, photographies et autres plans de l’Exposition universelle de 1889. L’étude part d’un questionnement a priori simple : que savaient les Français de « leurs colonies », ces Français qui n’avaient, à la fin du 19ème siècle, jamais mis les pieds dans une colonie pas plus qu’ils ne participaient aux débats des sociétés savantes ? Paul Gauguin sert de prisme pour répondre à cette question. Doublée d’une autre : qu’est-ce que ses connaissances coloniales, en tant que Français moyen, devaient à la géographie scientifique ? Au bout d’un cheminement qui renseigne sur les vecteurs de l’imprégnation coloniale, l’auteur montre que Gauguin est passé du statut de « consommateur d’images et de textes coloniaux » à celui de producteur.
Claire Laux s’intéresse pour sa part à l’Océanie et tente de différencier la vision qu’ont pu en avoir les missionnaires de celle, souvent différente, des colonisateurs. En tout état de cause, la construction de la connaissance géographique du Pacifique s’est élaborée par rapport à des mythes, des stéréotypes et des idées reçues qui datent des premières explorations et qui ont accompagné la christianisation puis la colonisation. On peut renvoyer à ce sujet au magistral catalogue de l’exposition Kannibals & Vahinés. Imagerie des mers du Sud, publié sous la direction de Roger Boulay en 2001 aux éditions de la Réunion des musées nationaux.
C’est enfin à travers le spectre des romans d’aventures géographiques que Matthieu Letourneux aborde l’imaginaire colonial en formation. Quel rôle ont joué ces romans d’aventures populaires sachant que leur production, commerciale, invite à reprendre les stéréotypes de l’époque, soit les idées du plus grand nombre… tout en enracinant les mêmes stéréotypes. Son étude concerne Le Journal des voyages de 1877 à sa disparition, en 1915. Le roman d’aventures se fait roman de découvertes dans les années 1870-1890, reprenant/véhiculant des stéréotypes racistes et des caractéristiques géopolitiques alors courants. Au tournant du siècle jusque 1914, la géographie est davantage saisie en termes de domination et de conflits… face aux « périls » noirs, jaunes ou arabes, mais aussi entre Européens avec pour ennemi l’Allemand ou l’Anglais. Après la première guerre mondiale, les romans glissent d’une logique de conquête vers une logique de développement et/ou de préservation d’un empire menacé.
De la « géographie coloniale » à la « géographie tropicale »
Colette Zytnicki tente de comprendre pour quelles raisons la géographie coloniale devenue tropicale a trouvé à Bordeaux « une terre d’élection » : elle envisage les acteurs, les institutions qui ont formé un terreau favorable puis une implantation finalement durable.
Enfin, Daniel Clayton, à travers un dense panorama historiographique, décentre un regard jusqu’alors très français sur l’approche postcoloniale de la géographie anglophone.
Dans un belle et courte synthèse de l’ouvrage, Yves Lacoste pense qu’il ne faut pas confondre les productions des géographes de terrain et les ouvrages géographiques qui traitent des pays coloniaux à des fins pédagogiques ou politiques. Il rappelle qu’au moment des indépendances, nombre de géographes qui avaient participé au développement de la géographie coloniale , à l’instar d’un Jean Dresch ou d’un Pierre Gourou, soutiennent ces mouvements d’indépendance.
Une jolie somme au total qui inspirera nombre de collègues pour étayer des cours de Première ou de Terminale. On regrettera, comme c’est souvent dans la publication d’actes de colloques, l’absence d’outils forts précieux comme des index de lieux et de personnes, pourtant aisément produits par le truchement de logiciels de traitement de textes basiques, et plus curieusement, une bibliographie peu structurée et très partielle et éclatée.