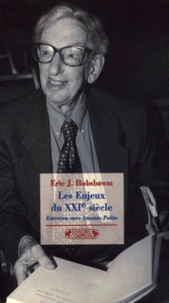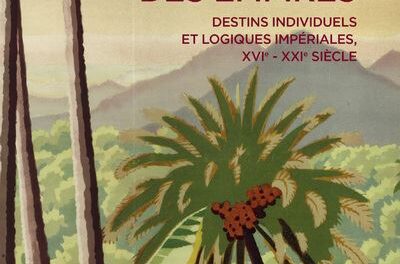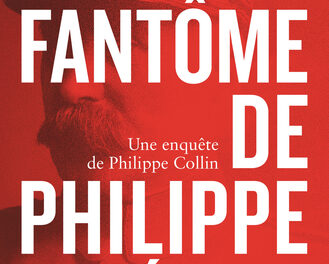Le titre de cet ouvrage peut surprendre. Que peut nous dire un historien sur le XXIe s. ? Rassurons le lecteur, il ne s’agit pas de prévoir les événements futurs car « nous devons comprendre que, dans une large mesure, le futur est – en principe comme en pratique – totalement imprévisible » (10). Er. J. Hobsbawm cherche donc seulement à identifier des problèmes et à définir des probabilités, dans une approche qui trouve son origine dans la lecture de Marx (13-14). Du reste, il reconnaît lui-même que certaines appréciations émises dans son ouvrage précédent, L’Âge des extrêmes, peuvent être modifiées. Par exemple, il insisterait aujourd’hui davantage sur la forte expansion économique que le monde devrait connaître dans les prochaines années (12-13). Toutefois, il maintient son découpage chronologique : le XXe s. commença en 1914 et s’acheva en 1991.
Cette série d’entretiens aborde plusieurs thèmes : « Guerre et paix » (17-40) ; « Le déclin de l’Empire occidental » (41-69) ; « Le village planétaire » (71-102) ; « Que reste-t-il de la gauche ? » (103-126) ; « Homo mundialis » (127-151) ; « De la France, de sa culture et de ses intellectuels » (153-171) ; « Le 12 octobre 1999 » (173-188, date retenue par les statisticiens pour la naissance du six milliardième être humain) ; et en conclusion « Espoirs pour le futur » (189-200). Nous en évoquerons ici quelques uns.
Concernant la guerre, il considère que la probabilité d’une troisième guerre mondiale est faible, du moins tant que la Chine ne sera pas devenue une puissance comparable aux États-Unis, ce qu’il n’envisage qu’à une échéance lointaine. Pour autant, cela ne doit pas nous amener à négliger le risque d’utilisation d’armes nucléaires, plus faciles à construire aujourd’hui ou à acheter. En outre, il ne faut pas oublier qu’à l’échelle du monde, les guerres conventionnelles n’ont jamais cessé.
Il insiste sur le rôle ambivalent de la technologie qui peut donner l’impression de guerre propre alors que les possibilités de destruction sont en réalité considérable. Il argumente plus longuement sur l’idée de guerre juste. Il pense que certains conflits peuvent être classés dans cette catégorie, par exemple l’intervention vietnamienne contre Pol Pot. Mais, il n’est pas sûr que cela corresponde à la guerre du Kosovo car d’une part l’intervention s’est prolongée et d’autre part les bombardements ont aggravé la situation des réfugiés. L’intervention de l’OTAN doit être comprise comme une défense de la crédibilité de cette organisation et une illustration de la puissance américaine (27-33).
Cette dernière lui paraît ne pas pouvoir être menacée pendant longtemps tant l’avance technologique des États-Unis est considérable. Pourtant, cela ne l’empêche pas de mettre en avant un certain nombre de fragilités. Il rappelle ainsi que leurs interventions reposent sur l’aide indispensable de leurs alliés. En outre, leur avance technologique ne leur permet pas toujours de gagner la guerre. Enfin, plus généralement mais cela affecte la puissance américaine, les démonstrations de force ont perdu de leur efficacité et l’envoi de bataillons de parachutistes ne suffit plus à imposer sa volonté à un pays tiers.
La mondialisation est un autre des thèmes abordés par Er. J. Hobsbawm. Pour ce dernier, il s’agit non pas d’un phénomène achevé mais d’une évolution qui connaît une accélération très impressionnante depuis les années 70, principalement en raison des mutations technologiques (71-74). Parce que la mondialisation est un phénomène historique, « une dynamique irréversible » (80), les États y sont extérieurs. Pour autant, cela ne doit pas justifier leur impuissance. La véritable question est idéologique. Er. J. Hobsbawm refuse l’idée selon laquelle « le marché maximise la croissance et la richesse dans le monde et en optimise la distribution » (80) ; les États doivent agir pour déterminer la voie que suivra la mondialisation. Il est curieux qu’à cette occasion, il ne cite pas l’optimalité de Pareto, c’est-à-dire un équilibre en situation de concurrence pure et parfaite, équilibre qu’il n’est pas possible d’atteindre sans l’intervention de l’État, de l’aveu même des théoriciens néoclassiques ; en outre, ces derniers reconnaissent que l’équilibre ainsi atteint ne correspondrait pas nécessairement à la plus juste répartition. On ne peut donc qu’avoir des doutes sur l’existence d’une « théorie du marché » à laquelle Er. J. Hobsbawm veut croire – et qu’il combat – et qu’aucun économiste ne défend.
Il est certainement plus intéressant de considérer l’évocation de la mondialisation comme une rhétorique destinée à masquer d’autres phénomènes. A juste titre, Er. J. Hobsbawm différencie la concurrence mondiale, qui serait une conséquence de la mondialisation, de la tendance lourde d’élimination du coût humain dans le processus de production. « En réalité, la compétitivité mondiale est l’excuse invoquée pour justifier ce processus […] C’est la loi d’airain de la production capitaliste plutôt que celle de la concurrence mondiale » (139). Mais cette élimination n’est pas sans grave conséquence. Elle revient en effet à faire peu de cas de l’importance des motivations psychologiques des individus dans le développement économique, importance qu’avaient déjà notée Ad. Smith et plus tard M. Weber en évoquant l’esprit du capitalisme. Plus généralement, Er. J. Hobsbawm pointe les limites du concept d’homo economicus tout en semblant reconnaître son efficience sur les marchés financiers. Or, les travaux récents d’André Orléan (Le pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999) et de Gérard Sauvage (Les marchés financiers. Entre hasard et raison : le facteur humain, Paris, Le Seuil, 1999) montrent qu’il n’en est rien et que la rationalité pure et parfaite n’explique pas les comportements des agents boursiers.
Qu’on ne s’y trompe pas, cet ouvrage d’entretiens est un livre engagé. L’auteur ne renie du reste pas ses engagements passés dans le parti communiste anglais (191-195). S’il ne croit pas à la disparition du clivage droite/gauche – il note malicieusement que « ceux qui affirment le contraire sont généralement de droite » (103) – il reconnaît que cela ne doit pas masquer des changements importants. Ainsi, traditionnellement, on associait la gauche aux transformations et la droite à la stabilité. Or depuis les années 70, il existe des courants conservateurs manifestant une grande volonté de transformation (Tatcher, Reagan…) et une gauche « qui souhaite le maintien du statu quo sinon un véritable retour en arrière », « qui est contre le progrès » (106) par exemple les écologistes. Cette analyse repose sur une idée qui n’est pas aussi évidente qu’Er. J. Hobsbawm semble le penser, l' »effondrement de la droite traditionnelle » en Europe (160).
Au cœur de ces changements, l’auteur paraît à plusieurs reprises hésiter entre la social-démocratie et une idéologie plus radicale. En effet, il observe que la gauche actuellement au pouvoir en Europe a le mérite de ne pas vouloir une société de marché selon l’expression de L. Jospin. A cette occasion, il apporte un soutien timide à la politique de redistribution menée par Gordon Brown le chancelier de l’Échiquier britannique (115-116). De même, il pense qu’Osk. Lafontaine, l’ancien ministre de l’Économie allemand, était trop à gauche et qu’il aurait dû s’inspirer des expériences européennes de gouvernement de centre-gauche (117).
Son hésitation s’explique sans doute par les difficultés que la gauche rencontre en cette fin de XXe s. selon lui. Celle-ci serait victime de son succès parce qu’elle a réalisé ses objectifs, à savoir l’instauration de la démocratie politique et parce que l’amélioration des conditions de vie des ouvriers l’affecte directement. De fait, elle peine à proposer un modèle de société différent. En outre, proposer aujourd’hui un projet collectif n’est pas chose aisée, en raison du fort individualisme qui règne. Enfin, la gauche souffre de la dépolitisation générale des sociétés. Pour autant, Er. J. Hobsbawm ne doute pas de la crise de l’idéologie néolibérale. Il en veut pour preuve la situation actuelle de la Russie dans laquelle « la théorie du marché a été testée jusqu’à la faillite » (85). Il y oppose la Chine dont l’État a su intervenir, prendre les décisions qui s’imposaient, tout en conservant un contrôle indéniable. Si pour l’instant il considère que le pape est le « dernier grand idéologue qui critique le capitalisme », il espère de la gauche une nouvelle contestation du capitalisme, qu’il qualifie de « mal moral » (68).
On le voit, cet ouvrage ne se résume pas à un exercice de prospective. Du reste, les quelques lignes de force évoquées par Er. J. Hobsbawm pour le siècle qui va commencer n’ont rien de surprenantes et sont parfois décevantes parce que banales. On appréciera toutefois sa méfiance à l’égard d’un lieu commun, l’association de la mondialisation avec le fondamentalisme et le repli identitaire. Au contraire, il pense « que l’assimilation l’emporte toujours, non en tant qu’idéal mais comme une pratique imposée par le fait de vivre dans une société différente de sa communauté d’origine. La troisième génération amorcera peut-être une réaction de retour à ses racines […] Mais [Er. J. Hobsbawm ne croit] pas qu’il s’agisse là d’une réaction à la mondialisation » (135). Il lui semble plus vraisemblable que se diffusent des cultures syncrétiques ; avec une limite, la diversité des langues qui sera toujours un obstacle à une réelle uniformisation.
On regrettera également une certaine tendance au déterminisme technologique, notamment au sujet de la mondialisation, même si quelques réserves sont émises (148-150). Bien qu’il s’en défende (« Le futur est bien obscur. Aussi ne puis-je l’envisager avec beaucoup d’optimisme », 200), sa vision optimiste sur l’accroissement des richesses ne lui permet pas de poser vraiment la question de la nature de la croissance et du développement durable. Il faut sans doute voir là une influence du marxisme dans lequel l’auteur puise une partie de sa tradition intellectuelle.
Cependant, cet ouvrage permet de faire rapidement le tour de bon nombre de questions d’actualité. De lecture aisée, il constitue un point de départ intéressant pour lancer une réflexion sur le monde d’aujourd’hui mais il ne saurait suffire tant il reste le plus souvent à un niveau très général. De ce point de vue, le lecteur de l’Âge des extrêmes risque fort d’être déçu. Cette oscillation entre lieu commun et idée originale s’illustre parfaitement dans cette phrase à laquelle tout professeur et tout élève seront sensibles : « Le système éducatif français est une machine à sélectionner et classer des gens très intelligents grâce à des concours impitoyables, mais qui n’empêche pas les débats intellectuels polémiques. Il y a sans doute une plus grande densité d’esprits puissants et vifs au mètre carré dans certains coins de Paris que n’importe où ailleurs » (158).
Mai 2000.