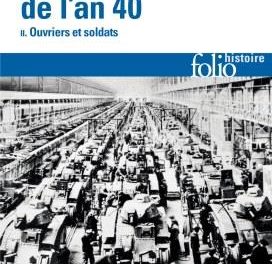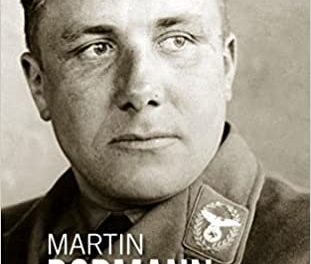Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique (partie Recherche), composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques varia complètent régulièrement cette partie. La séquence (Sources) approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique (Lectures) regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés et des contributions écrits en français et en anglais (suivis de mots-clés).
Cette revue a été publiée successivement par plusieurs éditeurs : Gallimard (n° 0) en 2003, Armand Colin (n° 1 à 6, H-S n° 1 et 2) de 2004 à 2006, Pepper / L’Harmattan (n° 7 à 20, H-S n° 3 à 9) de 2007 à 2013, Classiques Garnier (n° 21 et 22, H-S n° 10) en 2014 et, enfin, les PUR (depuis le n° 23 et le H-S n° 11) à partir de 2016.
La revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique – n° 39 a pour thème : Gouverner et administrer l’URSS post-stalinienne (1953-1992). Ce trente-neuvième dossier a été coordonné sous la direction de Sylvain Dufraisse (Maître de conférences en histoire contemporaine, Nantes Université-CNRS, CENS (UMR 6022) et Sophie Momzikoff (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Sorbonne Université, UMR SIRICE 8138). Comme d’habitude, le dossier se compose de deux éléments distincts : une première partie consacrée à la [Recherche] (avec 6 contributions de 7 chercheurs ou chercheuses, jeunes ou confirmées : Laurent Coumel et Marc Elie, Sylvain Dufraisse, Simon Godard, Éric Le Bourhis, Sophie Momzikoff, Pierre-Louis Six et Victor Violier ; la seconde à des [Sources] (au nombre de 6) commentées par six enseignants-chercheurs : Laurent Coumel et Marc Elie, Boris Vinogradov, Sophie Momzikoff, Julie Deschepper et Victor Violier. De plus, dans ce numéro, nous trouvons quatre [Varia] (avec les contributions de Carole Rivière, Jean-Patrice Lacam, Ketty Degrace et Bernard Lachaise) sans oublier une partie consacrée à des [Lectures] (au nombre de 6) critiquées par 6 historiens (Antoine Fournier, Juliette Deloye, Jérôme Bazin, Jean Garrigues, Matthieu Trouvé et, enfin, Annis Ghemires) puis résumées par Jean-François Bérel, auteur des recensions de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique pour le compte de « La Cliothèque », rubrique du site de l’association « Les Clionautes ».
Avec une introduction intitulée Pour une histoire socio-politique du gouvernement soviétique après Staline, Sylvain Dufraisse Sophie Momzikoff présente le dossier intitulé Gouverner et administrer l’URSS post-stalinienne (1953-1992). À la mort de Staline en 1953, l’URSS est un empire immense et hétérogène. Le plus vaste État du monde abrite plus d’une centaine de nationalités réparties entre ses quinze républiques. Depuis la Révolution de 1917, un régime autoritaire et centralisé a été progressivement instauré afin d’assurer le contrôle social nécessaire à la création du nouveau monde socialiste. Pour gouverner espaces et populations, l’État-Parti déploie une administration pléthorique aux méthodes souvent coercitives. Or, si les effets sociaux de l’expérience stalinienne (1924-1953) ont été explorés, la période post-stalinienne jusqu’en 1992 est peu connue. Ce dossier contribue au renouvellement historiographique qui vise à nuancer l’image d’un État-Parti vertical et omnipotent en interrogeant les pratiques de gouvernement et leur efficacité. Qui sont ceux qui dirigent et administrent l’URSS et comment construisent-ils les politiques publiques ? Parviennent-ils à les étendre à de nouveaux domaines ? Comment font-ils face aux impératifs de modernisation du pays ? De quels degrés d’autonomie, d’initiative et d’innovation, enfin, les acteurs locaux disposent-ils pour appliquer des normes venues du centre ? Grâce à un jeu d’échelles, articles et commentaires de sources inédites évaluent la capacité de l’État soviétique à mobiliser et à coordonner les différents échelons de son administration et révèlent ainsi les spécificités et les évolutions du système soviétique jusqu’en 1992.
[RECHERCHE]
R 1- « Peut-on planifier le chaos ? » politiques et controverses de l’eau en URSS, de Khrouchtchev à Gorbatchev
Laurent Coumel (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Clermont-Auvergne, CHEC) et Marc Elie (Chargé de recherche, CNRS, Centre d’études russes, caucasiennes, est-européennes et centrasiatiques)
Cet article retrace les principales étapes de la politisation et de l’institutionnalisation de la question écologique en Union soviétique, depuis la mort de Staline en 1953, jusqu’à l’effondrement de l’URSS en 1991, dans le cas des eaux continentales (fleuves, lacs, marais et mers intérieures). Il montre le paradoxe d’une émergence précoce des préoccupations environnementales qui n’a pas empêché le maintien presque jusqu’à la fin du régime de pratiques hydrauliques dévastatrices, de pollutions considérables et de projets d’aménagement destructeurs pour les milieux naturels.
R 2- Refondre l’action publique sportive locale dans l’Union soviétique des années 1980. Le cas léningradois
Sylvain Dufraisse (Maître de conférences en histoire contemporaine, Nantes Université-CNRS, CENS/UMR 6022)
Les années 1980 correspondent, dans le domaine des activités physiques et sportives, à une transformation des aspirations qui témoignent de velléités d’autonomie et d’individualisation des pratiques et à une évolution des politiques sportives (développement de la pratique de masse). L’intégration de l’Union soviétique à des espaces transnationaux comme la Conférence européenne du sport (à partir de 1973) contribue à réorienter les enjeux et les formes de l’action publique vers la satisfaction des besoins des habitants et l’ouverture de la pratique à tous et toutes, quel que soit l’âge. À l’échelle locale, ici la ville de Leningrad, il s’agit de rapprocher les activités physiques des habitants et de répondre à leurs attentes. L’arrivée de Mikhail Gorbatchev accélère ce processus. Le comité de culture physique et de sport local, suivant les indications centrales, autorise le développement de services sportifs payants et cherche à soutenir la démocratisation du mouvement sportif, le développement de cercles de pratiques autogérés et leur autonomisation. Confronté à ces tâches, le Comité de Culture physique local doit répondre à de nouveaux objectifs : connaître les pratiques effectives des Léningradois, recenser les équipements et leur occupation et rationaliser leur usage pour les ouvrir à des publics plus variés. En partant d’une analyse des documents de la pratique politique locale, il s’agit de mettre en avant la manière dont l’administration de Leningrad se confronte, « au concret », à des questionnements similaires à ceux des démocraties occidentales. Cet article souhaite alors porter son attention sur des aspects peu connus du sport soviétique : les formes d’action publique locale en matière sportive. Les réponses soviétiques ne semblent pas totalement différentes de celles que les communes de l’Ouest adoptent à la fin des années 1980 : développement et canalisation de la pratique « libre », diversification des pratiques, rationalisation de l’usage des équipements, développement d’une offre privée complémentaire à l’offre publique…
R 3-L’URSS au défi de la gouvernance économique internationale du bloc socialiste (1984-1990)
Simon Godard (Maître de conférences en histoire, Sciences Po Grenoble – Université de Grenoble Alpes, Pacte)
Dans les années 1980, l’URSS est une entité politique multiscalaire, à la fois simple État et superpuissance de guerre froide. L’interaction entre ces deux espaces de projection (national et transnational) met en jeu la capacité des institutions – étatiques et partisanes – soviétiques à configurer la doctrine de l’internationalisme socialiste. Celle-ci, au sens foucaldien du terme, fonctionne comme un double système de contrainte : elle lie l’URSS à un discours particulier, qui lui donne en retour un pouvoir sur les membres du bloc socialiste qui le reçoivent. La réforme de la gouvernance économique de l’URSS avec la Perestroïka doit donc être pensée dans l’impact qu’elle a sur les démocraties populaires autant que dans l’effet retour que cette évolution des principes économiques du socialisme à l’échelle du bloc a sur l’URSS. Cet article s’intéresse à la façon dont l’organisation de coopération économique multilatérale des États socialistes, le CAEM, devient un agent d’une production transnationale de la réforme économique du socialisme dans les années 1980, qui échappe en partie à l’URSS, tout en influençant politiquement et économiquement les marges de manœuvre de celle-ci dans ses propres réformes. L’impossible décorrélation entre principes de rationalité de la gouvernance soviétique à l’échelle de l’URSS et gouvernementalité socialiste de l’économie-monde, construite depuis 1949 à l’échelle du bloc de l’Est, éclaire alors la dimension transnationale des réformes soviétiques des années 1980, dont la mise en œuvre locale ne peut s’affranchir d’une compréhension de leur mise en débat à l’échelle internationale.
R 4- Autonomie municipale et ingénierie sociale. Riga, 1956-1959
Éric Le Bourhis (Maître de conférences en langue, littérature et civilisation lettones, Inalco/CREE)
L’autonomie politique des municipalités soviétiques était fragile et changeante. Cet article étudie cette question à partir du cas de Riga, capitale de la république lettone, à l’époque khrouchtchévienne, dans le domaine de la délivrance de permis de résidence. Parce que ce domaine ne faisait a priori pas partie des compétences municipales et n’était pas concerné par les politiques de décentralisation, les initiatives municipales ont été dénoncées et défendues. Cet article se saisit des nombreux échanges conservés à ce sujet dans les archives pour montrer plusieurs ressorts de cette autonomie et apporter un nouvel éclairage sur les politiques d’exclusion soviétiques de la fin des années 1950.
R 5- Gérer les « traces » de l’empire soviétique. Le district militaire de la Baltique : d’un outil de commandement et de contrôle à un outil de pression diplomatique ? (1945-1994)
Sophie Momzikoff (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Sorbonne Université, UMR SIRICE 8138)
Cette contribution s’intéresse au destin des troupes soviétiques présentes dans les trois États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), durant la période de transition qui signe la sortie de l’empire soviétique, de 1990, annonce unilatérale d’indépendance de ces trois républiques, jusqu’à 1994, qui règle la question du départ des forces militaires, désormais devenues russes, en Baltique. Durant quatre années donc, les Baltes doivent compter avec la présence de 170 000 hommes, qu’ils perçoivent comme des troupes d’occupations. Cet article a donc pour objectif d’étudier les mutations des pratiques soviétiques, puis russes, vis-à-vis de l’outil militaire. À l’origine outil de contrôle, de protection des frontières orientales de l’URSS et d’administration des territoires baltes longtemps rétifs à l’ordre soviétique, il s’agira d’étudier dans quelle mesure ces troupes deviennent un instrument de négociation pour conserver une certaine influence dans la région et négocier au mieux le retrait impérial soviétique. La présente contribution entendra par conséquent rendre compte des nouvelles pratiques de la diplomatie russe durant cette période de passage d’un ordre international à l’autre, en s’appuyant sur des archives du Conseil de l’Europe, de la CSCE, de la CIA, du Département d’État américain et des archives de la Banque centrale russe.
R 6- Penser la réforme de l’État soviétique durant la Perestroïka : entre autonomisation des savoirs sur le politique et dépolitisation des cadres (1985-1992)
Pierre-Louis Six (Chercheur postdoctoral à l’ENS Paris (CIENS / Département de géographie) – Chercheur associé au CERSA) et Victor Violier (Chercheur postdoctoral au CNRS (CERI / Sciences Po) – Résident à l’IRSEM – Chercheur associé à l’ISP)
Basé sur deux terrains d’enquêtes, l’un sur l’École supérieure du Parti de Leningrad (LVPŠ), l’autre sur l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), cet article interroge les conditions selon lesquelles ces institutions de formation des cadres directement liés au PCUS et à l’État soviétique se maintiennent dans un ordre institutionnel en dépit de la disparition du Parti et l’effondrement du régime. Alors même que le niveau de formation des cadres de ces deux institutions était régulièrement pointé du doigt en URSS, y compris publiquement et jusqu’au plus haut niveau de la direction soviétique, l’article expose les modalités selon lesquelles ces institutions de formation se conforment à un air du temps réformateur et satisfont ainsi, au moins en apparence, aux injonctions réformatrices de la Perestroïka. Par l’entrée des savoirs de gouvernement (politologie, management et gestion), il s’agit de saisir les logiques de transformations internes de ces écoles de cadres et les logiques de politisation / dépolitisation d’un nouveau modèle de cadres qu’elles promeuvent de 1985 à 1992. Ce faisant, l’article montre comment la transformation du curriculum des cadres du MGIMO et de la LVPŠ s’articule autour d’une relégation du politique dans les façons de penser la construction d’un nouvel État soviétique puis russe.
[SOURCES]
S 1- Mort du poisson et mort des rivières dans la Russie des années 1960
Laurent Coumel (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Clermont-Auvergne, CHEC) et Marc Elie (Chargé de recherche, CNRS, Centre d’études russes, caucasiennes, est-européennes et centrasiatiques)
Le document présente deux lettres reproduites en traduction française provenant d’un document dactylographié d’une cinquantaine de pages que la rédaction de La vie villageoise, quotidien national dédié à l’agriculture, envoya au Comité central du PCUS le 26 juillet 1965. Y était compilé un florilège d’une vingtaine de lettres reçues après la publication dans ce journal d’un article sur le rejet accidentel d’effluents toxiques d’une verrerie dans le réservoir d’un barrage de la région de Kalinine (Tver aujourd’hui), un mois auparavant. Les villageois avaient dû enterrer 12 tonnes de poisson mort. Parmi leurs diverses fonctions, les médias soviétiques avaient celle d’alerter discrètement les autorités des problèmes et injustices que les lecteurs, auditeurs et spectateurs signalaient dans leur courrier. Si ces lettres n’avaient pas vocation à être publiées, les compilations faites par les rédactions étaient soigneusement lues et annotées par l’appareil du Comité central qui y voyait un moyen de s’informer de la situation dans le pays, hors des canaux officiels et policiers, le signalement des problèmes étant considéré comme un acte civique habituel et souhaitable.
S 2- La réforme Kossyguine-Liberman : vers l’amélioration de la production industrielle en URSS
Boris Vinogradov (Chercheur postdoctoral à l’Université de Lille, IRHiS / CNRS)
Au début des années 1960, l’économie soviétique devient un mécanisme très complexe présentant de graves déficits d’efficacité. Les dirigeants des entreprises ne participent pas à l’élaboration des plans de production. Dans ces conditions, il devient de plus en plus difficile pour les organes de planification centraux de prendre des décisions efficaces. Néanmoins, la direction centrale insiste sur le contrôle minutieux de tous les aspects de la vie économique. Les directeurs d’usine ne disposent que de peu ou pas d’autorité pour s’écarter des plans quantitatifs, souvent établis un an ou plus à l’avance. En outre, les directeurs d’usine sont souvent poussés à produire des biens totalement inadaptés, ce qui s’accompagne d’un système de motivation mal conçu.
S 3- « XXVIIe Congrès du Parti communiste d’Union soviétique. Le cours du progrès scientifico-technique ». Timbre de la Poste d’URSS, 1986
Sophie Momzikoff (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Sorbonne Université, UMR SIRICE 8138)
Sur un timbre de 1986, tiré en hommage au XXVIIe Congrès du Parti soviétique d’Union soviétique (PCUS), l’étendard rouge de la révolution dévoile l’incarnation d’une modernité industrielle et technologique : une série de microcalculateurs et autres machines au service de la performance industrielle, par le peuple et pour le peuple. C’est somme toute l’image d’une société moderne, entièrement tournée vers l’avenir et à la pointe de la technique, que donne à voir ce timbre de 1986. Tout en reprenant des éléments classiques de l’imaginaire soviétique, le « cours du progrès scientifico-technique » qui est ici célébré est par ailleurs l’un des slogans majeurs du XXVIIe Congrès du PCUS, réuni du 25 février au 6 mars 1986, à l’initiative de Mikhaïl Gorbatchev (1931-2022), arrivé au pouvoir en mars 1985 et dont l’objectif est de donner un nouveau souffle aussi bien économique qu’idéologique au pays. Afin d’appréhender cette source iconographique, il convient de voir qu’elle s’inscrit tout d’abord dans la continuité de la propagande soviétique traditionnelle visant à magnifier la technique, vecteur de libération du prolétariat et clé de la construction de l’avenir radieux promis par le communisme. Par ailleurs, ce timbre illustre une préoccupation contemporaine propre aux élites soviétiques portant sur l’urgence d’une réforme économique qui reposerait sur l’intégration d’innovations technologiques dans la production industrielle en vue de combler le retard inquiétant de l’URSS dans ce domaine sur l’Occident, dans un contexte de guerre froide.
S 4- Commentaire du dessin en couverture : « Bureaucratie », Krokodil, 1986
Sophie Momzikoff (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Sorbonne Université, UMR SIRICE 8138)
L’archétype du bureaucrate procédurier et incompétent, responsable de la pesanteur administrative qui semble caractériser le plus grand pays du monde se retrouve souvent dans la littérature ou le cinéma russe et soviétique. De Nikolaï Gogol et son tableau au vitriol d’un inspecteur de province dans son célèbre Revizor (1836), en passant par Anton Tchekhov et sa satire La mort d’un fonctionnaire (1883), ou encore dans De vrais amis de Mikhaïl Kalatozov (1954), où les trois héros du film croisent au cours de leurs aventures d’inefficaces bureaucrates, la critique est omniprésente, révélant ce qui semble être une véritable réalité sociale. Plus généralement, la critique de l’administration et de ses pratiques dépasse largement les frontières russes. La bureaucratie, ses codes et ses pesanteurs ont fasciné des générations d’auteurs et autres analystes des mutations de leur temps comme Franz Kafka, pour les plus célèbres d’entre eux. Pourtant, la mise en place d’un État socialiste à partir du début des années 1920 en Union soviétique induit une véritable inflation bureaucratique, dans la mesure où les fonctionnaires sont les relais de l’État-Parti autant pour le contrôle de la société que pour le fonctionnement quotidien de l’économie. La source présentée ici, tirée de la revue satirique soviétique Krokodil (crocodile) semble s’inscrire dans la longue lignée de la critique d’une administration impersonnelle et déconnectée de la société réelle. On peut y voir au premier plan un citoyen désemparé, équipé du matériel d’escalade nécessaire au franchissement du mur immense de procédures administratives et autres normes qui le sépare d’un agent administratif. Ce dernier, tapis derrière un bureau orné d’un téléphone, les yeux cachés par d’épaisses lunettes, prépare les futurs formulaires qui s’ajouteront à la déjà épaisse barrière de papier.
S 5- Effritement idéologique, érosion patrimoniale. L’Oukase « Sur la répression des profanations de monuments liés à l’histoire de l’État et à ses symboles », 1990
Julie Deschepper (Maîtresse de conférences en histoire du patrimoine et des musées, Université d’Utrecht)
Le 11 avril 1990, dans la ville lettone de Smiltene, un monument en l’honneur de Lénine est démantelé par les autorités locales. C’est le premier cas en URSS de déboulonnement d’une statue célébrant le père de la Révolution, parmi les milliers qui ponctuent tout l’espace public soviétique. Après cet événement, un Lénine de pierre disparaît également le 29 mai de Tukums, toujours en Lettonie soviétique, et des symboles à son effigie sont déplacés ou cachés. Son buste est par exemple retiré du Cabinet des ministres à Riga entre les 8 et 9 juin. Le phénomène dépasse rapidement les frontières baltes. En Ukraine soviétique, après un vote à l’unanimité au sein du comité municipal de Chervonohrad, à l’ouest du pays, la décision est prise de déplacer le monument de Lénine situé sur la place centrale. Une grue est envoyée le 1er août et s’exécute. En réalité, la statue disparaît. Le même phénomène se reproduit dans d’autres villes ukrainiennes : tel un jeu de dominos, les métonymies monumentales de Lénine dégringolent les unes après les autres de leurs piédestaux à Ternopil, Kolomyia, Nadvirna, Drohobych ou encore Lviv.
S 6- L’héritage disputé de l’École supérieure du Parti de Leningrad : luttes politiques et « révolution étudiante » pour le Palais de Tauride (1992)
Victor Violier (Chercheur postdoctoral CNRS au Ceri (Sciences Po), résident à l’Irsem)
Comme chacun sait, le maire Anatolij Sobčak a décidé d’utiliser l’ensemble des bâtiments du Palais de Tauride pour abriter les travaux du parlement de la CEI. Récemment, le Fonds des biens non résidentiels municipaux, créé par le comité du bureau du maire pour la gestion des biens de la ville, a averti le centre de cadres du Nord-Ouest, occupant les locaux du Palais, qu’il devait les restituer. Des centaines d’étudiants et de professeurs de l’Institut de gestion, formés au sein de l’un des plus importants établissements d’enseignement supérieur de la ville, devraient ainsi être jetés à la rue.
L’Institut de gestion publique de l’État et des municipalités a été créé au printemps 1992, et, à l’été, il a accepté 600 personnes afin d’étudier au sein de la spécialité de « Gestion ». À l’issue du concours, seule 1 personne sur 7 a été reçue (soit moins encore que les plus anciens établissements d’enseignement supérieur de Saint-Pétersbourg).
[VARIA]
V 1- Quand une écrivaine républicaine s’autocensure. Le pamphlet non publié de George Sand après la condamnation à mort d’Armand Barbès (1839)
Carole Rivière (Doctorante en histoire, Criham, université de Limoges – université Clermont Auvergne)
Juillet 1839. George Sand, écrivaine romantique et républicaine, s’indigne du sort réservé à Armand Barbès, condamné à mort pour raisons politiques, peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Parallèlement à la mobilisation publique de ses confrères Victor Hugo et Alphonse de Lamartine, George Sand envoie à Lamennais un pamphlet qui ne sera jamais publié. Cet article examine les raisons de l’autocensure de ce texte qui témoigne des débuts politiques méconnus de l’écrivaine, dès la fin des années 1830, et des difficultés de la gauche républicaine.
V 2- De la Gauche dynastique à la Jeune Gauche : quand Alexis de Tocqueville rêvait de diriger un grand parti
Jean-Patrice Lacam (Professeur agrégé en Sciences sociales et docteur en Sciences politiques / Chercheur associé à l’Institut de recherche Montesquieu (EA 7434, Université de Bordeaux)
En 1839, Alexis de Tocqueville se lance en politique. Et il le fait avec le projet d’installer dans la France de la monarchie de Juillet ce qu’il appelle une « démocratie modérée ». S’il reste un député isolé, ce qu’il est au début des années 1840, il ne peut atteindre cet objectif. Il lui faut donc prendre les commandes d’un parti. Et c’est ce qu’il tente de faire une première fois, en 1842, en intégrant l’équipe dirigeante de la Gauche dynastique puis, une seconde fois, cinq ans plus tard, en créant sa propre organisation, la Jeune Gauche. Bilan : deux stratégies et deux échecs. Tocqueville rêvait d’un parti aux idées libérales et aux mœurs honnêtes, malheureusement pour lui, rares étaient les électeurs et les élus qui, sous le règne de Louis-Philippe, partageaient son rêve.
V 3- Les débats parlementaires relatifs à la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes
Ketty Degrace (Doctorante en histoire du droit à l’université Côte d’Azur, Ermes)
La IIIe République doit endiguer l’augmentation considérable de la récidive. Pierre Waldeck-Rousseau soumet au Parlement un projet de la loi créant une nouvelle peine, la relégation. S’il cumule un certain nombre de condamnations, un récidiviste sera considéré comme incorrigible et envoyé à vie dans un territoire d’outre-mer afin de participer à sa mise en valeur. Au sein des deux Chambres, ce projet suscite des divisions profondes parmi les parlementaires, jusqu’au sein d’un même courant politique.
V 4- Le parcours de Simone Veil (1927-2017) dans la vie politique française
Bernard Lachaise (Professeur émérite d’histoire contemporaine, Université Bordeaux Montaigne, CEMMC)
Dans la vie politique française, le nom de Simone Veil est associé au vote de la loi sur l’Interruption volontaire de grossesse en 1974. Entrée en politique tardivement en devenant d’emblée ministre en 1974, Simone Veil a mené d’autres combats politiques mais sans jamais exercer un mandat national et sans adhérer avant 1995 à un parti politique, l’UDF. Son positionnement politique, comme celui de son mari Antoine Veil, est demeuré centriste dans une France bipolarisée. Ses archives confirment ses actions pour les droits des femmes, notamment pour la parité en politique, sa lutte contre l’extrême droite et le racisme ainsi que ses positions, moins connues, pour une révision des institutions de la Ve République dont elle dénonce la pratique et souhaite le remplacement par un régime présidentiel.
[LECTURES]
L 1- Danielle Tartakowsky, Histoire de la rue. De l’Antiquité à nos jours, Paris, Tallandier, 2022, 524 p. par Antoine Fournier / CHSSC, Université de Picardie-Jules Verne
Tour à tour espace de circulations, espace politique et espace social, la rue peut être définie par la multiplicité de ses usages. Réalité paraissant immuable, la rue a connu des transformations majeures selon les époques et les sociétés ; elle constitue un prisme original pour les étudier. Telle est l’ambition de cet ouvrage réalisé sous la direction de Danielle Tartakowsky. Spécialiste d’histoire politique et sociale du xxe siècle, ses travaux portent notamment sur les phénomènes sociaux qui se déroulent dans l’espace urbain, en particulier les mobilisations politiques. Avec la participation de spécialistes de plusieurs périodes – Joël Cornette (Ancien Régime), Emmanuel Fureix (XIXe siècle), Claude Gauvard (Moyen Âge) et Catherine Saliou (Antiquité) –, l’ouvrage prend le parti d’utiliser ce lieu commun pour étudier plus de deux mille ans d’histoire.
L’ouvrage, qui alterne entre approches chronologique et thématique, se compose de cinq parties qui établissent une temporalité propre à la rue. Trois principales périodes sont définies : l’Antiquité romaine, puis un « long Moyen Âge de la rue » qui s’étend de la période médiévale au XXe siècle. L’irruption de l’automobile est le principal facteur qui provoque sa fin et ouvre l’ultime période traitée.
L 2- Marion Brétéché et Héloïse Hermant (dir.), Parole d’experts. Une histoire sociale du politique (Europe, XVIe–XVIIIe siècle), Rennes, PUR, 2021, 312 p. par Juliette Deloye / ARCHE, Université de Strasbourg
Aboutissement d’un travail collectif rassemblant dix-huit auteurs et autrices, ce livre affronte conjointement les deux notions d’expert et d’expertise, qui étaient devenues embarrassantes pour les historiens et les historiennes du politique à l’époque moderne. Embarrassantes d’abord par leur usage actuel, souvent « incontrôlé » (p. 8), qui vide ces notions de leur sens à force de ne pas les interroger. Embarrassantes ensuite par la richesse de l’état de l’art sur l’expertise, en sciences sociales surtout, en histoire aussi, et d’autant plus impressionnant qu’il rend compte d’un objet « polymorphe » et « ductile » (p. 9 et 11), ressortissant à de nombreux domaines de l’historiographie, quoiqu’il se soit imposé à l’histoire des sciences et des techniques avec une acuité particulière (Frédéric Graber). Embarrassantes enfin par la prégnance du récit de la genèse de l’État dans l’histoire politique de l’Europe moderne, qui ne permet pas de se défaire d’une vision téléologique de l’expert et de l’expertise. Une démarche d’histoire sociale du politique, explicitée en introduction et en conclusion par Marion Brétéché et Héloïse Hermant, est mise en œuvre dans chacune des quinze études de cas qui composent l’ouvrage. En appliquant des notions actuelles – expert, expertise – à des situations passées, il ne s’agit ni d’écrire une préhistoire de l’expertise, ni de faire fi des sens que recouvraient ces termes à l’époque moderne, mais de créer du jeu, de lever le voile, comme le suggère le trompe-l’œil en couverture du livre, sur des espaces interstitiels de l’activité politique. L’expert et l’expertise fonctionnent comme des révélateurs d’actions politiques qui échappent le plus souvent à l’histoire de l’État et des institutions, et que l’on pourrait pour cette raison considérer comme à la marge. En fait, ces situations sont d’autant moins marginales qu’à l’époque moderne le champ du savoir politique n’est pas constitué et que « les compétences proprement politiques des acteurs de gouvernement sont floues » (p. 8). En déplaçant la focale des travaux sur l’expertise, habituellement centrés sur la période contemporaine, parfois sur les Lumières emblématiques de l’utilité publique, à l’ensemble de la période moderne, l’ouvrage met au jour certains mécanismes de la politique d’Ancien Régime en Europe (France, Espagne, Saint-Empire) et réinterroge ses notions clés, qui sont pour certaines devenues des totems historiographiques – ainsi de la raison d’État (Nicolas Schapira).
L 3- Bertrand Tillier, La disgrâce des statues. Essai sur les conflits de mémoire, de la Révolution française à Black Lives Matter, Paris, Payot, 2022, 288 p. par Jérôme Bazin / CRHEC, Université Paris-Est-Créteil
Pour traiter le thème récurrent dans l’historiographie de l’iconoclasme, ce livre fait le choix de l’essai. Il n’est pas consacré à un espace et à un temps donné ; il n’est pas non plus un ouvrage collectif qui inviterait des spécialistes de différents terrains. Il est composé de courts chapitres, chacun dédié à une question relative aux monuments et à leurs destructions, et empruntant des exemples pris dans plusieurs lieux et moments des XIXe et XXe siècles. Le lecteur parcourt donc un grand nombre de questions : les souscriptions, les inaugurations, les critiques, les mémoires conflictuelles qui ressurgissent, les différentes formes de désacralisation, défiguration, martelage, déboulonnage, etc. L’ouvrage se termine sur la question « le musée comme solution ? » et fait le point sur les différents dispositifs actuels pour conserver et expliquer un monument dans l’espoir d’éviter sa disparition. Parmi les questions moins souvent abordées, on retiendra plusieurs chapitres sur la médiatisation des actes de destruction, pointant la force de certaines photographies et le problème qu’elles représentent – l’image photographique ne capture qu’un instant du processus dont il est souvent difficile de reconstituer l’ensemble. On peut aussi noter la grande part accordée dans le livre à la création artistique actuelle, les réflexions sur d’autres types de monuments que la traditionnelle statue d’un personnage ou les réactions d’artistes contemporains devant la dégradation de leur œuvre publique.
L 4- Bertrand Joly, Aux origines du populisme. Histoire du boulangisme (1886-1891), Paris, CNRS Éditions, 2022, 800 p. par Jean Garrigues / POLEN, Université d’Orléans
Au fil d’ouvrages érudits et souvent décapants, depuis son Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français, 1880-1900 et sa biographie de Paul Déroulède. Le père du nationalisme, deux ouvrages publiés en 1988, en passant par son ouvrage sur Nationalistes et Conservateurs en France, 1885-1902 (2008) et par son Histoire politique de l’Affaire Dreyfus (2014), Bertrand Joly s’est imposé comme l’un des plus grands historiens du nationalisme français au tournant du XIXe et du XXe siècles, et mieux encore comme l’un des plus grands spécialistes de l’histoire politique de la IIIe République. Son nouvel opus, consacré à l’histoire du boulangisme de 1886 à 1891, se situe dans la continuité parfaite de ses ouvrages précédents, tant par les qualités d’érudition impressionnantes qu’il déploie que par la perspicacité et la lucidité roboratives qui sont la marque de fabrique d’un historien sans tabou ni parti pris idéologique. De la même manière que son histoire politique de l’Affaire Dreyfus se voulait une synthèse totale qui englobait tous les comportements et les sensibilités de la société française de la fin du XIXe siècle, l’histoire du boulangisme telle que la présente Bertrand Joly n’est pas seulement une histoire de la crise boulangiste et de son déroulement, mais bien une histoire politique globale de la France des années 1880. Si la crise en elle-même est relativement bien connue des historiens, notamment depuis les travaux pionniers de Jacques Néré (1959), Frederic Seager (1969), Steven Englund (1981), William D. Irvine (1989) et Jean Garrigues (1992), il manquait à l’historiographie française une véritable somme qui, sans être définitive, fait un point érudit sur tous les aspects de la question.
C’est ainsi qu’avant d’étudier le déroulement de la crise proprement dite dans la quatrième partie de ce volumineux ouvrage, Bertrand Joly, comme à son habitude, dresse d’abord le tableau de la France des années 1880 afin d’en identifier les causes puis raconte la naissance du mouvement boulangiste à partir des élections cruciales de 1885 et inventorie dans un troisième temps les différentes facettes politiques du mouvement ainsi que sa sociologie. Chacune des quatre parties de l’ouvrage déroule une analyse experte et étayée sur une maîtrise impressionnante des sources et de la bibliographie sur le boulangisme. Parmi les chapitres les plus neufs, et surtout les plus éclairants, on notera notamment celui qui traite de la crise du parlementarisme européen dans les années 1880 et singulièrement des questionnements institutionnels en France, clé de compréhension des ralliements politiques au boulangisme.
L 5- Christophe Batardy, Le Programme commun de la gauche (1972-1977). C’était le temps des programmes, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2021, 512 p. par Matthieu Trouvé / Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux
L’ouvrage de Christophe Batardy, Le Programme commun de la gauche (1972-1977), est le résultat d’une thèse de doctorat d’histoire soutenue en 2016, sous la direction de Laurent Jalabert, publiée en 2021 aux Presses Universitaires de Bordeaux. Plus que l’histoire d’un texte électoral, le livre retrace plus de dix années de relations entre le Parti socialiste français (PS), le Parti communiste français (PCF) et les radicaux de gauche (devenus Mouvement des radicaux de gauche, MRG, en janvier 1973). Le 12 juillet 1972, ces trois formations politiques se mettent d’accord sur un « programme commun de gouvernement », préfiguration d’une Union de la gauche dont l’origine, rappelle l’auteur dans la première partie du livre, remonte au début des années 1960. L’alliance électorale de 1972 est, en effet, le fruit de longues discussions qui démarrent véritablement dix ans auparavant alors que le PCF, longtemps premier parti de gauche sous la IVe République, se trouve pénalisé par le scrutin uninominal à deux tours désormais utilisé pour les législatives sous la Ve République. Dès le mois de mai 1961, plusieurs leaders communistes, à l’instar du secrétaire général du PCF Waldeck Rochet, souhaitent la mise en place d’un « Front unique » et d’un « rassemblement des forces démocratiques » autour d’un « programme commun ». Pour les socialistes, le nouveau contexte politique – fin de la guerre d’Algérie, rupture de la SFIO avec de Gaulle, élections législatives de 1962 et référendum portant sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct – rend possible et acceptable le rapprochement avec les communistes.
Résultat de recherches menées aux archives nationales, au Centre d’histoire du travail de Nantes, dans les archives de la Fondation Jean-Jaurès, dans les fonds du PCF aux archives de Seine-Saint-Denis et dans plusieurs archives départementales, auxquelles s’ajoutent la réalisation d’entretiens et l’étude de la presse nationale, publié dans la collection « Politique XIXe–XXe siècles » dirigée par Bernard Lachaise et Sébastien Laurent, le livre est agrémenté de riches annexes comprenant documents iconographiques, tableaux et chronologie finale. Il contient de très nombreux détails sur les négociations entre socialistes et communistes français dans les années 1970 et retrace avec beaucoup de précisions le contexte politique, électoral et partisan d’une époque qui était celle des grands textes et programmes politiques. La démarche chronologique est claire et convaincante et ne néglige pas les questions thématiques. L’ouvrage de Christophe Batardy est ainsi une référence indispensable pour tous ceux qui s’intéressent de près à l’histoire du socialisme français sous la Ve République et s’inscrit dans une histoire programmatique du politique.
L 6- Étienne Ollion, Les candidats. Novices et professionnels en politique, Paris, PUF, 2021, 304 p. par Annis Ghemires / ISP, Université Paris-Nanterre
Avec Les candidats, Étienne Ollion, directeur de recherche en sociologie au CNRS et professeur associé à l’École Polytechnique, revient, dans une étude particulièrement riche et stimulante, sur les conséquences du renouvellement inédit de l’Assemblée nationale lors des élections législatives de 2017. Alors que la tendance était à l’augmentation croissante du temps passé en politique dans la « file d’attente des postes politiques » avant l’accès à des positions centrales, les députés de 2017 sont bien moins expérimentés que leurs prédécesseurs. Parmi eux, une centaine de novices de la politique, dont l’entrée au Palais Bourbon permet à Étienne Ollion, dans une sorte de « quasi-expérience naturelle » (p. 15), de dénaturaliser et d’analyser finement certains aspects de l’activité politique moderne et du fonctionnement du champ politique.
La déconvenue des novices n’a pas été sans effet sur la place institutionnelle de l’Assemblée nationale. Alors que 2017 avait vu le retour au Palais Bourbon d’élites sociales qui dédaignaient de plus en plus un mandat parlementaire dont l’influence et la rémunération avaient décru – contrairement aux contraintes et contrôles l’accompagnant, et que les espoirs de renouvellement des pratiques politiques étaient forts, la XVe législature a été marquée par l’affaiblissement d’un Parlement déjà mal en point. Les novices, dénués de l’expérience ou des savoirs institutionnels nécessaires, n’ont pas réussi à peser dans le rapport de force avec l’exécutif, et l’Assemblée a été le plus souvent cantonnée à un rôle de chambre d’enregistrement de décisions prises ailleurs. Réduite à un changement de visage sans véritable transformation structurante, la « révolution » de 2017 a fait long feu.