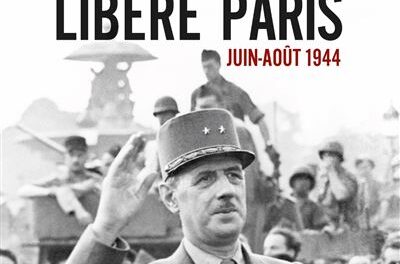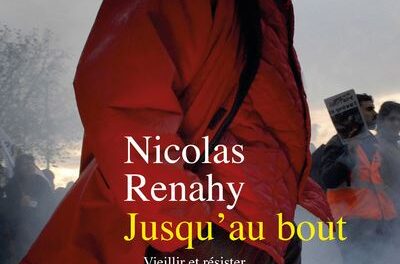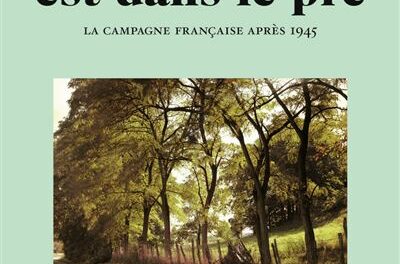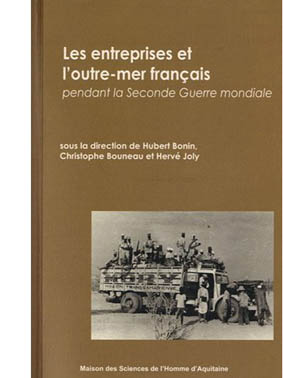
Cet ouvrage réunit 18 contributions d’un colloque tenu en novembre 2008 à la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine. Il est présenté par Hubert Bonin (IEP Bordeaux), spécialiste bien connu d’histoire économique, très actif au sein de la Société française d’histoire d’outre-mer (SFHOM) et Catherine Coquery-Vidrovitch (Paris VII), dont on ne compte plus les ouvrages sur l’Afrique coloniale. Christophe Bouneau (Bordeaux III) et Hervé Joly (CNRS) sont connus pour leurs travaux d’histoire économique, dont certains concernent les entreprises sous Vichy.
Au carrefour de plusieurs champs de recherches
L’ouvrage est au carrefour de l’histoire de Vichy aux colonies et de l’histoire économique de l’outre-mer, sujets longtemps négligés. Comme Hubert Bonin le souligne, la question de Vichy aux colonies n’a fait l’objet d’un ouvrage collectif qu’en 2003. On nuancera légèrement le constat en rappelant que de nombreux travaux ont été poursuivis dans les ex-colonies et/ou actuels DROM depuis un quart de siècle, ce que les observateurs situés dans l’Hexagone ont parfois tendance à sous-estimer. L’histoire économique sous Vichy n’a, quant à elle, été abordée pour l’outre-mer que par quelques pionniers. Jacques Marseille passe d’ailleurs rapidement sur le sujet.
Sans doute conscient des stéréotypes hérités de Lénine et d’une certaine vulgate tiers-mondiste, Hubert Bonin rappelle, s’il en était besoin, le caractère infondé de la croyance en une collusion systématique du « Capital » et de l’État colonial. Il renvoie entre autres aux études sur le patronat européen au Maroc ou sur le coût de la tutelle coloniale en Algérie. On pourra ajouter, pour les lecteurs de cette chronique, des démonstrations de Jacques Marseille sur le fait que tous les (et non « le ») capitalismes français, pas plus que tous les salariés de l’industrie ou de l’agriculture, n’avait intérêt à une tutelle coloniale. On songe à l’exemple des savonneries où on aurait préféré acheter à bas prix hors de l’empire les oléagineux nécessaires. On songe aussi aux petits viticulteurs du Languedoc confrontés aux grands domaines de l’Algérie coloniale qui liaient excellents rendement à l’hectare, économies d’échelle et main-d’œuvre indigène bon marché, misérable et privée de droits politiques et sociaux. Parmi les difficultés que peut avoir rencontré l’historiographie, il relève, entre autres, les prélèvements allemands, la guerre maritime elle-même, les ports, situés en zone militaire ou en zone non occupée, la politisation des conceptions de l’empire ou celle des retombées de la guerre sur la société française avec l’exemple de Paul Baudoin qui devient ministre des affaires étrangères de Vichy après avoir été directeur général de la banque d’Indochine. Catherine Coquery-Vidrovitch rappelle de son côté que les colonies permettaient à la France de continuer à prétendre à une certaine indépendance. C’est d’ailleurs ce à quoi renvoie le discours de Vichy qui n’a de cesse de glorifier l’importance de la possession d’un empire. Parmi les pistes évoquées, celle de l’industrialisation des colonies revient effectivement sous beaucoup de plumes à cette époque. On la retrouve dans plusieurs des entreprises étudiées, même quand il ne s’agit que d’exprimer des velléités.
Une conception assez large de la notion d’entreprise
Une première partie est consacrée aux stratégies françaises et allemandes face à l’outre-mer. La seconde traite des entreprises ultramarines face au conflit. Les auteurs abordent une entreprise au sens strict (Suez, SNAF-De Dietrich, ), une branche d’activité nationale ou régionale (industrie automobile française, coton français, caoutchouc indochinois, huileries bordelaises), un port (Bordeaux) ou l’ensemble des entreprises d’une colonie (Togo, Guadeloupe, Côte des Somalis). Sur 21 chercheurs, 15 appartiennent à des institutions métropolitaines. 1 auteur est en Guadeloupe, 2 proviennent du Togo, 1 d’Allemagne, 1 du Royaume-Uni et 1 d’Algérie.
Des intentions de l’Occupant au complot synarchique
Chantal Metzer revient sur les visées allemandes en AEF, dans les territoires naguère confisqués par la Société des nations (Togo, Cameroun). S’il est indéniable qu’il existait une tentative de mainmise allemande, celle-ci était surtout d’ordre économique, même si des volontés de tutelle politique ont pu exister. Ainsi, pour Marianne Boucheret, si le Reich ne considère pas que le caoutchouc indochinois vaille la peine de prévenir une occupation japonaise, il s’intéresse malgré tout à cette matière première. Mais, démontre Marcel Boldorf, les Allemands n’ont pas pu obtenir tout ce qu’ils voulaient dans le commerce colonial français, sauf accès direct aux matières premières quand il y avait des moyens de transport. C’est le cas pour l’Afrika Korps en Tunisie, à propos de cargaisons d’huile expédiées en Allemagne lors du rembarquement de 1943. Annie Lacroix-Ruiz, dont les thèses sont souvent discutées, affirme quant à elle le choix de la Pax Americana, plutôt que du « Blitzkrieg » par les hommes de la « synarchie ».
Adapter l’entreprise à la nouvelle situation
Dans l’ensemble, les auteurs déclinent la multiplicité des modes d’adaptation selon la situation stratégique et la culture d’entreprise.
Dans le cas de la Société nord-africaine de construction mécanique et ferroviaire (SNAF – De Dietrich), Mohammed Salah-Bouchekour montre que l’adaptation commence dès 1935, puisque, basé en Alsace, le groupe s’implante en Algérie afin de prévenir une invasion de la France. L’entreprise doit alors s’adapter à un contexte qui est celui d’un capitalisme marchand dominé par quelques grandes familles de colons exploitant une main d’œuvre peu qualifiée. Elle devient par la suite un des moteurs essentiels de l’industrialisation algérienne. Dans de grandes entreprises capitalistes comme Suez et la Compagnie française de l’Afrique occidentale (CFAO), présentées par Hubert Bonin, les dirigeants disposent d’un certain capital de savoir-faire. Ils s’adaptent à l’autonomie permise par la coupure avec leurs sièges métropolitains.
Les entreprises et les structures sont évidemment tributaires des évolutions du conflit. Abdou-Karim Tandjigora estime que celui-ci a plus d’impact sur les maisons de commerce du Sénégal que la crise des années 1930. Jean-François Grevet montre pour l’industrie automobile (qui nous renvoie encore à la thèse de Jacques Marseille), que la voie impériale se consolide dans les premiers temps de l’Occupation. Berliet développe même une stratégie durable sur le continent africain. Julien Pellet note que le port de Bordeaux, au début de la guerre, souffre davantage des difficultés de liaison avec l’Angleterre que des communications avec les colonies. Hommes, marchandises, parlementaires et même or français appareillent pour le Maroc, ce qui plaide plutôt, selon l’auteur, pour l’idée que la poursuite du combat depuis les colonies était assez répandue. Il reste que le commerce colonial s’effondre après l’Armistice, ce qu’éclaire à l’échelle des quatre huileries bordelaises, la contribution de Sébastien Durand. Dans le Togo de Komla Kouzan et Essoham Assima-Kpatcha, la période la plus difficile vient après juillet 1943.
D’autres sont plus heureux. Colette Dubois démontre comment la spécificité de de la situation des entrepreneurs de la côte française des Somalis, au débouché du chemin de fer Addis-Abeba, libéré par les Britanniques en mai 1941, a permis de rester opérationnel pendant les épreuves du conflit. Étudiées par Catherine Vuillermot, les archives de la Compagnie marocaine (Schneider), témoignent d’une entreprise qui tente de s’adapter aux pénuries multiformes. La politique apparaît peu dans les papiers de dirigeants qui s’adaptent au dirigisme de Vichy ou de la Libération. Mais on a du mal à croire qu’ils n’en parlent jamais.
Marie-Christine Touchelay explique comment la Banque de la Guadeloupe, institut local d’émission monétaire, permet aux entreprises de continuer à produire. Or, on sait qu’elles ne peuvent exporter cette production avant le passage à la France combattante en juillet 1943. Marianne Boucheret note que si le conflit affecte prix de vente du caoutchouc indochinois et prix de revient dans un mouvement en ciseaux, cette production reprend rapidement et traverse le conflit suivant.
Épuration, libération
La libération est pour les entreprises un signal de reprise des communication avec la métropole ou le reste de l’empire. Elle peut être aussi le moment des comptes.
La Société financière des caoutchoucs (SOCFIN) étudiée par William G. Clarence Smith, a ses collaborateurs, en France, et ses « résistants » à New York ou à Londres, lesquels permettent au groupe d’éviter les affres de l’épuration. Après-guerre, le fait de compter le résistant et radical Bourgès-Maunoury parmi ses dirigeants, ne fait que renforcer cette image positive.
Dans cette opposition Gaullistes-collaborateurs, on s’étonne au passage des considérations émises par Komla Kouzan à propos de de Gaulle. Cet auteur propose cependant un panorama assez complet de l’histoire économique du Togo pendant le conflit. À une échelle plus fine, Essoham Assima-Kpatcha s’est intéressée aux travailleurs togolais des entreprises privées. Pour ces travailleurs forcés, le moment du redémarrage de l’activité commerciale est le plus difficile. L’effort de guerre les met lourdement à contribution et accroît les tensions.
Ces tensions sont aussi visibles à la Guadeloupe. Dans cette colonie, où les entrepreneurs blancs sont souvent nommés maires des communes, à la place d’élus noirs, on connaissait déjà l’adhésion à Vichy des milieux économiques en même temps que leur refus d’étendre les cultures vivrières face au blocus. Marie-Christine Touchelay revient à deux reprises sur le rôle du directeur de la Société anonyme des usines de Beauport (SAUB), à Port-Louis, à la fois responsable du refus d’extension des cultures vivrières en tant que directeur de l’usine et homme-clef du ravitaillement, en tant que maire nommé par Vichy. Elle explique ainsi comment l’exacerbation des tensions sociales accélère la revendication populaire de la départementalisation, perçue comme alternative à la situation coloniale. Cela nous renvoie au problème, annoncé en introduction par Hubert Bonin, d’une guerre qui est menée au nom de la liberté contre l’oppression, influant ainsi sur le devenir des sociétés ultramarines. D’autres travaux ont montré que les ouvriers de Port-Louis se révoltent en 1943 aux cris de « Vive De Gaulle ! », s’attaquant à la gendarmerie et à l’usine du maire pétainiste nommé, symboles locaux évidents du pouvoir colonial. Cette contribution, si elle ne répète pas des faits déjà largement diffusés, nous éclaire davantage sur un épisode qui a nourri la mémoire guadeloupéenne.
Avec la maison de commerce Denis Frères, Delphine Boissarie analyse les contraintes d’une maison de commerce qui re-déploie ses activités dans la « Méditerranée asiatique » chère à Braudel. On y lit aussi les difficultés de sortie de guerre d’une entreprise qui doit prouver sa non-collaboration avec les Japonais alors même qu’une partie des employés censés justifier des opérations du temps de guerre n’ont fait que remplacer d’autres collègues ayant pris leurs congés en métropole dès la fin du conflit.
Les entreprises coloniales dans nos classes ?
On a, bien sûr, parfaitement le droit de lire cet ouvrage pour le plaisir. Il me semble cependant qu’il vient à point nommé pour actualiser et enrichir des exemples d’histoire économique dans nos cours consacrés à Vichy ou à l’empire colonial. Trop souvent, ces sujets apparaissent aux élèves comme des scènes de théâtre hors-sol où se jouent des drames qui seraient « purement politiques ». Or, si l’opportunité d’être clairement un héros ou un traître ne se présente qu’à une minorité de gens, la plupart des individus agissent au quotidien dans le cadre d’une entreprise. Jacques Marseille prétendait justement, dans sa thèse, lutter grâce à l’histoire économique, contre une certaine histoire « sur coussins d’air ». Les représentations, la propagande, les restrictions du droit civil et des libertés politiques ne suffisent pas à rendre compte du quotidien de Vichy et des colonies. À côté d’autres documents (par exemple un extrait de Sarraut sur l’autofinancement des colonies et/ou un tableau comparant les rendements et les tailles des exploitations viticoles languedociennes et algériennes), on peut étayer un cours d’un certain nombre d’exemples pris dans cet ouvrage. S’il faut aller plus loin, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l’histoire en terminale S, on peut tout juste évoquer la possibilité de bâtir une étude de cas pour une bonne première L-ES, dans le chapitre sur la colonisation.