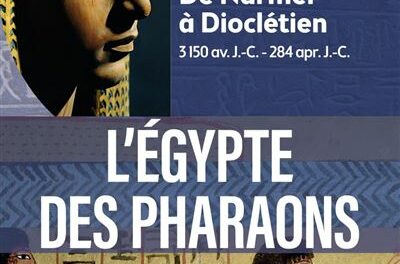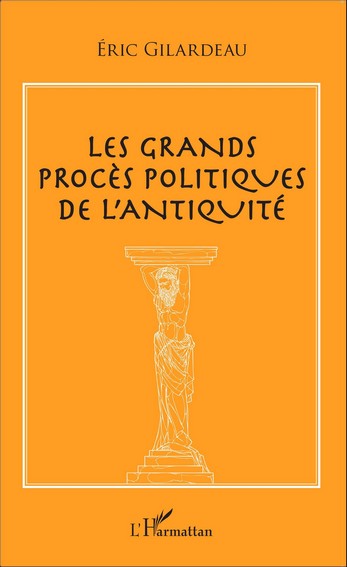
LES GRANDS PROCES POLITIQUES DE L’ANTIQUITE GRECQUE
Le procès des Arginuses
Les faits : A la bataille des Arginuses de 406, Athènes obtient une victoire navale inattendue contre Sparte. 8 stratèges et 2 triérarques dirigent cette expédition au cours de laquelle une tempête se déchaîne et la victoire est ternie par la perte de centaines de marins. Une fois rentrés à Athènes, les généraux doivent rendre des comptes pour le sauvetage avorté de ces derniers.
Dans la cité, bien des voix soutiennent une aristocratie tempérée, régime que Théramène, l’un des triérarques, avait instauré à la suite d’un coup d’état entre 411 et 410. Ce procès est donc l’affrontement de deux lignes politiques : les partisans d’un pouvoir aristocratique contre les tenants d’une démocratie directe.
L’analyse : E. Gilardeau voit dans ce procès un coup significatif porté à la démocratie. De nombreuses entorses à la procédure pénale sont commises. Objet d’une procédure d’exception, l’eisangélie, qui voit leur sort remis entre les mains non de l’Héliée mais de l’Ecclésia, les stratèges ne bénéficieront que de la moitié du temps légal pour se défendre (collectivement et non individuellement comme ils en avaient le droit) au cours d’une séance opportunément interrompue alors que leurs concitoyens semblaient convaincus de leur innocence. Enfin, les débats décisifs ont lieu le jour de la fête des Apatouries, jour de commémoration des morts, ce qui permettra à Théramène d’exploiter la grogne populaire en faisant comparaître la famille des naufragés en tenue de deuil. Socrate, en sa qualité d’épistate, décide bien de soutenir la graphè paranômon, une procédure ancienne permettant d’empêcher un décret allant à l’encontre des lois fondamentales d’Athènes. Mais Théramène, parvient à neutraliser cette manœuvre. Les stratèges sont finalement condamnés.
Le bilan : Il s’agit là d’un procès charnière car il montre que l’Ecclésia puis la Boulè ont accepté de multiples entorses aux principes démocratiques, signe d’une disparition de la foi en la démocratie directe. La toute-puissance de l’assemblée a été ici manipulée à son propre profit par la faction aristocratique qui a conduit non seulement le démos à bafouer ses propres lois mais surtout à créer le germe des futures crises à venir, particulièrement la tyrannie des Trente.
Le procès de Socrate
Les faits : L’image que nous héritons de Socrate et son procès est déformée aux yeux d’E. Gilardeau. Symbole de la lutte contre l’obscurantisme, le philosophe est avant tout un tenant de la conception censitaire de la démocratie. Et s’il comparaît pour les griefs d’impiété et de corruption de la jeunesse, son procès a bien un fondement politique. En effet, deux aspects de sa pensée constituent une menace pour le régime. Socrate est opposé à toute forme de participation à la vie politique car, contrairement au dialogue maïeutique qu’il promeut, le débat public ne conduit qu’à la démagogie et aux luttes de factions. De plus, proche en cela du réformateur Solon, il pense qu’une catégorie d’homme est exclusivement habilitée à gouverner, les plus riches, seuls à offrir les garanties d’indépendance, d’éducation et de moralité.
L’analyse : Dans le strict respect du droit pénal, Socrate est ainsi jugé pour impiété, infraction à l’ordre public et à la sécurité de l’état. Dans une cité où le spirituel et le temporel ne sont pas distincts, professer une forme d’athéisme est donc une marque d’incivisme.
Socrate argumente avec minutie sa défense. Il fait référence au procès des Arginuses pour montrer qu’il a été d’une obéissance sans faille à la loi mais aussi que, conformément à son sentiment, la liberté des citoyens les a conduits à la démagogie et l’abus de pouvoir. Sa plaidoirie le fait habilement glisser du statut d’accusé à accusateur dont les cibles ne sont autres que la Boulè et l’Ecclésia elles-mêmes. Remettant en cause les fondements du régime en guise de défense, sa condamnation est inéluctable. Les sentences de culpabilité puis celle de mort sont adoptées, contrairement à la légende, à une majorité assez nette.
Le bilan : Le peuple ne réagit donc pas sous le coup de l’exaspération mais dans la pleine conscience que le procès était politique. Du reste, les idées de Socrate lui survivent puisqu’Antipatros, le lieutenant d’Alexandre, impose à Athènes une constitution proche des idées de Socrate en 322 av. J-C.
La passe d’armes entre Eschine et Démosthène
Les faits : Face à la Macédoine de Philippe II puis Alexandre, qui prennent petit à petit le contrôle de la Grèce au milieu du IVe s., Démosthène et Eschine, deux des plus grands orateurs de leur temps, incarnent des lignes opposées sur la conduite à tenir. Eschine, favorable à une aristocratie tempérée, propose une collaboration avec la Macédoine tandis que Démosthène est érigé en champion de la résistance, seul moyen de sauver la démocratie directe. L’enjeu de la discorde est l’ambassade menée en 346 par Athènes auprès de Philippe II, connue sous le nom de Paix du Roi, qui put faire croire, pour un temps, que la cité était parvenue à endiguer son invasion. Les deux hommes participent à cette mission et se renvoient mutuellement les accusations de trahison envers le peuple athénien, de collusion avec l’ennemi et s’imputent mutuellement les défaites militaires qui se succèdent. Au-delà, il s’agit surtout de déterminer quel parti serait légitime pour gouverner la cité.
L’analyse : La passe d’armes entre Eschine et Démosthène s’étale sur près de 16 années et nécessite trois procès. E. Gilardeau nous permet d’en retenir trois évolutions majeures :
– si les deux orateurs sont de fins connaisseurs du droit pénal, ils n’hésitent pas à utiliser également des accusations mensongères souvent puisées dans la vie passée et les mœurs de leur adversaire. Les parties n’invoquent plus seulement les actes concrets mais aussi les attitudes personnelles, les intentions réelles ou supposées de leurs vis-à-vis pour obtenir gain de cause.
– l’ostracisme étant tombée en désuétude, l’Ecclésia n’est plus le lieu qui permet d’évincer un adversaire politique. Un glissement significatif s’opère en fait de l’Ecclésia vers l’Héliée. Cette dernière devient une arène politique appelée à juger, à travers les hommes, les orientations politiques de la cité et donc à se substituer à l’Ecclésia.
– les procès font resurgir le vieux débat sur la primauté des lois fondamentales sur les décrets adoptés par les citoyens. E. Gilardeau montre que si la victoire finale revient à Démosthène, Eschine remportera plusieurs « manches » de ces trois procès sur le strict plan du droit pénal. Mais il ne parvient pas à convaincre les jurés des intentions malfaisantes de Démosthène ni des bienfaits de la politique de collaboration qu’il avait choisie.
Le bilan : Certes, Eschine est exilé et Démosthène et son parti sont confirmés dans le gouvernement de la cité mais la défaite finale des Athéniens en 322 face à Antipatros signe la fin de la démocratie.
LES GRANDS PROCES DE L’ANTIQUITE ROMAINE
Le procès de Sextus Roscius
Les faits : Depuis le IIe s., une lutte féroce s’établit au sein de la nobilitas romaine. Les populares, incarnés par des personnages illustres comme Les Gracques ou Marius, se veulent les représentants des classes populaires (réforme agraire, extension du droit de suffrage). Ils utilisent à leur profit l’opposition de classe entre ordre équestre et sénatorial et s’appuient sur une magistrature en plein essor, le tribunat de la plèbe. A l’opposé, les optimates, dont Sylla est le champion, se posent en défenseurs des traditions républicaines et ses grandes familles entendent sauvegarder leurs privilèges et la mainmise sur le Sénat.
Sylla défait les populares et instaure une dictature où meurtres, proscriptions, confiscations se multiplient. Mais les optimates n’y trouvent pas leur compte tant Sylla les dépossèdent de leurs privilèges sociaux et politiques.
C’est dans ce climat que Roscius, riche propriétaire appartenant à la clientèle des Metelli, est assassiné en 81. Quelques jours plus tard son héritage est capté légalement par Chrysogonus, un proche de Sylla, pour une somme dérisoire et une part en est remise à deux de ses cousins. C’est le fils de Roscius qui sert de bouc-émissaire et est accusé de parricide. Signe de la défiance généralisée envers Sylla, les Metelli, dont ce dernier est pourtant un proche, engagent le jeune Cicéron pour assurer la défense de Roscius.
L’analyse : Cicéron met en pièce les accusateurs sans réelle difficulté tant la confiscation dont a fait l’objet Roscius s’inscrit dans une longue liste de précédents et les preuves produites par l’accusation sont incertaines. En revanche, il mène avec maestria la conversion de cette affaire en procès politique. Erigé en procureur de Sylla, maniant tour à tour rigueur et ironie cinglante, il rappelle le caractère abominable des proscriptions menées par ce-dernier, et insinue qu’il a tiré les ficelles de la spoliation de Roscius. Il le présente comme l’antithèse des principes fondateurs de la République. C’est tout aussi habilement qu’il met les jurés face à une responsabilité historique et personnelle. A travers leur verdict, ils ont le choix de défendre la dictature, à laquelle beaucoup d’entre eux doivent leur promotion, ou sauver la République de la tyrannie. Roscius sera acquitté à une large majorité.
Le bilan : Sylla se retire de la vie politique en 79. E. Gilardeau voit dans l’affaire Roscius la raison de cet énigmatique retrait. En effet, il avait construit son ascension en se présentant comme le défenseur de la tradition républicaine cependant qu’il exerçait une monarchie de fait et dépouillait silencieusement la nobilitas de ses prérogatives. Il n’en reste pas moins que Sylla a montré la voie à César puis Auguste vers un pouvoir personnel.
Le procès de Muréna
Les faits : Cicéron défend, en 63, Murena, un général s’étant illustré pendant les guerres mithridatiques et appelé à devenir consul pour l’année 62. Or Muréna s’est rendu coupable de corruption électorale selon les termes d’une loi adoptée à l’initiative… de Cicéron !
Rome est alors toujours déchirée par la rivalité entre les populares de César et Crassus et les optimates tandis que Pompée s’affirme à la tête d’une nouvelle faction issue de l’ordre équestre. Les ambitions personnelles des différents protagonistes génèrent de nombreux complots politiques et armés à l’image de la conjuration de Catilina. Ce dernier, un sénateur ruiné et briguant le consulat, prend la tête, avec l’appui de César, d’une conjuration de sénateurs désargentés et mécontents. Le plan de Catilina est d’ obtenir le consulat légalement et, en cas de défaite, mettre Rome a sac. Mais le projet tourne court. Les incessantes harangues de Cicéron au Sénat font leur effet : César lâche Catilina et le Sénat déclare celui-ci ennemi de Rome en octobre 63. Catilina déploie alors ses troupes en Etrurie, prêt à agir.
L’analyse : Sulpicius et Caton sont les accusateurs de Muréna. Cicéron défend, lui, un client notoirement coupable. Or, tout son génie tient à faire admettre que la question de la culpabilité de Muréna est sans importance. En revanche, il sait faire vibrer une corde sensible auprès des jurés en rappelant le projet éventé de Catilina, la disparition à venir de la République. Il n’hésite pas à s’en prendre personnellement à un adversaire aussi respecté que Caton. Enfin et surtout, il rappelle les qualités d’orateur et de soldat de Muréna indispensables en ces temps de crise. Il sous-entend habilement que le priver la cité de son consul, c’est prendre fait et cause pour Catilina et décapiter la République.
En définitive, Cicéron, quoiqu’il en coûte à son infini respect du droit et des institutions, invente ce que nous appelons communément la raison d’Etat (ratio republicae), au nom duquel l’intérêt supérieur de la cité prime sur l’application stricte des lois. En temps de crise, c’est à l’ordre public de dicter le jeu des institutions et ceux qui en sont les garants ne doivent pas subir les contraintes légales ordinaires. Et pour ne pas priver une cité en pleine guerre civile de son 2e consul, les juges acquittent Muréna.
Le bilan : les mains libres, Cicéron se consacre à la répression de la conjuration. Les troupes de Catilina sont écrasées et Muréna exerce ses fonctions consulaires. La République y gagne un répit de 15 ans.
Le procès de Pison
Les faits : Tibère a succédé à Auguste et connaît un début de règne fragile. Alors qu’il a lui-même un fils, Drusus, Auguste lui impose l’adoption de son neveu Germanicus afin d’ancrer le principe dynastique dans sa famille. Après le décès d’Auguste, Tibère tente d’évincer ce rival aux glorieux faits militaires. Il l’éloigne de Rome en lui donnant le commandement sur tout l’Orient romain et confie à Pison, un de ses proches ayant lui aussi des prétentions à la succession impériale, le gouvernement de la province de Syrie avec pour mission de saboter l’action de Germanicus. La rivalité et l’hostilité monte entre les deux hommes jusqu’à ce que Germanicus succombe à une maladie. Pison comparaît alors pour empoisonnement.
L’analyse : Tibère est dans une position délicate. Il sait sa légitimité fragile et peut apparaître comme le commanditaire du meurtre supposé. Par ailleurs, la femme de Germanicus est apparentée à Auguste et peut réclamer la succession pour ses enfants. C’est donc le trône impérial qui se joue. Soucieux de paraître impartial tout en contrôlant l’affaire en sous-main, Tibère prend les devants en renvoyant l’affaire au Sénat. Les accusateurs de Pison sont deux lieutenants de Germanicus. S’ils ne peuvent faire la preuve qu’il a tué leur général, ils n’ont aucune difficulté à démontrer les turpitudes dont a fait preuve Pison dans la conduite de sa province.
Pison est alors abandonné de tous côtés. En proie à l’hostilité du Sénat et du peuple, lâché par Tibère, il met fin à ses jours et le nom de l’empereur et sur toutes les lèvres. Mais Pison a laissé une lettre le disculpant. Tibère a donc les mains libres et a l’habileté de laisser la procédure se poursuivre. Le Sénat condamne Pison mais le verdict est relativement clément pour son épouse et ses enfants.
Le procès politique a alors changé de forme. En effet, Tibère a atteint ses objectifs : renforcer son autorité et garantir la succession de son fils Drusus. Surtout, il a réussi à faire du Sénat une chambre de justice extraordinaire, en marge des procédures judiciaires traditionnelles. Cette évolution majeure des institutions s’accompagne de l’essor d’un nouveau crime la majestas ou crime de lèse-majesté dont la définition est large car exclusivement fondée sur la jurisprudence : refus de sacrifier à l’empereur, insulte à sa mémoire ou son image, libelles…
Le bilan : le Sénat est devenu l’instrument docile de la volonté du Princeps. Chaque sentence dessine et affermit un corps de doctrine que la plèbe, l’ordre équestre, les Sénateurs et l’armée ont vocation à suivre. La justice est devenue une arme à la fois de propagande et de répression. Les dernières années du règne de Tibère sont d’ailleurs marquées par de nombreuses purges.
CONCLUSION
Au terme de cet ouvrage, E. Gilardeau démontre ce qui semble inadmissible à nos yeux de contemporain : le procès politique peut coexister avec un gouvernement démocratique et des institutions républicaines. Le lecteur en appréciera les qualités formelles, celles d’un ouvrage organisé avec une extrême rigueur dans la présentation des étapes de la réflexion et sait faire revivre la passion des débats politiques. Il s’accompagne d’explications historiques claires qui le rendent accessibles aux non-initiés. Les enseignants des classes de sixième et seconde y trouveront des outils pour éclairer d’un nouveau jour le fonctionnement de la citoyenneté antique à travers l’institution judiciaire.