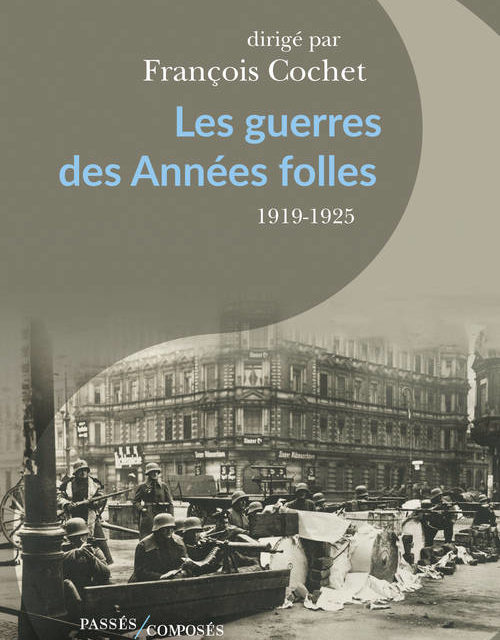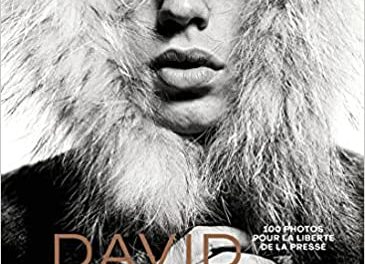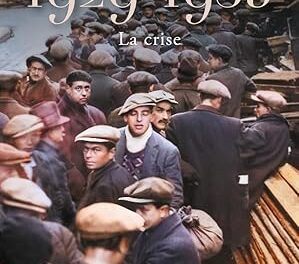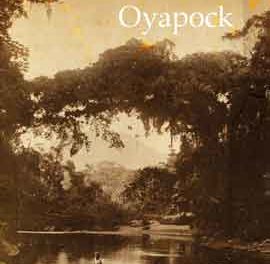1914-1918 : la Première Guerre Mondiale fait encore partie des événements dont les bornes chronologiques restent bien marquées dans la mémoire de la majorité de nos contemporains. Mais, si une longue préparation et les perceptions faussées réciproques des antagonistes rendirent extrêmement rapide le passage d’un état de paix installé depuis des décennies sur la plus grande partie de l’Europe à celui de guerre généralisée au cours de la terrible fin d’été 1914, l’armistice du 11 novembre 1918 ne fut qu’une étape (certes la plus marquante) d’une sortie de conflit qui devait s’avérer troublée et encore empreinte de violence.
C’est à cette période confuse qu’est consacré cet ouvrage ; coordonné par François Cochet, professeur émérite de l’université de l’université de Lorraine-Metz en histoire contemporaine, spécialiste des conflits et de l’expérience combattante, il est constitué d’une dizaine de contributions complémentaires rédigées par un collectif d’universitaires.
Illusions perdues
La si meurtrière première guerre mondiale pouvait-elle s’avérer « La Der des Ders », comme le rêvaient à son terme les rescapés du conflit ? Dans une courte introduction, François Cochet jette immédiatement à bas cette illusion ; puis, dans un premier chapitre intitulé « De la guerre suspendue à la guerre hors-la-loi, 1918-1924 » (p.13-43), il décrit tout d’abord le contexte, les conditions mises en place par l’armistice du 11 novembre 1918 et les traités qui mettent officiellement fin au conflit. Loin d’être « bâclé », comme certains milieux le prétendront plus tard, l’armistice de Rethondes est rendu quasiment inexorable par un faisceau de circonstances.
Fatalement, il impose cependant aux belligérants de rester l’arme au pied, et il s’avère que les traités sur lesquels il va déboucher restent belligènes : les vaincus n’y sont pas associés (ce qui n’est pas, en soi, exceptionnel historiquement parlant), ils souffrent de contradictions entre une volonté juridique théorique et son application concrète, sont issus de compromis bancaux entre Alliés aux idées et intérêts divergents, et certains (les EUA) s’en désolidarisent très vite, ruinant la crédibilité de l’ensemble. Entre autres choses, faire respecter les conditions dictées lors du traité de Versailles impose ainsi à la France de rester sur ses gardes sur la frontière Est, après une longue démobilisation. Le système issu du règlement du conflit s’avère donc trop fragile pour assurer une paix définitive, et les progrès en ce sens, à la charnière des années 30, seront ruinés par la crise économique.
C’est justement sur « les postures américaines : de plus en plus loin du wilsonisme » (p.45-77) que s’interroge Michaël Bourlet, ancien officier de l’armée de terre, agrégé et docteur en histoire de Paris-Sorbonne. C’est au motif de la défense du droit des neutres et de la liberté des mers que les Etats-Unis entrent en guerre en avril 1917. Des motivations à la fois économiques, politiques et morales guident pareillement le président Wilson dans l’organisation des relations internationales qu’il propose pour le monde d’après-guerre, en particulier dans son programme en 14 points dévoilé en janvier 1918.
Mais la conjonction des ambitions territoriales des autres Etats vainqueurs, des intérêts nationaux divergents et des priorités américaines, exprimées par la majorité républicaine, mettent vite fin à ses espoirs d’établissement d’un système de sécurité collective. L’armée américaine se désengage rapidement du théâtre européen (Allemagne, Dalmatie) alors qu’elle resserre son emprise sur l’Amérique latine en vertu d’une réaffirmation de la théorie du « Big stick » et du corollaire Roosevelt. En Sibérie, son intervention (1918-1920), mal préparée et dont les objectifs sont peu définis, s’achève piteusement, laissant le champ libre à la politique d’expansion territoriale du Japon, à laquelle la diplomatie et les traités de Washington (1922) permettent néanmoins de marquer un coup d’arrêt. Puissants, prospères et apaisés, les Etats-Unis abordent les années 20 avec une approche qui mêle « Realpolitik » et réel désir de gérer les différends par la concertation.
Difficile chemin de Damas
Le destin des vaincus est évidemment bien plus complexe. Dans « L’Orient ou la guerre continuée, 1919-1925 » (p.79-106), Julie d’Andurain, professeur en histoire contemporaine à l’université de Lorraine-Metz, relate de façon très détaillée comment vont se mettre en place les cadres politiques des territoires issus du démembrement de l’Empire Ottoman. Les traités de San Remo et de Sèvres (avril et août 1920), formalisant celui-ci et établissant le système des mandats, provoquent des réactions nationalistes, turques et arabes, qui vont enflammer le Proche-Orient sur toute la période.
La première est menée par Mustapha Kemal, qui réussit à s’imposer aux Français en Cilicie (1921), prélude au traité de Lausanne (août 1923) qui établit la Turquie moderne. Dans l’espace syrien, l’organisation et l’objectif du mandat se dessinent difficilement, dans un contexte où s’additionnent forte rivalité franco-britannique, désintérêt latent de Paris, juxtapositions des communautés et des confessions corrélées à une montée du nationalisme arabe. Les projets de Grande-Syrie restent lettre morte tandis que le Liban acquiert son autonomie et que l’Hachémite Fayçal, meneur de la révolte arabe installé comme souverain, est chassé de Damas par les troupes françaises après la défaite de Khan Meyssaloun (juillet 1920). Les insuffisances des autorités militaires du mandat conduisent ensuite à la révolte druze, sévèrement réprimée (1925) ; la nomination conséquente de proconsuls civils, et le maintien de l’état de fait, se croisent dès lors avec la certitude que la présence française ne pourra être pérenne.
Professeur en histoire contemporaine à l’université de Lorraine – Nancy, Jean-Noël Grandhomme revient ensuite sur « le démantèlement de l’Empire des Habsbourg » (p.107-136). L’auteur rappelle que la dislocation de cette construction multiséculaire en Etats complètement indépendants n’était pas inéluctable en 1914, à contrario de ce qu’a pu avancer l’historiographie de certains de ceux-ci ; elle est l’effet délétère d’une longue guerre perdue. Et elle ne se produit pas sans heurts.
La Hongrie, en particulier, est le théâtre en 1919 d’une véritable guerre qui oppose la République des Conseils de Béla Kun, et plus généralement les Hongrois traumatisés par la défaite, aux Roumains, Tchécoslovaques et Franco-Serbes ; son écrasement permet l’établissement du régime autoritaire du régent Horthy. Une fois la situation stabilisée sur le terrain, les traités entérinent la défaite de l’Autriche et de la Hongrie ; ils créent ou agrandissent des Etats (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie) qui restent peu ou prou multinationaux. Discrimination des minorités, héritages différents sur maints plans, violence politique rendent malaisée la stabilisation de ceux-ci ; l’ensemble favorise un révisionnisme du « système de Versailles » dont les effets se feront sentir à partir de 1938 puis de la chute de l’URSS, les enjeux mémoriels persistant jusqu’à aujourd’hui (par exemple en Hongrie).
C’est au rejet du communisme, qui s’installe au pouvoir en Russie en 1917 puis tente de se diffuser au reste de l’Europe dans les années qui suivent, que s’intéresse Olivier Dard, professeur en histoire contemporaine à Sorbonne Université dans le chapitre suivant (« Refouler la révolution bolchévique », p.137-165) ; un sujet méconnu par l’historiographie, transnational mais dont il distingue les modalités dans les principaux Etats européens.
Les prétentions universalistes des Bolchéviques entraînent des réactions violentes en France, quels qu’y soient les parallèles établis par certains avec la Révolution ; celles-ci restent néanmoins teintées d’anti-germanisme et essentiellement littéraires. Plus directement concernée dans les projets des dirigeants du Komintern et dans les faits (révolte spartakiste de Berlin, république des conseils en Bavière), l’Allemagne est véritablement l’épicentre de l’anti-bolchévisme ; imprégné d’antisémitisme, émaillé d’épisodes violents, il constitue un des terreaux féconds de la période tragique du nazisme. S’il n’est pas à l’origine du fascisme italien, celui-ci s’empare vite de ce repoussoir pour justifier la montée du mouvement squadriste.
Empires chahutés
Julie d’Andurain consacre ensuite une seconde contribution à un conflit contemporain : « La Guerre du Rif : premiers pas vers la décolonisation, 1921-1926 » (p.167-193). Le soulèvement des Rifains menés par Mohamed ben Abdelkrim (1882-1963) contre les Espagnols embrase d’abord le protectorat de ceux-ci au nord du Maroc, avant de s’étendre en avril 1925 à la zone d’influence française. Il est initialement marqué par de lourdes défaites des Espagnols ; la mobilisation de gros moyens humains et matériels, côté français particulièrement, et une coopération accrue entre les deux armées acculent finalement les Rifains à la soumission en mai 1926.
Volontairement perçu, à l’époque, comme une énième révolte contre le pouvoir central marocain soutenu par les protectorats, ce soulèvement apparaît en fait comme un des premiers conflits de la décolonisation, du fait du proto-nationalisme plus ou moins avancé par Abdelkrim, et de sa pratique d’éléments de la guerre révolutionnaire (la guérilla). Militairement, elle témoigne d’un changement de dimension pour un conflit « colonial », et est marquée par de nombreuses expérimentations qui préfigurent certaines grandes opérations de la Seconde Guerre Mondiale.
L’autre grande puissance mondiale victorieuse connaît elle aussi des oppositions : Philippe Chassaigne, professeur en histoire contemporaine à l’université de Bordeaux-Montaigne, s’intéresse aux « conflits et violences de sortie de guerre dans la sphère britannique – 1919-1925 » (p.195-221). Le gouvernement britannique d’après-guerre doit faire face à des impératifs contradictoires : organiser une démobilisation militaire souhaitée par tous, assurer la domination coloniale dans un empire accru et sujet à des tensions localisées, et répondre aux enjeux géopolitiques de l’époque.
La première est menée à bien mais non sans donner lieu à un certain nombre de tensions sociales et politiques qui dégénèrent parfois en épisodes violents. Cette même violence marque l’épilogue douloureux de la « question d’Irlande », que la guerre avait provisoirement mis en suspens ; les affrontements entre indépendantistes, loyalistes et Britanniques à partir de janvier 1919 débouchent sur la naissance de l’Etat libre d’Irlande en décembre 1921, qui est encore agité d’une sanglante guerre civile (juin 1922-mai 1923). Pareillement, l’Inde, en proie aux contestations, est le théâtre du massacre d’Amritsar (13 avril 1919), la mise en place du mandat britannique en Irak donne lieu à une révolte sévèrement réprimée (1920), l’Egypte est agitée de troubles qui amènent à l’octroi de son indépendance formelle en 1922. Face aux nationalistes turcs et aux bolchéviques russes, les Britanniques (et particulièrement Churchill), d’abord tentés par l’intervention armée, doivent finalement se désengager.
De la Grande Guerre au totalitarisme
On retourne dans le camp des vaincus avec le chapitre suivant : c’est sur la république de « Weimar : de l’instabilité fondatrice à une stabilité illusoire ? 1918-1924 » que s’interroge (p.223-252) Sylvain Schirmann, professeur en histoire des relations internationales à l’IEP de Strasbourg. L’Allemagne se retrouve aux lendemains de la défaite déchirée entre guerre civile, révolution, démocratie et réaction. La République qui s’installe dans ces soubresauts se trouve dès l’origine chargée du poids de la défaite, après qu’elle ait du politiquement assumer le traité de Versailles qui lui est imposé.
Sur toute la période, la violence politique se manifeste par des coups de force des extrêmes de droite et de gauche et de nombreux assassinats ; le culte du chef, la fascination pour la violence et sa légitimation dans la vie civile hérités du conflit par une société déjà précédemment imprégnée par la tentation guerrière radicalisent les rapports de force et leur expression.
Bien que victorieux, le royaume de Victor-Emmanuel III est sorti lui aussi appauvri et déçu du conflit. Il connaît en 1919-1920 le « bienno rosso » marqué par des grèves à répétition, des occupations d’usines et des manifestations violentes. « Des années rouges aux années noires : l’avènement du fascisme en Italie » est étudié par Emmanuel Mattiato, maître de conférences à l’université de Savoie Mont-Blanc, dans le chapitre suivant (p.253-283). Faisant converger syndicalisme-révolutionnaire, nationalisme, irrédentisme et anti-bolchévisme, le fascisme mussolinien s’impose par la violence et l’alliance avec patronat et agrariens. La marche sur Rome (octobre 1922) permet à Mussolini de se voir légalement confier le pouvoir ; puis les institutions sont progressivement étouffées, les derniers adversaires politiques, tel le socialiste réformateur Matteotti, neutralisés, la dictature étant concrètement instaurée à partir de 1925.
Les somnambules
François Cochet présente enfin la reconversion à laquelle se livrent les outils militaires entre 1919 et 1925 (p.285-318). Une fois sorties d’un conflit meurtrier vers lequel les regards restent tournés, confrontées à un contexte qui demeure tendu, les grandes armées connaissent des évolutions différenciées. La française connaît d’intenses réflexions, qui sont progressivement sclérosées par un certain nombre de contraintes budgétaires et intellectuelles (pacifisme, magistère de Pétain) ; dans les années 30, la doctrine s’est définitivement figée sur la défense d’un « champ de bataille » préparé à l’Est.
Nonobstant les idées novatrices de Fuller et Liddell Hart, l’armée britannique redevient vite une petite force d’engagés chargée de la police de l’Empire ; celle des Etats-Unis doit se contenter de survivre, tandis que les innovations prônées par Patton et Eisenhower, Mitchell, Christie sont dédaignées. L’armée italienne est progressivement corsetée par le régime fasciste dans l’héritage doctrinal et matériel de la Grande Guerre ; le bombardement stratégique prôné par Douhet est préconisé sans être mis en œuvre, le royaume n’ayant dans ce domaine comme dans les autres pas les moyens de ses ambitions. C’est en Allemagne que les changements, aiguillonnés par la défaite, sont les plus féconds : la réflexion est novatrice tandis que l’armée exploite au maximum les contraintes humaines et matérielles draconiennes auxquelles elle est soumise, les contourne par maints biais ; les fondements du réarmement réussi des années 30 sont jetés.
Au final, l’ensemble de ces dix contributions brosse un tableau très fouillé de cette période mouvementée. On n’en regrettera que plus la simple évocation en creux de la Guerre Civile russe, l’absence des conflits périphériques qui s’y articulèrent (Pologne, Etats baltes, Asie centrale…), et d’un autre affrontement d’ampleur à peine mentionné dont l’enjeu mémoriel est encore fort aujourd’hui, la guerre gréco-turque de 1919-1922. Les exposés sont riches, prenants, parfois complexes car renvoyant de façon détaillée à des événements qui ne le furent pas moins. Ils sont étayés par des notes et bibliographies fournies, et quelques cartes (sauf dans le chapitre 4, où elles auraient pourtant été très utiles).
Nouveaux Etats instables et régimes révolutionnaires, rancoeurs et griefs profondément ancrés, omniprésence de la violence et brutalisation des sociétés : outre son traumatisant coût humain, tels furent les terribles legs de la Grande Guerre. D’une lecture passionnante, l’ouvrage permet de saisir comment, après son terme, et au delà de la contestation politique des traités, ils devaient définitivement s’enraciner au cours de ces quelques années, fatals germes d’autres tragédies à venir.