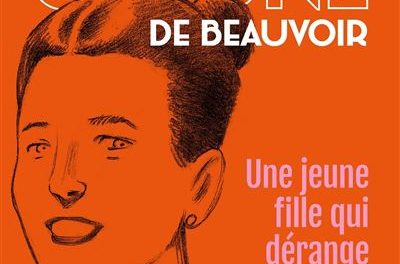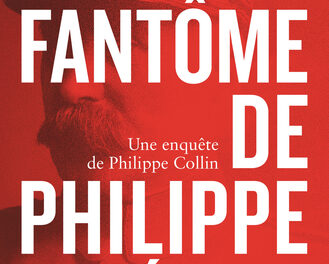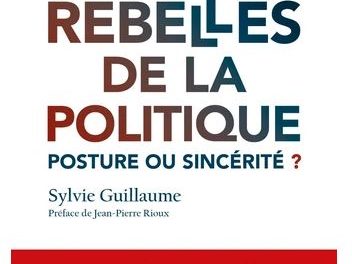Le développement spectaculaire de ces fonds date de 1990, les a tiré de leur relatif secret, et les médias s’en sont emparés. Le premier fonds date de 1949 et utilisa assez classiquement l’effet de levier pour profiter des hausses et la vente à découvert pour profiter des baisses. L’effet de levier fut particulièrement rémunérateur pendant la période d’euphorie boursière des années 60, ce qui amena à négliger les ventes à découvert. Ensuite, les turbulences furent de plus en plus fortes et un grand nombre de fonds disparurent.
Mais, en finance comment politique, la mémoire est courte et un nouveau gourou apparut en 1986. Il eut de grands succès en prenant des positions longues anticipant les grandes variations macro-économiques et en se couvrant plus systématiquement que ses prédécesseurs. Il bénéficia de la hausse de la bourse des années 80 et 90 et la multiplia par effet de levier.
Les marchés, lieux de création de valeur
Suit une longue analyse des politiques macro-économiques et financières qui est un régal. Elle est malheureusement impossible à résumer sauf à tomber dans des généralités. Mieux vaut signaler deux points :
– la politique de Reagan généra un déficit intérieur, donc un déficit extérieur, donc un grand besoin de financement, donc « les 3D » : décloisonnement (du court terme et du long terme, des frontières nationales, et donc de l’accès aux paradis fiscaux…), désintermediation (titriser les crédits, contourner les banques) et déréglementation (permettre à chaque acteur de faire tous les métiers financiers et notamment de spéculer pour son compte propre).
– le « coup » de Georges Soros qui gagne 1 milliard le 29 septembre 1992 en « tuant » la livre sterling (il y gagne une notoriété qui dure encore aujourd’hui alors qu’il s’est transformé en « vieux sage » critiquant le système actuel, devenu plus complexe et plus opaque). La question reste ouverte aujourd’hui de savoir s’ils s’agissait « gros coup de semonce nécessaire pour réveiller le gouvernement britannique » ou d’une spéculation déstabilisante. À cette occasion les auteurs évoquent le keynésianisme de Soros quant à sa perception de la nature des marchés : lieux de création de valeur et non simples outils.
Retenons que « les 3D » permettent aux fonds de multiplier leurs outils, notamment en produits dérivés, et donc de multiplier leurs bénéfices et de limiter leurs pertes… mais seulement tant qu’ils restent marginaux par rapport aux marchés et que ceux-ci restent globalement porteurs (traduction personnelle : ils écrèment ). Les auteurs en concluent que les fonds ne sont pas seulement « des lubrifiants » des marchés mais que, grâce à leur unité d’action avec les banques d’investissement, ils jouent un rôle économique important.
La suite de l’ouvrage a pour objet de montrer que ce rôle économique est en général négatif. L’histoire économique ou financière détaillée continue avec une série de coups souvent « foireux » à l’occasion des crises financières asiatique (1997) et russe (1998), et, depuis 2002 sur les marchés des matières premières et celui de l’automobile (par le biais des dérivés de crédit). L’importance des fonds croît rapidement pendant les années 2000 à 2007, date à partir de laquelle leur fragilité devient manifeste.
Cette importance croissante vient du fait que leur clientèle n’est plus seulement celle de privés fortunés, mais aussi celle des « fonds souverains » (émanant d’États : Chine, États pétroliers), des fonds de pension, des compagnies d’assurances etc. bref de tous les acteurs de la finance. Ces acteurs sont attirés certes par les rendements élevés proclamés, l’innovation financière, le « pompage » des meilleurs cerveaux à coup de rémunérations élevées, mais ils le sont aussi et surtout par la nécessité de diversifier leurs portefeuilles (dans lesquels, à mon avis, les contreparties du déficit américain prenaient trop de place, ce qui nous ramène aux fondamentaux de l’économie générale).
Effet de levier dans le brouillard
Les auteurs passent ensuite au fonctionnement interne des fonds, chapitre technique que je ne fais que signaler. Mon interprétation personnelle en est que le mécanisme de base reste l’effet de levier et que toutes les techniques sophistiquées de couverture et d’arbitrage censé le sécuriser ne sont qu’un brouillard qui le fait perdre de vue… Suit le chapitre essentiel mais technique réfutant les arguments en faveur du rôle bénéfique des fonds dans le fonctionnement des marchés. Les auteurs rappellent notamment ce que la grande presse a découvert pour les traders, à savoir que l’intérêt direct (bonus ou autres formes d’intéressement) du dirigeant du fonds est différent de celui des investisseurs, car il capte à leur création une partie des bénéfices et laisse le solde, voire les pertes, aux investisseurs. Du fait de ce « biais » et de bien d’autres, combinés à la situation macro économique et financière de l’année 2007, les auteurs concluent à une grande responsabilité des fonds dans ce qui a été non seulement une crise financière normale, mais une crise systémique. Elle s’est traduite par la ruine de nombreux fonds et donc de leurs investisseurs, dont les fonds de pension et leurs dizaines de millions de retraités, mais aussi les nombreuses universités américaines qui ont vu disparaître leurs réserves. Les auteurs pointent l’irresponsabilité de ces investisseurs et leur absence de contrôle de l’argent confié. Parmi les fonds disparus, il y a celui de Madoff, qui nous vaut quelques pages sévères.
Les auteurs rappellent ensuite que les fonds ou leurs imitateurs (private équity) ont étendu leur action aux entreprises notamment par les reprises avec effet de levier, en visant les mêmes rendements importants. D’où la pression sur les directions (ou par la direction lorsqu’elle est associée) et sur le personnel pour aboutir à ces rendements, ce qui bien entendu échoue sauf cas particuliers (aveuglement mathématique dont je parlerai plus loin) après moult dégâts sociaux. Ils relient également à toute cette effervescence la folie des fusions et des privatisations à objectif boursier (et non de rationalité économique, réaction personnelle d’ancien industriel ayant toujours trouvé les financiers incompétents en la matière), et notent les nouveaux terrains de chasse, par exemple celui du marché des droits de carbone.
Suit le débat international sur la réglementation des fonds et de la finance en général, et sa non conclusion, tant du fait des conflits d’intérêts (les dirigeants des fonds faisant partie des experts) que de celui de la vision anglo-saxonne du monde (« le totalitarisme du marché »), opposée à la vision asiatique. Les auteurs exposent ce qui se fait et surtout ce qui ne se fait pas, et ce qui devrait être : limitation de l’effet de levier, transparence de l’information, changement de la structure des incitations des acteurs. Ils notent les premiers pas dans ce sens, notamment de l’Union Européenne, progrès toutefois freinés par les groupes de pressions des intéressés et ceux des places financières craignant de perdre de l’activité. Ils terminent par un appel à la prise des responsabilité par les investisseurs à long terme afin de transformer les fonds en ces entrepreneurs qu’ils prétendent être, mais sont sceptiques du fait de la différence des tempéraments. Je leur donne tout à fait raison sur ce dernier point.
Au total il s’agit d’un livre certes assez technique, mais néanmoins compréhensible, car la complication du sujet est atténuée par la progression dans le temps, au fur et à mesure que se sophistiquent les comportements.
Par ailleurs mes antécédents de matheux me font regretter que la différence entre « marginal » et « moyen » ne soit signalée qu’incidemment. Il s’agit pourtant d’un mécanisme fondamental, non seulement pour ce sujet mais pour l’économie en général, les entreprises et bien d’autres domaines.
J’ai l’habitude de donner à mes étudiants l’exemple suivant : « s’il est exact que l’on voit mieux dans une foule en se mettant sur la pointe des pieds, ce n’est plus vrai si tout le monde en fait autant, et de plus cela génère des chutes qui s’étendent lorsque les uns tombent sur les autres ».
Les fonds ont donc précipité leur propre perte en proclamant qu’ils avaient trouvé « le truc » pour avoir des rendements supérieurs au rendement moyen (celui des marchés, voire l’accroissement du PIB si l’on raisonne globalement), ce qui a multiplié les imitateurs et donc entrainé la chute. Par ailleurs, cela a fait croire à bien des managers que ces rendements élevés n’étaient pas seulement des cas très particuliers et pouvaient être exigés de leur entreprise.