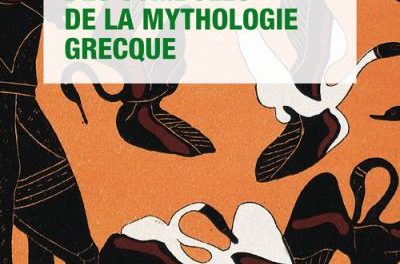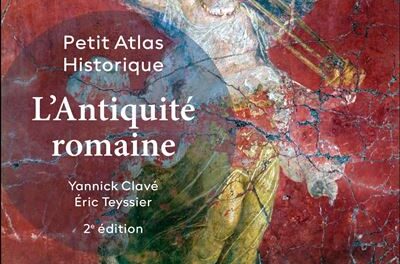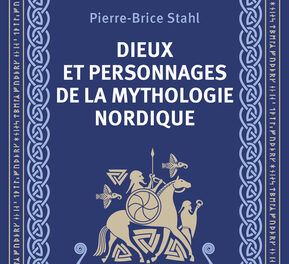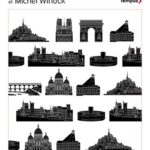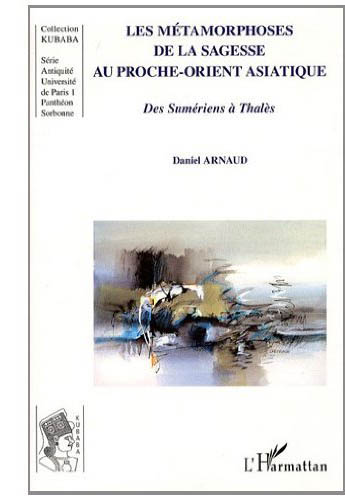
Cette sagesse est, dans un style alerte et très contemporain, un récit à la fois chronologique d’une histoire du Proche-Orient tel qu’on peut l’imaginer (en mêlant sans les différencier et sans le préciser, faits avérés par les sources, mythes et légendes) et thématique, réflexion sur le deux, le multiple et le un.
L’aire géographique définie est le Proche-Orient asiatique, il faut alors comprendre que l’ « Occident » mentionné au long de la démonstration correspond à la côte levantine. De nombreuses et très longues citations font l’intérêt de l’ouvrage. Traduites en français, elles seraient d’un accès difficile ailleurs.
Il convient cependant de manier le tout avec précaution car la nature de ces documents et leur contexte ne sont que rarement précisés. Cela donne des affirmations du type : « Le millier de signes sur les premières tablettes permet de porter un jugement sur l’écriture la plus ancienne. Son créateur fut un homme: le métier de scribe fut à jamais masculin. Il l’élabora seul : les silhouettes sont indiscutablement d’une seule main. De profession, c’était un administrateur familier des magasins » (p. 38) Aujourd’hui où l’origine comptable de la naissance de l’écriture cunéiforme fait l’objet de débats (les documents les plus anciens ayant été trouvés chez des particuliers et étant de nature juridique), le lecteur averti aura reconstitué qu’il s’agit peut être là d’une allusion au mythe d’Enmerkar dans la version Enmerkar et le roi d’Aratta, texte littéraire ayant pour objet de valoriser le roi de la ville d’Uruk vainqueur d’un concours d’intelligence en ayant créé l’écriture, que dans les faits le nom de l’inventeur de l’écriture n’est pas connu et que si les scribes sont effectivement le plus souvent des hommes, il existe également des femmes scribes pour lesquelles on se réfèrera aux travaux de Brigitte Lion.
De même, toujours sur le même thème, expliquer que « le calame de Nabû en revanche, n’était pas antérieur à l’invention de l’écriture à la fin du IVe millénaire au plus tôt » (p. 56) va de soi puisque il n’est pas nécessaire de créer des outils pour écrire (= le calame) avant d’avoir inventé leur utilisation c’est à-dire l’écriture ; quant à Nabû, fils de Marduk le dieu poliade de Babylone au IIe millénaire av. J.-C., il n’a pas encore aux IVe-IIIe millénaires av. J.-C, remplacé la divinité sumérienne patronne de l’écriture à savoir Nisaba, également déesse du grain ! C’est elle qui intervient dans le mythe d’Enmerkar. Par ailleurs, même si les Sumériennes ont sans doute bénéficié d’une plus grande liberté que les Akkadiennes, quant à y voir une démocratie primitive dans laquelle les femmes auraient siégé à égalité avec les hommes au sein d’une assemblée élue (p.22-23), elle relève plus de l’air du temps actuel où la parité est à la mode que d’une réalité antique prouvée par les faits.
Le néophyte aura plus de facilités à corriger de lui-même quelques maladresses d’expression: « Sargon racontait sa vie dans un récit, en babylonien, bien plus récent que lui » (p .26) ; « Ce changement d’échelle faisait de Sumer et d’Accad une ville unique » (p. 34) ; « Certains documents furent peut être abondamment fourrés » (p. 108) et comprendra que le « Rit » (p. 59, 64, 67..) est une faute d’orthographe répétitive pour « rite » pour ne donner que quelques exemples.
Une fois replacées par le lecteur dans leur contexte, les citations ne manquent pas d’intérêt. Elles sont variées et peuvent être d’une grande utilité à celui qui sait les manier. Les néophytes quant à eux, auront la sagesse de ne pas prendre ce livre comme un livre d’histoire mais comme un roman d’aventures leur permettant de prendre contact d’une manière plaisante avec l’Orient ancien.