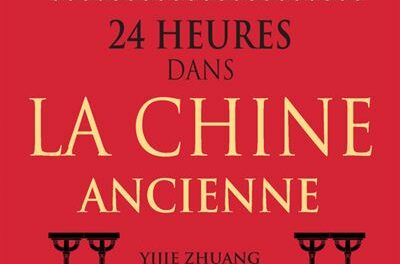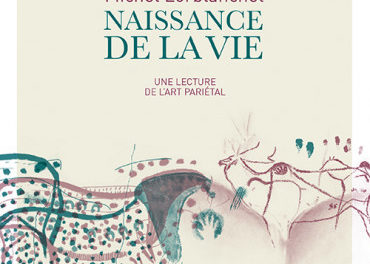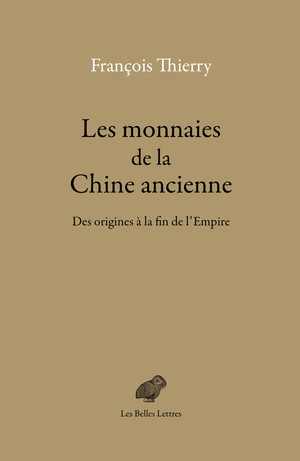
Quand, en 1719, le médecin de la mission envoyée par Pierre le Grand à la cour de Kang Xi (1661-1722) évoque les aspects monétaires de la Chine, il n’en donne qu’une faible idée de la complexité : « il n’y a pas de monnaie courante dans le pays, excepté une petite pièce ronde, avec un trou carré dans le milieu, où l’on passe un cordon, pour pouvoir la porter plus commodément au marché » (cité p. 8). L’écrasante majorité des observateurs qui ont séjourné en Chine ne manquent pas de considérer le « système monétaire » chinois comme « archaïque » (p. 9) dans la mesure où la monnaie n’y correspond pas aux canons de l’orthodoxie monétaire fixée, bien entendu, par les Occidentaux. Car, en Occident, « la forme de la monnaie […] est la pièce de monnaie ronde […], dont la valeur d’échange est fonction de la valeur de la quantité de métal précieux, or ou argent, qu’elle contient : elle est un poids défini de métal précieux. La mise en œuvre du métal précieux, par la frappe des monnaies, est considérée comme une prérogative du pouvoir, qui, marquant de son signe les espèces qu’il émet, en garantit la valeur et la circulation. Tout ce qui sort de cette définition et de cette forme ne saurait être de la monnaie » (pp. 10-11). Le moins que l’on puisse dire, c’est que la lecture de l’ouvrage, fort érudit, de François Thierry, conservateur général honoraire au Département des Monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France, confirme l’écart des monnaies de la Chine ancienne à la « norme » occidentale. Nous ne donnerons ici, compte tenu de l’ampleur chronologique de l’étude et du foisonnement des données exposées, qu’un rapide aperçu de ce que l’auteur estime être « une histoire des signes monétaires, de leur évolution, de leur production, de leur nature et de leur circulation » (pp. 18-19).En Chine, le système monétaire traditionnel est fondé sur la valeur fiduciaire de la monnaie : « son acceptation par les différents agents économiques et sa valeur d’échange sont fonction d’un contrat tacite entre membres du groupe social, et non pas de la valeur du matériau constitutif du signe monétaire » (p. 29), mais il est arrivé fréquemment qu’on utilise des monnaies marchandises à valeur intrinsèque.
François Thierry estime qu’on ne commence à parler de monnaie qu’« à partir du moment où l’on passe du troc généralisé à l’usage spécifique de certains produits ou objets pour effectuer les échanges et mesurer la valeur des biens à échanger. » (p. 21) Ainsi, le cauris marin (haibei) est le premier objet dont l’usage monétaire est clairement établi. Et c’est surtout à compter de l’époque des Zhou de l’Ouest (XIè-VIIIè s. avant notre ère) que les cauris sont utilisés sous la forme d’une unité de compte, la double ligature (peng).
C’est à l’époque des Han (IIIè s. avant notre ère- Ier siècle de notre ère) qu’est mis au point et adopté le signe monétaire jugé le plus apte à jouer le rôle d’instrument d’échange : les pièces de monnaie métallique, en bronze. Ce signe ne va plus, fondamentalement, changer jusqu’à la fin de l’empire. Mais, comme le souligne notre auteur : « la monnaie chinoise […] continue à poser problème aux historiens et aux chercheurs qui se penchent sur sa nature : doit-on la considérer comme purement fiduciaire, ou doit-on la regarder comme une forme particulière de monnaie à valeur intrinsèque, dont la base serait le cuivre, et non l’or ou l’argent comme en Occident ? » (p. 573) Les monnaies de la Chine, depuis les Royaumes combattants jusqu’aux Qing, se caractérisent en effet par une très grande hétérogénéité de poids et de composition. François Thierry insiste sur le fait que des monnaies peuvent avoir la même valeur libératoire alors que leur valeur intrinsèque est différente : ainsi de deux banliang du règne de Wendi (IIè s. avant notre ère) dont l’un contient 62% de cuivre (1, 5 g) et l’autre 82% (2 g)…
Comme le bronze est un alliage à base de cuivre, ce dernier minerai est particulièrement recherché : par exemple, au milieu du IXè siècle, sous les Tang, « la grande question pour les autorités reste celle de la nécessité de l’augmentation de la masse monétaire dans une situation de pénurie de cuivre, et donc de hausse de sa valeur, alors que la principale monnaie est fabriquée avec un alliage de cuivre. Trouver du cuivre à tout prix, telle est la mission assignée aux fonctionnaires de la Commission du sel et du fer, qui ont en charge les ateliers monétaires » (p. 231). À partir des Tang (VIIè-Xè s.), les alliages officiels contiennent de moins en moins de cuivre et de plus en plus de plomb et d’étain. Au début du XVIè s, les Ming réduisent la part de ces derniers pour ajouter du zinc.
En Chine, si la monnaie est un instrument d’échange, comme d’autres marchandises (grains, tissus, jade, etc.), elle ne se réduit pas à cela. On considère en effet que les pièces doivent circuler « sans relâche » pour que les biens ne soient « ni trop chers ni trop bon marché », comme l’écrit un ministre des Finances des VIIIè-IXè s., ce qui suppose que les utilisateurs ne soient pas tentés de les thésauriser : donc, la pièce de monnaie « doit, idéalement, avoir la plus faible valeur intrinsèque possible » (p. 11). Pour qu’elle soit acceptée par ses utilisateurs, il convient qu’elle soit « commode » : à l’époque des Song (Xè-XIIIè s.), on émet ainsi des billets, qualifiés de « monnaie commode » (bianqian), pour remplacer des monnaies de fer jugées trop lourdes et peu pratiques par les habitants… Si les grains et les tissus ne sont pas considérés comme de la monnaie, c’est qu’ils manquent singulièrement de « commodité » pour les échanges.
Deux théories, fort anciennes, donnent une excellente idée de la manière dont les Chinois concevaient le rôle de la monnaie. Le concept de la balance entre le léger (qing) et le lourd (zhong) considère que la monnaie est un produit comme les autres dont la seule fonction est de faciliter les échanges : « La valeur de la monnaie et celle des biens (grains et produits manufacturés) […] se déterminent réciproquement : lorsque les grains sont abondants, leur prix baisse, le grain devient léger, et, en contrepartie, la monnaie devient lourde ; inversement, lorsque la monnaie circule en abondance, sa valeur s’effondre, elle devient légère » (p. 15). Quant à la théorie du « rapport harmonieux entre l’enfant et la mère » (zi mu xiangquan), elle stipule que, « pour que la circulation monétaire soit harmonieuse et satisfaisante pour la population, […] les signes monétaires de différentes valeurs d’échange soient émis de la façon la plus judicieuse » (p. 16). Dans les deux cas, le Prince doit jouer pleinement son rôle de garant d’un équilibre nécessaire. Or, dans les faits, celui-ci joue de moins en moins, par sa marque (monétaire), le rôle de garant qu’il revêt alors en Occident.
Dans l’Antiquité chinoise, le monnayage n’est pas un monopole d’Etat. Par exemple, de 221 à 118 avant notre ère, il existe ainsi un grand nombre d’émetteurs : les ateliers centraux du palais, les ateliers officiels provinciaux et locaux, mais aussi les ateliers privés, légaux ou tolérés et les ateliers de faux-monnayeurs. Il faut à cet égard noter que l’histoire monétaire de la Chine est marquée par l’importance du faux-monnayage, parfois inévitable : ainsi, au cours du VIIè siècle, comme les monnaies officielles circulent en quantités insuffisantes pour les besoins du marché, la population se voit contrainte d’accepter des kaiyuan de faux-monnayage. Et l’on voit même, au début du XVIè siècle, les autorités Ming contraintes d’avoir recours aux faux-monnayeurs : en effet, soucieuses d’imposer l’usage des billets, elles cessent d’émettre des monnaies de bronze pendant des décennies (seconde moitié du XVè s.). Quand on constate que la valeur de la monnaie de papier s’effondre, on reprend, en 1503, les émissions monétaires. Mais comme les autorités « ne disposent ni du personnel expert, ni des ateliers en état de fonctionner » (p. 391), elles doivent s’en remettre aux artisans clandestins pour relancer la production…
Pour unifier le numéraire, l’empereur Wudi instaure en 113 avant notre ère le monopole d’Etat de la fonte de la monnaie. Précisons que, jusqu’à fin du XIXè siècle, la monnaie chinoise est fondue, et non frappée. Pas plus qu’il n’a existé d’unification durable du numéraire, l’espace de circulation des monnaies connaît lui aussi une certaine hétérogénéité : par exemple, à l’époque des Song, les autorités ont segmenté la circulation monétaire en trois zones, la monnaie de bronze circulant dans une première zone, la monnaie de fer dans une deuxième, principalement le Sichuan, et une monnaie mixte, de fer et de bronze, circulant dans une troisième…
En tout état de cause, à partir du XIXè siècle, il n’existe plus guère de monopole d’émission en Chine car « le rôle de moyen d’échange et de moyen de paiement est assuré, à côté des sapèques, par une marchandise, l’argent, qui est mis en circulation sous la forme de lingots par les banques et les officines privées, d’une part, et sous la forme de piastres par les Etats étrangers, d’autre part » (p. 14). Depuis le milieu du XVIè siècle, l’argent a en effet pris une place croissante dans la circulation monétaire chinoise : des quantités massives proviennent des mines du Mexique et des Andes ; les autorités, qui « veulent redonner à la monnaie de cuivre sa juste place comme principale forme de la monnaie » (p. 404), essayent de résister, en vain, à l’irruption de l’argent-métal. Dans la seconde moitié du XIXè siècle, les piastres deviennent une monnaie courante : « pour la première fois, la population dispose d’une monnaie d’argent, d’un module régulier, d’un poids régulier et d’un aloi régulier. Ces qualités, qui rendent ce signe monétaire apte, pratique et commode -ce qui n’est pas le cas de l’argent en lingot- font que les piastres d’argent étrangères (yang) jouent un rôle de plus en plus important dans la circulation monétaire » (p. 444). La Monnaie de Canton frappe des yuan d’argent : mais comme les piastres cantonaises sont très hétérogènes, le peso mexicain reste la monnaie d’argent de référence jusqu’à la fin de l’empire des Qing. Au tournant du XXè siècle, apparaît une pièce sans trou, frappée en cuivre, s’intégrant, comme monnaie divisionnaire, dans le système du yuan : ainsi, par exemple, en 1900 on émet une pièce d’un xian, valant un centième de yuan. Si le système traditionnel a vécu et s’est plié, dans une certaine mesure, aux pratiques monétaires occidentales, il n’en a toutefois pas subi une refonte complète, si bien que lorsque l’empire disparaît en 1911, la question de la réforme monétaire est laissée en suspens.
Au total, « la question qui se pose dans le cas de la Chine, c’est de savoir si la monnaie est vraiment un instrument comme les autres. […] Le fait d’avoir une monnaie dont la valeur d’échange détermine la valeur intrinsèque a eu pour conséquence que l’important n’est pas d’avoir confiance dans la monnaie, mais dans la solidité du contrat social sur lequel est fondée la circulation du signe monétaire : si tous les groupes sociaux et économiques, les producteurs, les commerçants, l’Etat, acceptent le signe monétaire pour la valeur communément définie, il n’y a pas de raison de ne pas utiliser dans ce but la sapèque de bronze, mais aussi un morceau de bambou, une feuille de papier ou une pièce de plomb. » (p. 584)
On l’aura sans doute perçu, à la lecture de ces quelques lignes : c’est un monument d’érudition que publient Les Belles Lettres. Il est sans aucun doute appelé à faire date. On est proprement confondu devant l’étendue des compétences de l’auteur, qui manie avec une belle subtilité la langue chinoise et une grande variété d’espèces monétaires s’étalant sur près de deux mille ans, confrontant, en virtuose, les textes théoriques et les trouvailles archéologiques, corrigeant des thèses qu’on croyait solidement établies. L’ouvrage, abondamment illustré, offre également, à travers l’exemple des monnaies, une belle, mais exigeante, promenade dans l’histoire de la Chine impériale