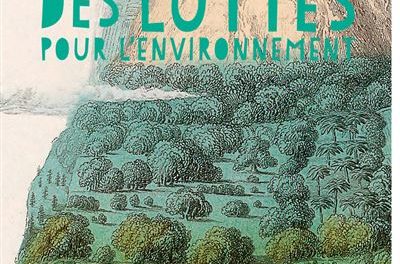Le livre s’intéresse à la haine la plus tenace de l’histoire et en présente les mythes fondateurs, leur évolution et leurs
conséquences, souvent terribles, et ce de l’Antiquité à nos jours. C’est donc à l’étude des origines de ces mythes, de leur persistance et de leur rôle dans la naissance d’un antisémitisme moderne que s’attache Carol Iancu. Il étudie ainsi les racines de l’antisémitisme et se pose la question de savoir pourquoi et comment cette « passion antijuive » a donné lieu à une véritable mythologie. Il s’agit donc d’un immense sujet que l’auteur s’efforce de synthétiser. Dans son introduction Carol Iancu fait tout d’abord une utile mise au point sémantique : le terme de « mythe » est ici compris dans son acception usuelle et actuelle, à savoir une invention de l’esprit, un concept irréel ou encore une représentation fausse. Par ailleurs, si la terminologie visant à traduire la haine des Juifs est plurielle, les termes d’antijudaïsme et d’antisémitisme sont les plus utilisés. Ces deux mots ne recouvrant d’ailleurs pas la même réalité. L’antijudaïsme a une double connotation, religieuse et sociale. Dans le monde antique, égyptien ou gréco-romain, la dimension religieuse est fondamentale. L’hostilité à l’égard des Juifs provient d’un monothéisme intransigeant, dont ils sont les inventeurs, et de leur opposition aux dieux multiples. Cet aspect religieux se double d’une coordonnée sociale qui marginalise le Juif comme étant différent ou étranger et constituant ainsi une menace pour l’harmonie sociale (prémices de la vision « organique » de la société).Avec l’apparition du christianisme, et le refus juif du message évangélique, le discours se fait théologique. La catéchèse chrétienne reprend cependant des éléments de l’antijudaïsme païen. Cet antijudaïsme religieux qui, selon l’auteur, a conservé sa nocivité jusqu’au cœur du XXe siècle, ne saurait être confondu avec l’antisémitisme ou la judéophobie qui est une forme particulière de la xénophobie et qui, au XIXe siècle, a intégré des considérations économiques, nationales et politiques. Ainsi, en 1881, le médecin russe Léo Pinsker écrit dans un essai (« Autoémancipation ! ») : « La judéophobie est une psychose. En tant que psychose elle est héréditaire, et en tant que maladie transmise depuis 2 000 ans, elle est incurable » . Le terme « antisémitisme » apparaît en 1879 sous la plume du journaliste allemand Wilhelm Marr. L’antisémitisme, s’il se nourrit de l’antijudaïsme, possède une spécificité : l’approche biologico-raciale. Il s’agit donc d’un racisme spécifique, alimenté par la haine des Juifs et se présentant comme scientifique. La racialisation, ou biologisation, de la « question juive » connaît bien entendu son apogée avec le nazisme et débouche sur le judéocide. Dans le second XXe siècle, cet antisémitisme, qui perdure, se nourrit de nouveaux apports : l’antisionisme, le révisionnisme et le négationnisme.
Le sionisme, en effet, est assimilé à un impérialisme voire à un racisme. Le révisionnisme pour sa part minimise la Shoah et le négationnisme la nie tout simplement. Pour Carol Iancu l’antisémitisme repose sur « la projection de complexes engendrés par l’intolérance à l’égard de l’altérité juive ». Aujourd’hui, se demande l’auteur, sommes-nous en présence d’un nouvel antisémitisme, et si oui, repose-t-il sur des mythes nouveaux ou recyclés ?
Antijudaïsme païen et chrétien
Dans les deux premiers chapitres de l’ouvrage l’auteur s’interroge sur les fondements de l’antijudaïsme païen et chrétien dans l’Antiquité puis sur cet antijudaïsme, alors chrétien et musulman, dans la période médiévale. Carol Iancu se propose tout d’abord d’analyser les mythes de l’antijudaïsme païen dans les mondes égyptien, grec et romain. Les premiers discours et écrits antijuifs, qui remontent au IVe siècle av. J.-C., soulignent la différence religieuse et sociale (Hécatée d’Abdère repris ensuite par Diodore de Sicile). Les Juifs, par exemple, sont assimilés aux lépreux et « dire que les Juifs sont lépreux revient en fait à les déclarer physiquement déchus, mais aussi socialement inacceptables, donc voués à la réclusion » (Joseph Melèze-Modrzjewski, « Sur l’antisémitisme païen »). Le premier véritable auteur antijuif est Manéthon, prêtre et lettré égyptien (IIIe siècle av. J.-C.), qui reprend les accusations, alors communes, contre les Juifs. L’antijudaïsme païen est renforcé du fait de la résistance juive à l’hellénisation. Et l’antijudaïsme grec s’est ensuite diffusé dans le monde romain où, après la destruction du second temple de Jérusalem (70), la diaspora juive s’est répandue. Tout l’arsenal antijuif élaboré par les Égyptiens et les Grecs est repris par les auteurs latins. Tacite (55 – vers 120) est ulcéré des progrès du judaïsme dans le monde romain. Les rites juifs sont critiqués et leurs « tares » sociales (séparatisme, misanthropie…) sont mises en évidence. A la suite de ce premier antijudaïsme émerge l’antijudaïsme chrétien qui, contrairement à l’antijudaïsme païen, a pour lui d’être un système cohérent avec un caractère officiel.
Dès l’origine le christianisme a voulu se démarquer de sa matrice juive. Plus le christianisme s’éloigne de ses origines plus l’hostilité s’accroît pour culminer avec la conversion de Constantin qui fait du christianisme une religion d’État. L’avènement de l’empire chrétien signifie pour les Juifs une détérioration de leur condition. Ainsi Saint Augustin déclare que les Juifs sont nés pour servir d’esclaves aux chrétiens. Toutefois l’auteur du « Tractatus adversus Judaneos » plaide également pour la tolérance de l’Église à l’égard des Juifs. Si l’antijudaïsme païen n’a donné lieu à aucune loi antijuive (les Juifs devenant même citoyens romains avec l’édit de Caracalla en 212), il n’en va pas de même avec l’antijudaïsme chrétien qui organise la discrimination et la ségrégation (Code Théodosien, 438). Le Code Justinien (VIe siècle), qui définit les Juifs comme étant « les pires des hommes », aggrave ces mesures. Ainsi, est mis en place ce qu’il convient d’appeler le « système d’avilissement » qui tend à rendre les Juifs odieux. En réalité le discours de l’Église est double : d’une part la protection des Juifs comme « peuple-témoin » de la révélation chrétienne, d’autre part une sévère discrimination pour avoir refusé de suivre Jésus et l’oppression pour l’avoir tué. La doctrine des Pères de l’Église se révèle bipolaire car elle proclame la nécessaire survie du « reste d’Israël », qui doit finir par se convertir, tout en réservant aux Juifs une condition humiliante du fait de leur hostilité à la conversion.
Carol Iancu identifie quatre mythes essentiels pour cette période. Le premier est le « crime du déicide ». Dans l’Evangile selon saint Jean (XIX, 12 et 15) on trouve ce passage : « Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent : qu’il meure, qu’il meure, crucifie-le ! ». L’historien cite de nombreux passages de textes chrétiens, notamment celui-ci : « Vous l’avez crucifié, le seul irréprochable et juste […]. Vous avez mis le comble à votre perversité, en haïssant le juste que vous avez tué » (saint Justin, « Dialogue avec le Juif Tryphon », IIe siècle). Voici donc l’accusation essentielle : les Juifs, dans leur ensemble, sont responsables de la mort de Jésus. Le terme de « déicide » apparaît sous la plume des Pères de l’Eglise (saint Jean Chrysostome) ou d’historiens (Eusèbe). Le « crime du déicide » fait partie de « l’enseignement du mépris » développé par l’Eglise durant des siècles et constitue le mythe central sur lequel viennent se greffer les autres, notamment le mythe du « rejet d’Israël » par Dieu.
Certains discours antijuifs sont particulièrement violents, ainsi Jean Chrysostome (344-407) pour qui les Juifs sont « un peuple de chiens » dont « les âmes sont habitées par le démon » et dont les synagogues sont des « lupanars » et des « demeures de Satan ». Grégoire de Nysse (332-374) n’est pas en reste qui voit dans les Juifs une « race de vipères ». La théologie chrétienne enseigne également un troisième mythe, celui de la « dispersion comme châtiment divin de la crucifixion ». Le dernier thème véhiculé par la mythologie antijuive est celui d’un « judaïsme dégradé » à l’époque de Jésus. Ce mythe a pour objectif de rabaisser la foi juive tout en magnifiant le message de Jésus. Or, force est de constater que le judaïsme se caractérise alors par sa vitalité et une grande diversité de croyances et de pratiques. Ces différents mythes ont été alimentés par de nombreux auteurs chrétiens dans le souci d’imposer le concept de la substitution (l’Eglise prenant la place d’Israël).
Les rapports entre Juifs et chrétiens sont largement soumis aux évolutions ecclésiastiques et pontificales. A partir du VIIIe siècle on assiste à une universalisation du catholicisme et à la mise en place progressive de la féodalité chrétienne. L’Eglise façonne les structures mentales de la chrétienté médiévale occidentale. De nombreuses œuvres antijuives apparaissent au cours du haut Moyen-âge et garderont une grande influence tout au long de la période (par exemple les écrits d’Isidore de Séville, vers 560-636). La condition des Juifs se détériore progressivement, le point de rupture étant 1096 (Appel de Clermont), et cette situation connaît son apogée entre le XIIIe et le XVe siècle avec les expulsions d’Angleterre (1290), de France (1394), d’Espagne (1492) et du Portugal (1496). Par ailleurs les croisades ont été l’occasion de nombreux massacres commis par les Croisés aidés de populations fanatisées. Au cours du Moyen-âge les papes et les empereurs d’Orient édictent des mesures qui durcissent la condition des Juifs. Ainsi le concile du Latran (1215) renforce la législation antijuive. La discrimination se fait plus radicale en ce qui concerne l’habitat (ghettos), la tenue vestimentaire (rouelle et chapeau) et le serment en justice (serment « more judaico »). Cette marginalisation des Juifs est illustrée par les légendes et les calomnies véhiculées dans la société médiévale (le « meurtre rituel », la « profanation d’hosties et de crucifix » et « l’empoisonnement des puits »).
La réactivation du mythe au moyen-âge
La calomnie du « meurtre rituel », présente dans l’antijudaïsme antique, réapparaît au XIIe siècle dans le contexte passionnel des croisades. Cette accusation donne lieu à des massacres et, parties d’Angleterre, la légende et ses funestes conséquences se répandent en Europe. Chemin faisant, l’accusation du « meurtre rituel » s’enrichit d’une autre fable, celle de la nécessité d’obtenir du sang chrétien pour préparer le pain azyme. En dépit de la réaction de certains papes (Innocent IV, Grégoire X, Martin IV) ou de monarques (Frédéric II) pour protéger les Juifs, ces accusations ont longtemps persisté et ont trouvé un large écho dans le folklore christianisé. Lors du concile de Latran IV on débat aussi de la transsubstantiation et donc de la valeur de l’hostie. Ainsi, c’est tout naturellement que se répand le mythe de la « profanation d’hosties, de crucifix et d’icônes ». La profanation d’hosties est interprétée comme la volonté des Juifs de tourner en dérision l’acte du déicide. Ces profanations supposées donnent elles aussi lieu à des massacres.
En 1321, surgit en Aquitaine la légende de « l’empoisonnement des puits » qui conduit à des massacres. Les Juifs, aidés par les lépreux, tenteraient en empoisonnant sources et puits de détruire la chrétienté. Sous la pression de cette légende Philippe V prend des mesures antijuives radicales. Ce mythe s’amplifie lors de la peste noire (1348-1352). Les populations, effrayées (la peste tuera le tiers de la population européenne) et fanatisées, se livrent alors à des pillages et à des massacres d’une rare intensité. Malgré l’intervention du pape Clément VI, qui fait remarquer que le fléau touche également les Juifs, l’accusation calomnieuse est responsable du massacre de communautés entières partout en Europe. D’autres calomnies répandues font du Juif un « perfide », un « démoniaque », «un « usurier » ou un « errant ». L’expression « Juif perfide », déjà contenue dans le Code Théodosien, prend une dimension théologique avec la prière « Oremus » du vendredi saint, destinée à convaincre le « Juif perfide » de se convertir à la foi chrétienne. Cette prière s’est maintenue jusqu’aux années 1950. Ainsi est entretenu le mythe du Juif déloyal, fourbe, scélérat et traître. Le Juif est également un être « démoniaque ». Il convient de ne pas oublier que la peur du diable est un élément essentiel de la chrétienté médiévale occidentale (Jean Delumeau, « La Peur en Occident. XIVe-XVIIe siècles », 1979). Au début du XIVe siècle le Saint-Siège accrédite les doctrines démonologiques et le Juif voisine alors avec la sorcière comme suppôt de Satan. La caricature transforme le Juif en créature du diable (cornes, griffes). Le Juif devient laid, répugnant, anormal et lubrique.
Cela ne suffisant pas, le Juif est aussi « usurier ». Exclus de la propriété terrienne et du travail agricole, les Juifs exercent au Moyen-âge des métiers de l’artisanat, de la médecine, du négoce et du prêt. Ainsi, l’Église confine les Juifs dans le prêt à intérêt car l’usure chrétienne n’est plus tolérée à partir du XIIIe siècle et le concile de Vienne en 1311 rend les usuriers chrétiens justifiables de l’Inquisition. Si les Juifs, interdits de nombreuses activités, se rabattent sur l’usure, ils n’ont en réalité aucun monopole financier (les chrétiens outrepassant les interdits) et n’ont qu’une place réduite dans les mouvements d’argent. L’image de l’usurier juif avide et cruel s’impose cependant dans l’imaginaire collectif de la société médiévale. Ce poncif prend en fait racine dans l’antijudaïsme ecclésiastique avec la figure de Judas l’Iscariote, le traître aux trente deniers. Enfin, le Juif est « errant ». Ayant refusé le repos à Jésus portant sa croix (la Passion) le Juif est condamné à errer. Le « Juif errant » est donc le Juif « maudit » dont la condamnation est liée au déicide.
Le christianisme n’a pas toutefois le monopole de l’antijudaïsme. L’Islam, issu lui aussi du judaïsme, propose une révélation radicalement nouvelle. Mahomet espérait convertir les Juifs de Médine mais leur refus engendra une réelle rupture. Le Coran incite ainsi les fidèles musulmans à humilier les « gens du Livre ». Le statut juridique (dhimma) imposé aux Juifs et aux chrétiens est fondé sur la capitation et une série d’humiliations. Le Juif (dhimmi) est libre, peut pratiquer son culte et il est « protégé » mais en contrepartie il doit payer la capitation (jizya), ne peut construire de nouveaux lieux de culte, ne peut épouser une femme musulmane, ne peut posséder d’armes et doit porter un signe distinctif (les musulmans ont inventé la discrimination vestimentaire). De plus, les Juifs ne sont pas égaux devant la loi, sont exclus de certaines professions et ont des quartiers à part (mellah). Le célèbre Moïse Maimonide (1135-1204) écrit : « Israël n’a jamais eu affaire à un ennemi plus implacable ». Sous la dynastie des Almohades (1147-1269) de très nombreuses communautés juives sont détruites en Espagne et au Maghreb. L’Islam naissant, religion jeune et conquérante, serait donc marqué par un antijudaïsme virulent mais, précise Carol Iancu, tous les historiens ne s’accordent pas et certains soulignent la relative tolérance des musulmans.
L’antisémitisme moderne
Poursuivant son analyse synthétique de l’antisémitisme, Carol Iancu consacre les chapitres 3, 4 et 5 à l’étude des fondements idéologiques et des manifestations de l’antisémitisme moderne. Parmi les fondements idéologiques de l’antisémitisme moderne l’auteur distingue quatre éléments essentiels : la permanence de l’antijudaïsme chrétien, la philosophie rationaliste, le nationalisme xénophobe et l’anticapitalisme socialiste.
L’antijudaïsme médiéval se fondait sur des critères religieux et avait progressivement donné naissance à une discrimination institutionnalisée. Leur condition religieuse et sociale faisait des Juifs des parias dans la société chrétienne. En outre de nombreux massacres de Juifs eurent lieu durant les périodes de crise. Après les grandes expulsions, les royaumes d’Angleterre, de France, d’Espagne et du Portugal, alors « Judenrei » (« vides de Juifs »), connaissent néanmoins un antijudaïsme sans Juifs, un antijudaïsme « à l’état pur » (Léon Poliakov). Cet antijudaïsme de « ressentiment » (F. Lovsky) concerne l’ensemble du monde chrétien. Ainsi, Martin Luther (1483-1546), d’abord favorable aux Juifs mais déçu de leur résistance à la conversion, publie deux violents pamphlets reprenant les accusations médiévales (« usuriers », « parasites », « enfants du diable », « étrangers », « fléau »…). De son côté, la Contre-Réforme catholique raidit aussi la position de l’Eglise. La ségrégation et les discriminations traditionnelles sont renforcées. De même, les mythes médiévaux (« meurtre rituel », « peuple déicide »…) sont réactivés. Catholiques, protestants, orthodoxes, tous font montre d’une hostilité croissante.
Carol Iancu s’intéresse ensuite à la période des Lumières et au début du XIXe siècle car un tournant semble s’opérer. En effet, l’auteur souligne pour cette période le développement de l’idée de tolérance tout en montrant cependant la persistance de l’antijudaïsme chrétien. En 1689, John Locke publie « Lettres sur la tolérance » où il affirme qu’aucun non-chrétien ne doit être exclu de l’Etat pour raisons religieuses. De fait, les Lumières réclament l’amélioration de la condition des Juifs. L’Aufklärung allemande donne naissance à un mouvement intellectuel philosémite (par exemple Lessing, « Les Juifs » et « Nathan le Sage ») et à un courant des Lumières plus spécifiquement Juif (« Haskala ») initié par le philosophe Moses Mendelssohn. Toutefois, en Allemagne, les améliorations de la condition des Juifs restent insignifiantes et c’est en France que va se concrétiser la lutte pour l’égalité des droits. Il serait toutefois erroné de faire du combat pour l’émancipation une lutte partagée par tous les représentants des Lumières. Ainsi, Voltaire accompagne ses charges contre l’Eglise de la dénonciation de la religion juive et sa judéophobie « laïque » reprend, pour les accréditer, les poncifs de l’antijudaïsme chrétien.
Toutefois un réel mouvement favorable aux Juifs existe. Ainsi le comte de Mirabeau, reprenant les idées de Mendelssohn, demande en 1787 l’émancipation des Juifs. Il écrit, car cela semble nécessaire : « Le Juif est plus homme encore qu’il n’est Juif […] ». En 1785 et 1788, la Société des sciences et des arts de Metz organise un concours sur le thème : « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France ? ». Trois mémoires, dont la réponse est positive, sont primés dont celui de l’abbé Grégoire. Dans son « Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs », qui lui vaut le prix, l’abbé Grégoire écrit : « Que pouvait devenir le Juif, accablé par le despotisme, proscrit par les lois, abreuvé d’ignominies, tourmenté par la haine ? il ne pouvait sortir de sa chaumière sans rencontrer des ennemis, sans essuyer des insultes ». La Révolution va précipiter le mouvement en accordant l’émancipation aux Juifs en 1791. Néanmoins, l’émancipation ne signifie pas la disparition des attitudes traditionnelles et des préjugés.
Dans les autres pays d’Europe la lutte pour l’émancipation est plus difficile. Après 1815, dans tous les pays ayant été soumis à la domination napoléonienne et où l’émancipation avait été proclamée, celle-ci fut abrogée (à l’exception des Pays-Bas). Dans les pays germaniques l’émancipation, ainsi que les conceptions de l’Aufklärung, sont considérées comme des idées françaises, donc étrangères. Le mouvement romantique allemand idéalise le Moyen-âge et les institutions de l’Etat chrétien. Par ailleurs, certains auteurs se font apôtres de la germanité (Arndt) ou de la guerre (Jahn) ce qui correspond selon eux au « Deutsches Volkstum » (caractère germanique). Des philosophes et historiens allemands réclament une ségrégation sévère. Dans son « Miroir des Juifs » Radowsky écrit : « Moi-même je ne considère pas le meurtre d’un Juif comme un péché ou un crime, mais comme un simple règlement de police ». Néanmoins, l’émancipation, devenue réalité dans certains Etats allemands en 1848, se généralise à partir de 1869. Cependant, pour les nationalistes l’idée nationale reste incompatible avec la présence juive et ce sentiment antijuif s’amplifie à partir de 1870. Les antisémites intransigeants sont nombreux dans la droite nationaliste et antidémocratique, dans le contexte impérialiste et pangermaniste de la fin du XIXe siècle.
En France, Alphonse Toussenel critique le capitalisme et dénonce la prédominance juive (« Les juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière », 1840). Son maître, Charles Fourier (1772-1837) a également critiqué les Juifs et tous deux voient en ces derniers des éléments improductifs et spoliateurs des chrétiens et reprennent les poncifs de l’antijudaïsme chrétien. Chez Proudhon (1809-1862) on trouve un « antisémitisme économico-social » et le théoricien prône une discrimination à l’emploi, l’interdiction des synagogues et l’expulsion. En réalité, les grands penseurs socialistes (Fourier, Marx, Proudhon) n’ont pas analysé la situation réelle des Juifs en Europe : les masses juives pauvres et le prolétariat juif sont absents de leurs réflexions. Le désastre de 1870-1871, provoque un nationalisme teinté d’antisémitisme et dont les fondements se trouvent bien souvent dans l’identité catholique. Le plus bel exemple de cette sensibilité est sans conteste Edouard Drumont chez qui, selon Raoul Girardet, l’antisémitisme est le seul principe de pensée et d’action. Dans « La France juive » (1886), ouvrage qui connaît un immense succès, Drumont développe tous les thèmes de l’antijudaïsme chrétien et les mobilise pour lutter contre l’athéisme et l’anticléricalisme dont seraient aussi responsables les Juifs. M. Barrès, A. Daudet ou G. Bernanos lui ont rendu hommage et Maurras, parole d’expert, écrit de lui : « La formule nationaliste est née presque toute entière de Drumont et Daudet, Barrès, nous tous, avons commencé notre ouvrage sous sa lumière ».
Enfin, Carol Iancu identifie un dernier fondement de l’antisémitisme moderne : l’anticapitalisme socialiste. En Allemagne le philosophe Ludwig Feuerbach (1804-1872), précurseur du socialisme, ou encore le théologien protestant devenu apôtre de l’athéisme, Bruno Bauer (1809-1892) sont très critiques à l’égard des Juifs et de la religion juive. Dans son ouvrage « Die Judenfrage » (« La Question juive », 1843) Bauer dénonce le pouvoir économique des Juifs qui ne sont dans la société que pour l’exploiter et s’oppose à l’octroi des droits politiques. Karl Marx, dans un ouvrage également appelé « La Question juive », s’en prend aussi aux Juifs qui dans la société de son temps sont pour lui assimilables à des exploiteurs et des profiteurs liés au capitalisme financier : « L’argent est le dieu jaloux d’Israël devant qui nul autre dieu ne doit subsister ». La société bourgeoise serait donc « enjuivée » puisqu’elle est assujettie à l’argent. Cette tare liée à l’argent est pour Marx inhérente au judaïsme. Il faut donc que les Juifs se déjudaïsent pour accéder à une véritable émancipation. A la fin du XIXe siècle l’antisémitisme est réprouvé par les socialistes et il revient à August Bebel de clore le débat de façon lapidaire : « L’antisémitisme est le socialisme des imbéciles » (la paternité de la phrase est discutée).
L’auteur, analysant les manifestations de l’antisémitisme moderne, souligne tout d’abord des différences au sein de l’Europe. En effet, l’émancipation n’a pas suivi partout le même rythme : 1791 en France, 1866 en Angleterre, 1867 en Autriche-Hongrie, 1869 en Allemagne, 1870 en Italie, 1917 en Russie. L’émancipation, une fois acquise, ne met pas fin à l’antisémitisme qui en cette fin du XIXe siècle, outre les accusations classiques, se renforce des thèmes de race et de nation. L’antisémitisme, nous dit l’auteur, revêt alors une fonction sociale à travers la stratégie du bouc-émissaire. Les perdants de la modernité, les opposants aux évolutions ou à l’État trouvent dans l’antisémitisme un refuge. Les Juifs deviennent responsables des crises et des tensions qui traversent les sociétés. L’émancipation a provoqué une réaction idéologique qui s’exprime dans l’opinion et en politique (journaux, livres, ligues, partis). Le but alors poursuivi par les antisémites est le rétablissement des lois discriminatoires, l’expulsion et, pour les plus extrêmes, l’anéantissement. C’est avec l’affaire Dreyfus que l’antisémitisme manifeste toute sa force et son ampleur. L’Affaire pose avec passion la question du problème juif et divise la France en deux camps irréductibles. L’affaire Dreyfus devient passionnelle sous les plumes nationalistes et antisémites, en particulier celle de Drumont dans son journal « La Libre Parole ». Une prétendue « solidarité juive » est dénoncée. Or l’Affaire nous offre un parfait contre-exemple en la personne de Jules Isaac qui justifiera ainsi son inaction : « J’étais Juif et, par réaction d’honnêteté, en garde contre moi-même, contre tout réflexe de solidarité juive, résolu à ne me prononcer qu’à bon escient et en toute connaissance de cause ». L’affaire Dreyfus, pour être une formidable caisse de résonance des passions politiques et de l’antisémitisme, n’a cependant pas comme conséquence de remettre en cause l’intégration des Juifs de France. Toutefois, à cette occasion, de nombreux Juifs prennent conscience de leur « différence » et de la fragilité de leur situation. Est-ce un hasard si, après avoir assisté à la dégradation de Dreyfus , Theodor Herzl écrit « L’État des Juifs » ?
En Europe centrale, les pogroms
L’historien nous conduit ensuite en Roumanie, dont il est spécialiste, et en Russie où l’antisémitisme d’État se traduit par des persécutions et des pogroms. La Petite Roumanie et la Russie abritent à la fin du XIXe siècle des populations juives parmi les plus nombreuses, respectivement 270 000 et 5 250 000 personnes. Dans ces deux pays les Juifs sont soumis aux lois d’exception. En Roumanie les Juifs sont considérés comme des étrangers sans citoyenneté. De 1878 (Congrès de Berlin) à 1914 les lois discriminatoires se succèdent faisant de la Roumanie un pays professant un antisémitisme d’État systématique. Les Juifs sont exclus de nombreuses professions (magistrature, enseignement, administration, médecine, agriculture). En 1886 le Congrès antisémitique roumano-européen tenu à Bucarest préconise l’expulsion des Juifs de l’Europe. Cet antisémitisme institutionnalisé provoque une forte immigration : entre 1899 et 1913, 90 000 Juifs quittent la Roumanie pour les États-Unis, l’Europe occidentale ou la Palestine. Les Juifs ne sont reconnus citoyens roumains qu’en 1919 (Conférence de la paix de Paris).
En Russie les Juifs avaient été exclus de la « Sainte Russie » (provinces centrales) dès le XVIe siècle. Avec le rattachement de l’Ukraine et de territoires polonais les populations juives se firent plus nombreuses et Catherine II (1762-1796) institua une « zone de résidence » (un « couloir » allant de la mer Baltique à la mer Noire). Le tsar Nicolas Ier (1825-1855) ayant décidé de convertir les Juifs pour les assimiler institua pour eux un service militaire de 25 ans qui pouvait concerner les enfants dès l’âge de 7 ans (les « cantonistes »). Avec le tsar Alexandre II (1855-1881), plus libéral, la condition des Juifs s’améliore quelque peu. Or, son assassinat déclenche une vague (1881-1883) de pogroms (« po » signifiant « entièrement » et « gromit », « détruire »). Ces émeutes populaires sont marquées par des massacres, l’incendie des synagogues, maisons et boutiques, des pillages et des viols. Alexandre III (1881-1894) fait exclure les Juifs des zones rurales et renforce l’obligation d’habiter la « zone de résidence ». Les Juifs sont ensuite exclus des grandes villes. Cette politique antijuive provoque une nouvelle vague d’émigration, essentiellement vers les États-Unis (entre 1882 et 1914 on compte 2,5 millions d’émigrants juifs). La seconde vague de pogroms (1903-1905) est encore plus meurtrière (pogrom de Kichinev en 1903).
Carol Iancu aborde ensuite l’antisémitisme nazi et la Shoah, qui sont de toute évidence au cœur d’une histoire de l’antisémitisme européen, mais le propos de Carol Iancu n’est pas ici de livrer une nouvelle histoire de la « Solution finale ». Pour être incontournable cette question n’occupe qu’une place relative dans cet ouvrage qui s’attache à dévoiler et expliquer les mythes fondateurs de l’antisémitisme. L’auteur nous rappelle cependant que le racisme nazi utilise les doctrines raciales pseudo-scientifiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, de même qu’il puise dans la nationalisme de cette période. En 1918-1919 se répand en Allemagne la légende d’un complot juif et du « coup de poignard dans le dos » comme explication de la défaite. Cette légende sera largement instrumentalisée par la propagande nationale-socialiste. Les Juifs sont de même tenus pour responsables de la signature du « diktat » de Versailles (Walter Rathenau est assassiné en 1922) qui, aux yeux du peuple allemand, humilie et détruit l’Allemagne.
L’antisémitisme racial
L’antisémitisme d’Hitler se déverse sans retenue dans « Mein Kampf » publié en 1925. Les Juifs y sont présentés comme « une race inférieure ». Il s’agit d’un antisémitisme racial qui prétend s’appuyer sur des preuves « scientifiques ». La vision organique nazie de la société et la mystique du sang aryen, qui ne doit pas être souillé sous peine de voir disparaître la race supérieure, font des Juifs des microbes infestant le corps politique, le corps social et le sang allemands. En ce sens l’antisémitisme se fait « rédempteur », ordonnant de combattre les Juifs pour sauver la germanité. A cela s’ajoute la croyance fortement enracinée en un « complot juif mondial ». L’idéologue nazi Alfred Rosenberg dénonce les agissements de la « juiverie internationale » (« Le Mythe du XXe siècle »). Julius Streicher, pour sa part, dans son journal « Der Stümer », vendu à des centaines de milliers d’exemplaires, se répand, on pourrait dire se vautre, en un antisémitisme brutal et vulgaire : « Il ne faut pas tolérer les bactéries, la vermine et la peste. La propreté et l’hygiène nous obligent à les rendre inoffensifs en les exterminant ». Avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir l’antisémitisme se déchaîne (boycott, violences, humiliations). En 1935 l’antisémitisme devient la politique légale et officielle du régime nazi avec les Lois de Nuremberg qui organisent la discrimination et la ségrégation. Entre 1935 et 1938 les nazis procèdent à l’expulsion des Juifs de la vie sociale et économique (« aryanisation »). La persécution nazie culmine dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 avec la « Nuit de Cristal » qui est un vaste pogrom : 119 synagogues incendiées, 7 500 magasins détruits, 91 Juifs assassinés et des milliers d’internement en camp de concentration. L’Etat nazi s’est donc emparé de la violence antijuive au cours de cette période. De 1933 à 1939 ce sont quelques 300 000 Juifs allemands, environ la moitié de la communauté, qui émigrent. Après les années de persécution, les nazis mettent progressivement en place, à partir d’août 1941, la « Solution finale », c’est-à-dire l’extermination pure et simple, qui fera 5 à 6 millions de victimes.
Étudiant les racines de l’antisémitisme moderne Carol Iancu souligne qu’il se fonde tout d’abord sur un mythe racial prétendument scientifique. Au Moyen-âge la conversion suffisait à faire d’un Juif un « chrétien homme », c’est-à-dire un être « normal ». L’antijudaïsme était avant tout religieux et n’avait pas la « race » pour fondement. Au XIXe siècle s’impose l’idée de race et de racisme et le mythe de la « race inférieure juive » apparaît. Avec la publication de l’ « Essai sur l’inégalité des races humaines » (1853-1855) d’Arthur de Gobineau (1816-1882) et celle de l’ « Histoire des langues sémitiques » (1855) d’Ernest Renan (1823-1892), la théorie raciale devient l’argument principal de l’antisémitisme. Renan écrit : « Je suis donc le premier à reconnaître que la race sémitique, comparée à la race indo-européenne, représente réellement une combinaison inférieure de la nature humaine ». Quant à Gobineau, il estime que le mélange des sangs entraîne la dégénérescence des races et donc le déclin de la civilisation. Selon Léon Poliakov (« Le Mythe aryen ») l’idée de race connaît une mutation avec les écrits de Benjamin Disraeli (1804-1881) dont la philosophie de l’histoire se résume par la formule « All is race, there is no other truth ». En 1899, Houston Stewart Chamberlain, gendre de Wagner, fait paraître « La Genèse du XIXe siècle » qui devient la bible du racisme moderne et qui institue la supériorité des aryens.
En 1879 le journaliste Wilhelm Marr publie « La Victoire du judaïsme sur le germanisme » où il avance l’idée que l’Allemagne est défaite par « la race juive conquérante ». En 1886 c’est Edouard Drumont (« La France juive ») qui met en garde contre cette conquête. Autre mythe moderne ayant une force imparable : « le complot judéo-maçonnique ». Au XIXe siècle se diffuse l’assimilation entre judaïsme et maçonnerie qui uniraient leurs forces pour détruire la civilisation chrétienne. En son temps, l’abbé Barruel, inventeur du complot maçonnique comme élément explicatif de la Révolution, avait déjà associé les Juifs à ce complot. L’expression « judéo-maçonnique » se trouve pour la première fois dans l’ouvrage de Gougenot des Mousseaux, « Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens » (1869). Dans les années 1880 est lancée à Paris la revue « La Franc-maçonnerie démasquée », liée aux Pères assomptionnistes et visant à dévoiler le « complot judéo-maçonnique ». De même Drumont, toujours dans son principal ouvrage, s’en prend aux maçons qui sont d’origine juive et sont soumis aux Juifs.
En France les « judéo-maçons » sont tenus pour responsables de la politique anticléricale et lors de l’affaire Dreyfus, le couple diabolique Juifs /maçons est un des arguments les plus efficaces des antidreyfusards. L’Action française combat les hommes politiques maçons et les accuse d’être aux mains des Juifs. Maurras établit alors sa théorie des « Quatre Etats confédérés » (Juifs, maçons, protestants et « métèques »). De nombreux journaux participent au combat contre les « judéo-maçons », les livres se multiplient et Juifs et maçons sont rendus responsables d’à peu près tout : la Grande Guerre, la création de la SDN, les idéaux républicains, la crise économique, la poussée du socialisme. Au début du XXe siècle le « complot judéo-maçonnique » s’enrichit de celui de la conspiration juive mondiale que veulent dévoiler les « Protocoles des Sages de Sion ».
Les « Protocoles des Sages de Sion » semblent issus d’anciens fantasmes et calomnies (crime rituel, légende de l’Antéchrist) mais se présentent comme une entreprise moderne. Les « Protocoles » sont une compilation apocryphe fabriquée par l’Okhrana, la police secrète du tsar. Ils sont rédigés pour alerter le tsar sur le complot judéo-maçonnique et son visage libéral et pour justifier l’antisémitisme d’État. Ce texte, publié en 1905, se présente comme un compte-rendu d’une conférence internationale au cours de laquelle un gouvernement juif occulte (« Sages de Sion ») aurait mis au point un plan de domination du monde. Le livre n’a aucun succès avant la révolution russe date à laquelle il est diffusé auprès des armées blanches. Entre 1919 et 1921 le livre parvient en Occident et devient un véritable best-seller. La première traduction (1919), allemande, devient vite un succès et est utilisée ensuite par la propagande nationale-socialiste. Aux États-Unis c’est Henry Ford qui assure sa promotion.
Les « Protocoles » sont en réalité un faux grossier qui plagie, pour plus de la moitié, un pamphlet daté de 1864 et dirigé contre Napoléon III. Or, pour les antisémites, la démonstration prouvant que c’est un faux atteste par elle-même son … authenticité (de la force du complotisme…). Dans les premiers temps les « Protocoles » sont intégrés par la propagande antibolchevique et alimentent le mythe « judéo-bolchevique » selon lequel les Juifs veulent assurer leur domination par la révolution. La présence d’un certain nombre de Juifs parmi les dirigeants bolcheviks (Trotski, Zinoviev, Kamenev) accrédite la thèse du complot. En réalité, la plupart des dirigeants bolcheviks juifs, ainsi que ceux du Bund, se sont opposés à la révolution d’Octobre et le premier gouvernement bolchevik ne compte qu’un seul Juif en la personne de Trotski.
Durant la guerre civile (1918-1921) les populations juives sont victimes de pogroms perpétrés par les armées blanches, en Ukraine tout particulièrement. Aussi ces populations fuient-elles les Blancs pour se mettre sous la protection des Rouges ce qui, bien entendu, renforce la théorie du complot « judéo-bolchevique ». Or, l’Armée rouge se livre également à des pogroms. Avec la révolution russe, l’insurrection spartakiste en Allemagne et le coup de force de Béla Kun en Hongrie une psychose (la « peur du Rouge ») s’empare des milieux politiques occidentaux et favorise l’antisémitisme du fait de l’assimilation entre Juifs et bolcheviks. Dans la propagation de cet antisémitisme, alimenté par la peur de la révolution, les « Protocoles » jouent un rôle essentiel.
Antisémitisme et antisionisme
Les chapitres 6 et 7 de cet ouvrage de synthèse sont consacrés à l’antisionisme et au « nouvel » antisémitisme contemporain qui, bien souvent, se dissimule sous les traits du premier. Afin de mieux comprendre l’antisionisme et sa convergence avec l’antisémitisme, il est nécessaire, nous dit l’auteur, de rappeler à grands traits l’histoire du sionisme. Le mot « sionisme » a été forgé en 1890 par Nathan Birnbaum. Le terme désigne la volonté de créer un Etat juif, idée portée par de nombreux hommes politiques ou intellectuels favorables à un retour en « Eretz Israël ». De fait, dès les années 1860, de nombreux rabbins, la plupart d’origine russe, se persuadent que la survie de la « nation juive » ne peut se faire que par un retour en « Eretz Israël » et la création de colonies agricoles. Il revient à Theodor Herzl (1860-1904) de donner naissance au sionisme politique. Herzl constate la permanence de l’antisémitisme à travers l’histoire et en déduit la nécessité de créer un foyer national juif dans le « pays ancien nouveau » (« L’Etat juif », 1896). En 1917 la déclaration Balfour promet la création d’un foyer national juif en Palestine. La Palestine, sous mandat britannique, connaît un accroissement constant de la communauté juive. Cependant la politique juive britannique demeure ambigüe et la succession des Livres blancs limite l’immigration. Enfin, en 1947, l’ONU décide de la création de deux Etats en Palestine et le 14 mai 1948 David Ben Gourion proclame l’existence et l’indépendance de l’Etat d’Israël.
Après ce bref rappel, Carol Iancu nous entraîne à nouveau en Russie pour y observer les manifestations de l’antisémitisme et de l’antisionisme durant la période soviétique. La révolution russe de 1917 accorde aux Juifs la pleine égalité civile et politique. Dans les premières années du régime soviétique les Juifs sont protégés et la culture juive peut se développer. Or, en 1928, le gouvernement décide de faire du district de Birobidjan (à 9 000 km de Moscou dans l’Extrême-Orient asiatique) un territoire de peuplement juif. En 1934 ce territoire devient la Région autonome juive. Cette décision du pouvoir soviétique se veut une réponse à la question des minorités nationales et au projet sioniste en Palestine. En réalité, Lénine puis Staline sont opposés à la reconnaissance d’une nationalité juive, qui est selon eux une vision réactionnaire. Le mouvement sioniste est ainsi déclaré contre-révolutionnaire, ses activités interdites et des milliers de militants sionistes arrêtés. La vague de terreur de 1936-1938 touche de plein fouet la communauté juive et l’antisémitisme devient un instrument politique pour briser les opposants (Zinoviev, Kamenev, Radek).
Durant la Seconde Guerre mondiale, et jusqu’en 1948 (reconnaissance de l’État d’Israël par l’URSS), Staline opère un revirement et met l’antisémitisme entre parenthèse. Mais, dès décembre 1948, celui-ci se déchaîne à nouveau et les Juifs sont poursuivis pour « cosmopolitisme », « sionisme » ou « complot contre le pouvoir communiste ». Artistes et intellectuels juifs sont jetés en prison et accusés d’espionnage ou d’ « activité bourgeoise antinationale ». Le sionisme est dénoncé comme « bourgeois », « réactionnaire » et « antidémocratique ». En janvier 1953 éclate l’affaire des « Blouses blanches » : 9 médecins dont 6 juifs sont accusés d’avoir assassiné Jdanov (mort en 1948) et d’avoir préparé l’empoisonnement d’autres dirigeants. Ils ne doivent d’avoir la vie sauve qu’à la mort de Staline (5 mars 1953). Une période d’accalmie s’ensuit, bientôt remplacée par une vague antisioniste camouflant mal un véritable antisémitisme. Selon la doctrine, d’inspiration marxiste, niant l’existence d’un peuple juif, Khrouchtchev proclame que les Juifs, par nature, ne sont pas une nation et sont incapables de former un État. Une véritable littérature antisioniste et antisémite se développe en URSS à partir des années 50. Entre 1967 et 1978, 180 ouvrages antisionistes et antisémites sont recensés. Cette situation donne naissance au mouvement des Refuzniks, c’est-à-dire les Juifs voulant quitter l’URSS pour s’établir en Israël. Avec la chute de l’URSS (1991) l’antisémitisme s’étale à nouveau au grand jour. Dès 1991 des rééditions de « Mein Kampf » et des « Protocoles des Sages de Sion » sont signalées. Tous les poncifs traditionnels retrouvent une nouvelle jeunesse et les mythes antijuifs sont réactivés.
Carol Iancu s’interroge ensuite sur l’antisémitisme, la Shoah et l’antisionisme en Europe de l’Est et prend en exemple quatre pays : Pologne, Roumanie, Hongrie et Tchécoslovaquie. Durant l’entre-deux guerres la majorité des populations juives européennes vivent en Europe de l’Est où elles sont confrontées à un violent antisémitisme. Après la guerre, en raison de la Shoah et des migrations importantes vers Israël et les pays occidentaux, le nombre de Juifs de l’Europe orientale diminue fortement. Cependant l’hostilité aux Juifs persiste en une sorte d’ « antisémitisme sans Juifs » et s’exprime également par l’antisionisme. De plus l’URSS « exporte », à intervalles réguliers, l’antisémitisme dans les « démocraties populaires ». Dans une seconde période, la chute du Mur et la « décommunisation » exacerbent les nationalismes (« retour du tribalisme ») et favorisent un retour de l’antisémitisme en particulier à travers le mythe de la « domination judéo-communiste » rendue responsable de l’oppression des nationalités. Le révisionnisme et le négationnisme trouvent alors un large écho dans ces pays.
Après avoir fait un tour d’horizon détaillé de l’antisémitisme et de l’antisionisme dans les pays de l’Europe de l’Est, de leur histoire et de leur permanence, Carol Iancu s’intéresse à ces phénomènes dans le monde arabo-musulman. L’antisémitisme moderne, et d’origine européenne, pénètre, nous l’avons vu, les terres d’Islam au XIXe siècle. C’est, nous dit l’auteur, à la situation du Proche-Orient qu’il faut s’attacher afin de mieux appréhender l’antisémitisme du monde arabo-musulman. Le 3 janvier 1919 est signé à Paris le premier traité judéo-arabe qui prévoit la reconnaissance mutuelle des deux futurs Etats et l’application de la déclaration Balfour. Ce traité reste lettre morte du fait du partage du Proche-Orient entre Anglais (Irak, Palestine) et Français (Syrie, Liban). A partir de 1919 l’antisémitisme arabe est nourri par le nationalisme qui refuse le projet d’un Etat juif en Palestine. Sous le mandat britannique la Palestine connaît trois logiques politiques différentes : celles des Juifs de Palestine réclamant l’indépendance promise par la déclaration Balfour ; celle des Arabes qui s’y opposent ; celle des Britanniques qui souhaitent rester le plus longtemps possible. Cette situation engendre des troubles. Le grand mufti de Jérusalem, al-Husseini, devient le héros de la rébellion arabe. La Deuxième Guerre mondiale, la situation en Palestine, la création d’Israël, la décolonisation bouleversent le Proche-Orient et la situation des Juifs se dégrade dans les pays arabes (spoliations, emprisonnements, tortures, massacres). Cela provoque une forte émigration : quelques 600 000 Juifs partent pour Israël et 300 000 vers les pays occidentaux. Aujourd’hui, à l’exception du Maroc, de la Turquie et de l’Iran il n’y a pratiquement plus de Juifs dans les pays musulmans.
Dès la naissance d’Israël la haine antijuive s’exprime. Ainsi le jour même de l’indépendance d’Israël, le 15 mai 1948, Azam Pacha, secrétaire général de la Ligue arabe déclare : « Cela sera une guerre monumentale d’extermination qui restera dans l’histoire comme les massacres des Mongols ». Perspective effrayante que confirme le colonel Nasser le 26 mai 1967 à la veille de la guerre des Six Jours : « Ce sera la guerre à outrance, et notre but : la destruction d’Israël ». Les dirigeants arabes sont unanimes : Israël doit disparaître. L’antisionisme arabe intègre et assimile alors tous les poncifs de l’antisémitisme européen. La victoire juive de 1967 fait de l’Etat d’Israël, aux yeux des populations arabes, un Etat colonial, impérialiste et raciste. L’Etat d’Israël et les Juifs font alors l’objet d’une haine radicale qui mêle antisionisme, antijudaïsme et antisémitisme. La volonté de détruire Israël est récurrente dans les discours des dirigeants arabes. En 2006, la déclaration finale de la Conférence antisioniste qui se tient à Téhéran proclame à propos de l’Etat d’Israël : « Il n’a pas le droit à l’existence ni légalement ni légitimement ». Carol Iancu, pour appuyer son propos, rappelle fort opportunément le nombre d’anciens responsables nazis ayant trouvé refuge dans les pays arabes. De fait, l’antisionisme initial s’est progressivement transformé en un véritable nouvel antisémitisme qui a des répercussions également en Occident, en particulier en France où se trouvent des populations juives et musulmanes nombreuses. Selon l’auteur, ce nouvel antisémitisme, fondé sur l’amalgame Juif-sioniste-Israël, est propagé par les dirigeants des pays arabes et par la diaspora musulmane en Europe où il est plus virulent depuis l’ « islamisation » de la question palestinienne.
L’historien rappelle la trop longue liste des attentats antijuifs commis en France, de la rue Copernic (octobre 1980) à l’Hyper Cacher (janvier 2015). En 2001 le président de la Licra s’exclame dans le Figaro : « Et nous en avons marre ! Marre de voir des citoyens français de confession juive payer pour ce qui se passe au Proche-Orient ». Et, en effet, de 2000 à 2012, la plupart des actes antisémites ont un lien avec la situation au Proche-Orient (« Intifada des banlieues », assassinat de Ilan Halimi, affaire Merah…). En 2012, 614 actes antisémites sont recensés et François Hollande promet de combattre partout l’antisémitisme. Dès 2002 Georges Bensoussan avait alerté sur la recrudescence de l’antisémitisme, en particulier dans les banlieues et dans la jeunesse issue de l’immigration (« Les Territoires perdus de la République » sous le pseudonyme d’Emmanuel Brenner).
Le protocole des sages de Sion
Par ailleurs, sous couvert de défense de la cause palestinienne, perçue comme une résistance à la volonté de domination juive (et, implicitement, capitaliste), des alliances objectives et conjoncturelles se sont nouées dans la France des années 1990 entre les tenants d’un islamisme radical et des groupes d’extrême-droite et parfois d’extrême-gauche. Un sympathique militant du GUD témoigne : « Le « Keffieh » côtoyait la croix celtique, alliance qui semblait paradoxale au début et qui pourtant s’est imposée au fil des ans comme la voie à suivre ». L’ennemi commun est facilement identifiable. Quant à l’extrême-gauche elle semble parfois préférer l’image du Juif persécuté (quoiqu’une frange soit imprégnée par les discours négationnistes) à celle du Juif qui se défend. Cette « nébuleuse antisémite » se manifeste dans des réunions publiques, certains discours politiques, des journaux et surtout Internet.
La triste réalité d’un antisémitisme « enkysté » (G. Bensoussan) dans une partie de la population est préoccupante. Ainsi en est-il du milieu scolaire pour lequel Michel Wieviorka note : « L’antisémitisme scolaire, chez les élèves, s’alimente aussi bien d’identifications peu informées à la cause palestinienne que d’une sympathie pour les attentats antiaméricains et antioccidentaux. En même temps, il se nourrit de l’ethnicisation de la vie collective » (« La Tentation antisémite », 2005). Ainsi en est-il aussi, de façon dramatique, de la tuerie de l’Hyper Cacher en janvier 2015. De même l’humoriste – mais le mot est-il bien choisi ? – Dieudonné a régulièrement défrayé la chronique en affichant un antisémitisme outrancier. Ce nouvel antisémitisme qui est parfois le fruit d’une « alliance » entre les deux extrêmes de l’échiquier politique a eu, en réalité, des antécédents. Maurice Bardèche, beau-frère de Robert Brasillach et théoricien du fascisme à la française, et Paul Rassinier, pacifiste de gauche et ancien déporté de Dora, sont les précurseurs du négationnisme dans sa première formule (1948-1967). La suite de l’histoire du négationnisme (« affaire Faurisson », « affaire Roques »…) a prouvé que les « assassins de la mémoire » (Pierre Vidal-Naquet) sont nombreux et divers.
Les mythes de la « conspiration juive mondiale » et du « complot sioniste » sont, dès 1917, associés. L’essence de la « réunion » des Sages de Sion aurait été reprise par Theodor Herzl en 1897 au premier congrès sioniste de Bâle. La thèse faisant des « Protocoles » le programme secret du gouvernement juif mondial a été ensuite largement reprise. Le mythe du « complot sioniste » a traversé tout le XXe siècle et, depuis 1948, s’est cristallisé dans la dénonciation d’Israël. Le « nouvel » antisémitisme repose en grande partie sur la croyance d’une conspiration juive orchestrée par Israël. Par ailleurs, l’assimilation sionisme/ racisme s’est répandue dans les pays arabes et dans le Bloc de l’Est à partir de la guerre des Six Jours dont l’auteur souligne à plusieurs reprises l’importance pour comprendre le nouvel essor de l’antisémitisme. En URSS toute une littérature a développé de manière obsessionnelle la théorie voulant que les sionistes aient été complices des nazis et assimilant les dirigeants d’Israël à des SS (assimilation que l’on retrouve dans le sketch hélas trop connu de Dieudonné).
Autre mythe incontournable du négationnisme et du nouvel antisémitisme : le « mensonge d’Auschwitz ». Pour les négationnistes, on le sait, la Shoah n’est qu’une pure invention visant à justifier l’existence d’Israël. Le génocide ne serait donc qu’un mensonge colossal dont les Juifs seraient de plus les bénéficiaires du fait des indemnités accordées. Le négationnisme remonte aux livres de Maurice Bardèche, « Nuremberg, ou la Terre promise » (1948), et de Paul Rassinier, « Le Mensonge d’Ulysse » (1950), qui mettent en doute l’existence des chambres à gaz. Robert Faurisson reprendra cette théorie cherchant à l’appuyer sur la démonstration de l’impossibilité technique des chambres à gaz (théorie brillamment démontée par la thèse de Jean-Claude Pressac, lui-même ancien négationniste). Enfin, Roger Garaudy, ex-communiste, converti au catholicisme puis à l’islam, dénonce lui aussi le mensonge des chambres à gaz. Tous ces « assassins de la mémoire » mêlent étroitement négationnisme, antisionisme et antisémitisme car comme le dit l’historienne Nadine Fresco, biographe de Rassinier, « la négation des chambres à gaz est un cancer de l’esprit librement contracté dans l’antisémitisme et qui se répand aujourd’hui sur Internet ».
Carol Iancu nous montre enfin comment les mythes antisémites européens sont aujourd’hui recyclés dans les pays arabo-musulman. A ce propos il écrit : « La montée de l’antisémitisme dans le monde arabo-musulman contemporain, alimentée par le conflit israélo-palestinien et un islamisme de plus en plus radical, révèle un « décalque » de l’antijudaïsme et de l’antisémitisme européens basé sur un certain nombre de mythes « recyclés » ». Ainsi les mythes du « meurtre rituel », de « l’empoisonnement des puits » et de « l’empoisonnement du sang (notamment par le virus du Sida) et de la nourriture » sont réactivés, adaptés et modernisés et se répandent dans tout le monde arabo-musulman, relayés par la presse et les plus hautes autorités. De même le mythe du complot juif mondial, véhiculé par les Frères musulmans, est aujourd’hui particulièrement vivace et alimente le djihad comme une réponse à la menace juive. Ce mythe du « complot juif » est très éloigné de l’islam traditionnel et est marqué par l’influence européenne (Bernard Lewis, « Sémites et antisémites », 1987) comme le montrent l’incroyable succès des rééditions des « Protocoles des Sages de Sion » ou la propagation du thème du « mensonge d’Auschwitz » (il ya une réelle collusion entre négationnisme et antisionisme).
Tout au long de cette synthèse solidement documentée Carol Iancu nous explique comment l’on est progressivement passé de l’antijudaïsme originel à l’antisémitisme qui est un racisme spécifique et complexe. De fait, la « passion antijuive » change de nature car si, de l’Antiquité à l’époque moderne, la conversion suffisait à faire d’un Juif un être « normal », le déterminisme racial contemporain le condamne définitivement. Avec la biologisation de la « question juive » le Juif n’est plus simplement « étrange », il devient, par nature, fondamentalement différent. La Shoah représente le point paroxystique et apocalyptique de cette évolution. Après la guerre l’antisémitisme connaît un net reflux mais il refait rapidement surface, et avec une intensité réelle, dans les pays communistes et dans les pays arabes. A partir de la guerre des Six Jours le mélange effectif entre l’antijudaïsme, l’antisionisme et le négationnisme forme un cocktail explosif et donne naissance à un « nouvel » antisémitisme qui, à force de glissements successifs, parvient à « retourner contre les Juifs l’accusation de racisme » (Pierre-André Taguieff).
Carol Iancu nous montre aussi comment, à travers les âges, tous les mythes originels de la haine antijuive ont connu, avec succès, de nombreux « recyclages ». Enfin, l’auteur a la tristesse de constater dans l’actualité la perpétuation et la capacité d’adaptation de l’aversion antijuive. De nos jours le point de tension véritable se situe dans le face-à-face judéo-musulman, sur fond de conflit israélo-palestinien. La haine antijuive se perpétue aujourd’hui le plus souvent sous sa forme antisioniste mais mobilise également des positionnements divers (antimondialisation, anticapitalisme, antiaméricanisme). C’est pourquoi Carol Iancu avoue l’objectif de son ouvrage : alerter et maintenir la vigilance dans le grand « désordre international » marqué par un retour en force de l’antisémitisme. Cependant, pour ce faire, il ne faut pas se contenter de dresser un portrait monstrueux des relations entre Juifs et non-Juifs car l’histoire a aussi été marquée par des moments d’échanges apaisés et fructueux et cet héritage demeure. Une parole d’espoir, donc, en guise de conclusion.