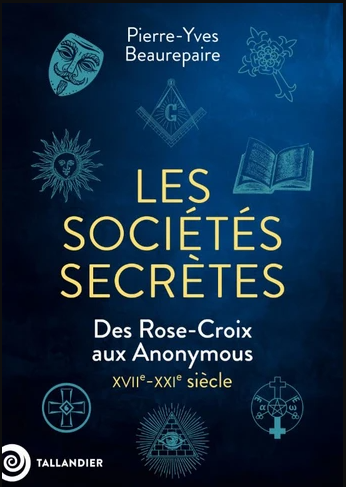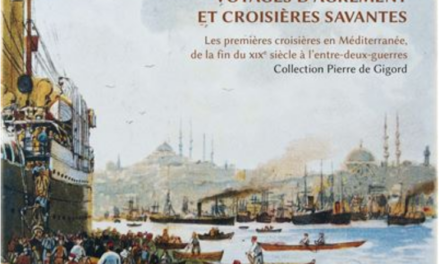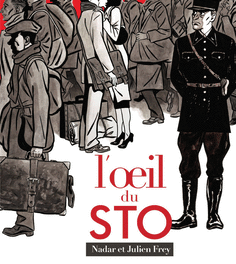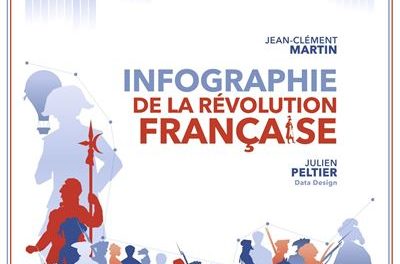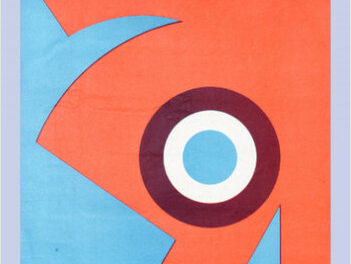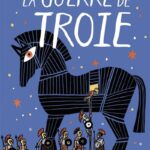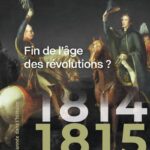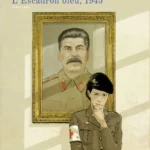Après un ouvrage consacré à l’histoire des Illuminaten de Bavière, l’historien Pierre-Yves Beaurepaire nous propose cette fois-ci une plongée dans Les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous XVIIᵉ-XXIᵉ siècle.
L’historien débute son préambule avec une accroche haletante : la découverte, un matin d’août 1623, sous le règne de Louis XIII, d’une mystérieuse affiche placardée aux carrefours et sur les portes des églises de Paris. Il débute ainsi :
« […]S’il prend envie à quelqu’un de nous voir, par curiosité seulement, il ne communiquera jamais avec nous ; mais si la volonté le porte à voir le porte réellement et de fait de s’inscrire sur le Registre de notre Confraternité, nous qui jugeons des pensées, lui feront voir la vérité de nos promesses. […] »
Dès lors se pose la question : qui se cache derrière cette confrérie des invisibles, quelles sont ses pouvoirs et ses intentions ? Immédiatement, un lien est fait avec la Rose-Croix qui, la décennie précédente, avait ébranlé l’Allemagne. C’est sur cette interrogation mystérieuse que Pierre Yves Beaurepaire happe le lecteur.
L’introduction lui permet de rappeler le pouvoir de l’empire des invisibles, et un rappel bibliographique : le livre d’Edward Bernays Propaganda. Comment manipuler l’opinion en démocratie, publié en 1928 et qui démontre les rouages des mécanismes de prise de contrôle des esprits et des comportements, ce que l’on appelle par extension l’empire des invisibles, dont la puissance s’est mise au service de la propagande politique tandis que, peu à peu, l’industrie du divertissement s’en est emparée, d’Harry Potter à Assassin’s Creed, aidée en cela par la fascination qu’exerce le secret sur les populations en général, et l’Occident en particulier, alors que dans le même temps, ce dernier a bâti son modèle politique sur la démocratie et la transparence. La classe politique n’est pas en reste, comme le montrent les exemples de Benjamin Disraeli et de John Fitzgerald Kennedy qu’il faut cependant contextualiser afin de ne pas céder à la tentation complotiste.
Pierre-Yves Beaurepaire divise son propos en trois grandes parties, chacune concentrée sur les trois époques que les sociétés secrètes ont traversées dans le monde occidental. L’auteur prend bien soin de distinguer les sociétés secrètes criminelles. Il n’est pas question ici, sauf exception.
Fondations
La première partie est intitulée « fondations » et revient sur les origines des sociétés secrètes, reliées à ce que Pierre-Yves Beaurepaire appelle la « révolution Rose-Croix ». Le premier chapitre nous propose de suivre le personnage de Michel Maier (1569-1622), philosophe, médecin et alchimiste majeur. Cette dernière discipline a son importance puisqu’elle devient à cette époque un savoir central, requérant un apprentissage long, et ce à une époque où de nouvelles substances en provenance du Nouveau Monde arrivent dans les pharmacopées occidentales. Installé à Francfort, en 1616, il s’intéresse alors à plusieurs textes qui paraissent au même moment et qui se présentent comme étant des manifestes rosicruciens. Parmi ces derniers, plusieurs ouvrages fondateurs doivent être cités : la « Fama Fraternitatis », et la « Confessio Fraternitatis ». Un troisième ouvrage se distingue : les Noces chimiques de Christian Rosencreutz en l’année 1549, dont la lecture déclenche chez lui une véritable conversion intellectuelle et spirituelle qui lui donne alors envie de partir sur le chemin des Rose-Croix. Ces derniers ont, selon lui, un point commun avec l’alchimie : chercher à soigner l’Humanité de ses maux.
Le contexte de l’apparition des Rose-Croix : la guerre de Trente ans
C’est dans ce contexte qu’apparait un personnage fondateur de la mythologie rosicrucienne et l’exemple à suivre : Christian Rosencreutz qui aurait vécu au XIIIᵉ siècle. Sa quête spirituelle l’aurait mené de Fès à la péninsule Arabique. Mais il ne s’agit là que d’une histoire et non de l’Histoire. L’auteur de l’ouvrage, qui selon Pierre-Yves Beaurepaire pourrait relever du genre fantasy bien avant l’heure, ne sera connu qu’en 1642 : Jean Valentin Andreae (1586-1654), par ailleurs membre d’un collège de mystiques, le Cercle de Tübingen. Un symbole apparaît, achevant de donner leur identité visuelle à ces invisibles : une croix et une rose.
Cet intérêt pour le visible et l’invisible est à rapprocher par ailleurs au même moment des écrits passés de Luther qui évoquent une église invisible et la capacité pour une communauté spirituelle de communiquer à distance. C’est bien dans un contexte géopolitique particulièrement tourmenté et anxiogène qu’il faut comprendre le projet des Rose-Croix. En effet, le début du XVIIᵉ siècle est traversé par une triple crise profonde : religieuse et politique d’abord, avec le début de la guerre de 30 ans, pour des motifs que nous ne rappellerons pas ici, mais également scientifique. Les savants sont alors partagés entre deux attitudes opposées : la notion de progrès et la volonté de partir à la découverte du vivant, et ceux qui condamnent fermement cet esprit de progrès au nom du dogme. C’est dans ce contexte tourmenté que se situe le projet des Rosicruciens dont Paracelse fait partie : revenir aux sources des savoirs anciens pour apprendre les moyens de sauver l’Humanité, mais en se réservant le droit de communiquer avec ceux qu’ils estiment dignes de les rejoindre dans ce projet.
Le secret, nature des Princes qui rejoint l’essence des sociétés secrètes
Le chapitre 2, « L’envol du Phénix », souligne le grand intérêt porté par les princes pour les manifestes rosicruciens, les promesses de connaissances en chimie ainsi que les propositions formulées. Parmi ces princes qui adhèrent aux idées professées par les rosicruciens, se placent en tête Maurice le Savant et Auguste d’Anhalt Plötzkau. Pourquoi cet intérêt des princes ? Le secret et la distance créés par celui qui sait et celui qui ignore font aussi partie de la nature et de la pratique du pouvoir du prince. Mais en même temps, l’existence d’un ordre secret en perturbe également plus d’un, comme le montrent l’affaire du Marbourg en 1619 et le sort réservé à Adam Haslmayr condamné aux galères. Un autre personnage historique a lui aussi montré son intérêt profond pour les Rose-Croix sans en faire partie : René Descartes, comme l’atteste sa dédicace dédiée entre autres aux Rose-Croix allemands dans le préambule du Polybii Cosmopolitani Thesaurus mathematicus. Plus globalement, l’esprit qui inspire le contreordre néo-rosicrucien en développement à partir du XIXᵉ siècle, comme l’ordre cabalistique des Rose-Croix, fondé en 1888, ne manque pas d’attirer des artistes, notamment Éric Satie ou le peintre Yves Klein.
Héritages
Le secret entre ombre et lumière
La deuxième grande partie intitulée « Héritages » s’ouvre sur le chapitre trois « le piège du secret ». Pierre-Yves Beaurepaire revient sur un sujet qu’il maîtrise : la franc-maçonnerie, qui apparaît à partir de la fin du XVIIᵉ siècle. Mais, si elle ne peut pas être qualifiée de confrérie invisible, sa discrétion et le secret qu’elle revendique nourrissent les fantasmes, ce qui n’est pas sans conséquences sur ses activités, comme le démontre Pierre-Yves Beaurepaire dans le chapitre III « le piège du secret ». En 1738, Clément XII promulgue la bulle In Eminenti apostolatus specula par laquelle il interdit aux catholiques de devenir francs-maçons (cette bulle est toujours d’actualité au passage).
Le chapitre IV « Un art secret de gouverner » revient aux Rose-Croix et à leur postérité à l’époque des Lumières et au-delà. Mais il est difficile, voire impossible, de trouver une continuité entre les Rose-Croix des origines et le mouvement tel qu’il se développe au siècle des Lumières. Cependant, certaines similitudes semblent exister avec d’une part les francs-maçons et d’autre part leurs grands concurrents les Illuminaten, l’École secrète de sagesse. Pierre Yves Beaurepaire, qui leur avait consacré son précédent ouvrage, revient sur ces derniers pour les comparer et mettre en évidence la fonction tripartite du secret : attirer, protéger, dominer. Car c’est là que réside aussi l’intérêt du livre : expliquer, au-delà de la fascination qu’il exerce pour ceux qui ne sont pas initiés, l’intérêt du secret entretenu par un groupe d’individus via l’exemple des Illuminaten et ce dépit du caractère sectaire de ces derniers.
Avatars
Du religieux à la politique : l’évolution des sociétés secrètes
La troisième partie intitulée « Avatars », quant à elle, fait le point sur notre époque actuelle. Le chapitre cinq avec « l’empire des sociétés secrètes » fait du XIXᵉ siècle le point de bascule des sociétés qui émergent et qui passent du religieux au politique dans un contexte trouble qui suscite la méfiance à leur égard : les Carbonari, la loge P2, le KKK. Plusieurs pages sont ainsi consacrées à la Charbonnerie, et au rôle joué par exemple par Pierre Joseph Briaud, originaire du Doubs, visiblement proche de Lucien Bonaparte, et à la fois franc-maçon et chevalier Rose-Croix. L’Amérique espagnole fut également un centre d’agitation libérale au début du XIXᵉ siècle. De nombreuses loges maçonniques se développent à l’intérieur desquelles se développent les idées d’indépendance en Amérique du Sud. Un personnage l’illustre : Simón Bolívar, qui fut aussi un franc-maçon.
En Amérique du Nord, les sociétés secrètes se développent en premier dans les milieux étudiants. L’une des plus célèbres est sans conteste la Skull and Bones fondée à l’université de Yale, mais pas la seule. Dans un autre genre, le Ku Klux Klan est fondé au lendemain de la guerre de Sécession sur le modèle des fraternités étudiantes et en particulier d’une autre société secrète, le Kuklos Adelphôn créée en 1812 en Caroline du Nord. Bien sûr, la tentation est très grande pour ces invisibles de faire savoir au public qu’un petit nombre d’élus détient les clés du savoir. Plusieurs pages sont consacrées à cette organisation d’extrême droite, blanche et raciste : sa nature, son organisation, la propagande raciste à laquelle elle se livre, tout un projet où le lecteur n’aura aucune peine à percevoir l’opposition et le projet à l’opposé de celui des Rose-Croix et des francs-maçons auxquels elle emprunte certaines symboliques et critères d’organisation tout en lui étant fondamentalement opposée. Cet aspect est lisible en particulier dans un ouvrage fondateur écrit par William Joseph Simmons : le Kloran publié en 1916 dans un contexte de refondation du KKK.
Enfin, depuis la fin du XXᵉ siècle, la croyance en l’existence d’un État profond (le fameux Deep State) a relancé l’intérêt du grand public pour les sociétés secrètes pour le meilleur et pour le pire, ce qui explique le succès phénoménal du mouvement QA.Non, tandis que de nombreux mouvements complotistes se rattachent de près ou de loin à la nébuleuse MAGA et à un soutien fanatisé, comme le souligne parfaitement l’auteur, à Donald Trump. Quelques pages sont également consacrées au scandale de la loge P2 qui éclate en 1981 et dont les effets ont été dévastateurs pour l’image de la franc-maçonnerie.
Les multiples avatars de la culture pop
Dans un sixième chapitre intitulé « L’ordre du Phénix ou l’éternel recommencement », Pierre-Yves Beaurepaire nous propose de souffler et d’élargir notre vision de ces fameux avatars en s’intéressant à ceux créés par la fiction au sens large : jeux vidéo, films, séries, bandes dessinées, poésie, musique, les sociétés secrètes en général et les Rose-Croix en particulier ayant puissamment inspiré la pop culture dont les productions reposent pour beaucoup sur le thème des sociétés secrètes. De Lara Croft à Harry Potter ( le phénix est un symbole rosicrucien et maçonnique), en passant par Captain America, Assassin’s Creed, Tintin (relisez les Cigares du pharaon) ou encore même l’œuvre d’Hugo Pratt (lui-même par ailleurs franc-maçon), père du « franc-marin » Corto Maltese dont les aventures sont truffées de références maçonniques. Autre exemple notable que nous avons sous les yeux : Brian Herbert, l’auteur de Dune, qui a créé la fascinante Communauté des Sœurs dont l’essence même est le secret.
Pierre-Yves Beaurepaire nous propose donc ainsi un ouvrage extrêmement dense et passionnant, qui nous démontre que, si le secret (ou la discrétion) est l’essence directive de certaines sociabilités, il représente aussi leur point faible par lequel le grand public autant pour les attaquer que pour les réinventer.