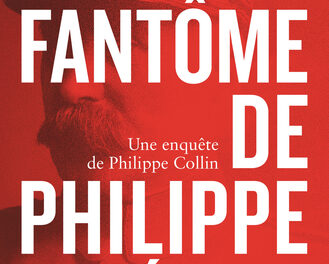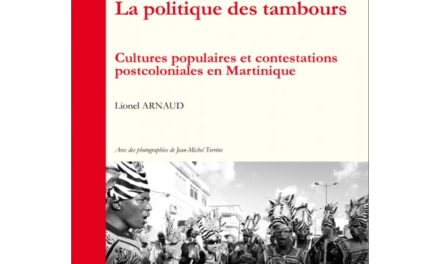L’Histoire économique en mouvement comprend deux parties qui auraient pu être publiées séparément ; c’est une sorte d’avatar éditorial du concept « Deux en un. »
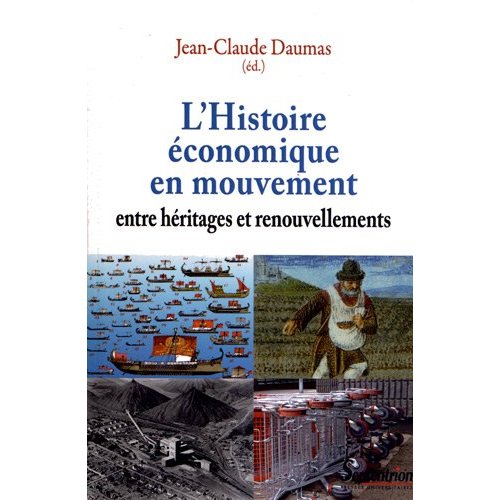
La première partie permet de prendre connaissance des résultats des travaux du RTPRéseau Thématique Pluridisciplinaire. d’histoire économique du CNRS placé sous la direction de Jean-Claude Daumas : « C’est parce qu’elle faisait le constat de l’affaiblissement et des difficultés actuelles de l’histoire économique dans notre pays que la direction du Département des Sciences de l’Homme et de la Société du CNRS a créé, en mai 2007, le Réseau thématique pluridisciplinaire (RTP) d’histoire économique avec pour mission de faire un audit de cette branche du savoir historique et de favoriser l’émergence de thématiques et de forces nouvelles. » (page 13). La Deuxième partie rassemble les communications présentées lors du colloque organisé en 2010 à Lyon par le même RTP en prologue au congrès de l’Association Française d’Histoire Economique, colloque qui portait sur « L’histoire économique vue d’ailleurs. » Si les deux parties ne sont pas sans rapport, on voit bien qu’elles relèvent de deux registres différents.
L’histoire économique en France
Pas moins de quatorze contributions différentes permettent de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de l’histoire économique en France, les raisons de son déclin relatif mais aussi les progrès de l’historiographie française des vingt ou trente dernières années dans ce domaine.
Parmi ces contributions, on peut citer celles où l’auteur s’efforce de porter un regard global sur la situation de l’histoire économique en France. C’est le cas en particulier de l’éditeur, Jean-Claude Daumas, dans un chapitre intitulé « Où va l’histoire économique en France aujourd’hui ? Tendances, enjeux, propositions. » Ce chapitre fait fonction d’introduction à cette partie du livre et en même temps de conclusion dans la mesure où il a été écrit à l’issue de l’audition de tous les contributeurs entendus par le comité scientifique du RTP d’histoire économique.
Le livre ne comporte par d’index. Mais l’historien le plus cité dans le volume est sans doute Labrousse. Pour l’histoire économique, en raison du succès de l’Ecole des Annales, de la place éminente de quelques historiens économistes dans la production historique, en particulier Labrousse et Braudel, les années 1950, 1960 et 1970 représentent une sorte d’apogée, et son déclin actuel se mesure à l’aune ce celui-ci. En réalité, cette représentation de l’histoire de l’histoire économique doit être largement relativisée comme le montre Jean-Claude Daumas : « La statistique des livres, des thèses et des articles, malgré d’inévitables décalages entre ces trois types de productions, ne confirme par l’idée, aujourd’hui si largement répandue qu’elle fait partie de la doxa disciplinaire, d’une domination sans partage de l’histoire économique jusqu’au tournant des années 1970. […] Quelques grandes thèsesL’auteur pense sans doute aux thèses d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Chaunu, Jean Delumeau … , les collections de la VIe section et les Annales – où elle avait, il est vrai, des positions très fortes – ont servi de vitrines à l’histoire économique mais, quantitativement, celle-ci n’a jamais été dominante, loin s’en faut, dans la production historiographique française. » (pages 22 et 24). Par ailleurs, Jean-Claude Daumas souligne et rappelle que Labrousse ne pratiquait pas l’histoire économique pour elle-même : « Que faisait-on, au juste, dans les années 1950, 1960 et 1970, sous le label d’histoire économique quand on se réclamait de Labrousse ? De l’histoire économique « pure » ou « principalement économique », selon la formule de Duroselle, ou de l’histoire-économique-et-sociale ? Labrousse, pour sa part, parlait de « socio-économie », c’est-à-dire d’une « histoire sociale des faits économiques ». Pour dire les choses autrement, c’est moins le fait économique en soi qui l’intéressait que sa signification sociale » (page 26), cet intérêt étant lié à ses convictions et engagements politiques comme a pu l’affirmer Maurice Agulhon : « Selon lui, Labrousse était un historien social « parce que socialiste ». » (page 26).
C’est donc du divorce entre l’histoire économique et l’histoire sociale que provient, en partie, le sentiment du recul de l’histoire économique dans la production historique. En effet, à partir des années 1970, beaucoup d’héritiers de Labrousse et l’Ecole des Annales cessent, pour dire les choses rapidement, de faire de l’histoire économique et sociale pour pratiquer l’Anthropologie historique qu’on peut qualifier, pour mieux mettre en évidence le changement de « paradigme », d’histoire culturelle et sociale. Il suffit de penser aux parcours d’Alain Corbin, Jean Delumeau ou Jacques Le Goff, pour ne citer que trois exemples, pour s’en convaincre. Les historiens de l’économie quant à eux, sans se désintéresser de la société, se sont tournés vers une histoire économique plus « pure » et ont continué à travailler.
Ce travail a porté de nombreux fruits ; la lecture des contributions des différents auteurs suffit à s’en convaincre. Deux de ces contributions portent sur une période particulière, l’Antiquité et le Moyen-Age, alors que la majorité traite des différentes branches de l’histoire économique qui ont connu des renouvellements importants, comme le laissent entendre leur titre : « L’histoire du commerce et de l’industrie à l’époque moderne », « Histoire économique, histoire des campagnes : le renouveau d’un paradigme ? », « Institutions et histoire économique », « L’histoire bancaire, monétaire et financière française depuis 1980 », « La Business history à la française ». Deux contributions apportent un « regard » décalé ou du moins décentré : « L’histoire italienne à la recherche d’une nouvelle identité » et « L’histoire économique française vue d’ailleurs ».
Il est difficile de rendre compte en quelques lignes de sujets aussi variés même si presque tous ces textes sont autant d’appels à renouveler notre enseignement ou nos manuels. Un exemple en particulier le montre. Gérard Béaur établit la liste des sept principaux changements qu’a connus l’histoire économique des campagnes. Parmi ceux-ci, « La fiction d’un monde immobile » : « Le monde rural a figuré jusqu’à très récemment comme un univers stable, immobile. Les hommes comme la terre ne bougeaient pas. On se mariait sur place et on conservait jalousement les lopins dont on avait hérité que l’on transmettait pieusement de génération en génération. Cette conception rassurante a volé en éclat. » (page 134).
Ainsi, l’ensemble des auteurs souligne et décrit les progrès accomplis par l’histoire économique pendant ces vingt ou trente dernières années. Cela ne les empêche pas de partager le constat d’un recul de leur discipline, qui se mesure notamment, mais pas seulement, en terme de rayonnement international, de nombre de postes dans les universités et celui des soutenances de thèses. Certains font des propositions pour donner un nouveau souffle à l’histoire économique. C’est le cas en particulier de Jean-Claude Daumas ; il consacre presque la moitié de sa contribution à présenter « Neuf propositions pour redynamiser l’histoire économique. » Parmi celle-ci, on en retiendra une en particulier : « Sortir du ghetto académique pour participer au débat public » (page 57 et suivantes). On peut s’étonner en effet que, à l’heure où les médias ne cessent d’évoquer des questions économiques, les historiens de l’économie soient à peu près inaudibles, même dans des médias comme France CultureL’auteur cite, a contrario, l’exemple de la tribune de Gérard Béaur, « Le Long passé de la dette publique », publié dans Le Monde des 14-15 août 2011.. On notera au passage qu’aucune proposition ne porte sur une quelconque ouverture vers le secondaire. Il est vrai que la baisse du recrutement des filières d’histoire dans les universités est un enjeu qui dépasse la question de l’attractivité de la seule histoire économique.
L’histoire économique vue d’ailleurs
La deuxième partie du livre reprend les communications présentées lors du colloque « L’histoire économique vue d’ailleurs » organisée par l’AFHE en 2010. Les auteurs sont tous des historiens étrangers venus présentés aux chercheurs français leurs travaux. Beaucoup portent sur l’éternelle, passionnante et décisive question de l’industrialisation. Kenneth Pomeranz avait été ainsi invité pour présenter son livre, La Grande Divergence, paru cette année-là en français et dont on sait le retentissement qu’il a euJusque dans les colonnes de la cliothèque avec le compte-rendu de Dominique Chathuant, http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2960.
La contribution de Kenneth Pomeranz est immédiatement suivi par celle de Peer Vries, professeur d’histoire économique à l’Université de Vienne, qui se livre à une critique assez virulente de la thèse de Pomeranz et, plus largement, de l’école californienne. Il remet en cause tout d’abord les fondements de la comparaison de Pomeranz entre l’Angleterre du XVIIIe siècle et la région du delta du Yangzijiang à la même époque. Aux « ressemblances surprenantes » entre ces deux espaces que décrit Pomeranz, il oppose des « différences frappantes. » Il montre par exemple que les agricultures des deux espaces en question étaient radicalement différentes. « L’agriculture britannique se pratiquait à grande échelle ; les animaux y jouaient un rôle essentiel et le salariat était une donnée courante et généralisée » (page 316) alors qu’en Chine « L’agriculture se caractérisait par un mode de production familial » (page 317). Par ailleurs, il reproche à Pomeranz d’avoir largement sous-estimé le rôle de l’innovation dans le démarrage de l’industrialisation en Angleterre, innovation qui reste pour lui le « moteur de la croissance » (page 329) et d’avoir au contraire surestimé le rôle « des avantages géographiques, des ressources et de l’accumulation. » Ce résumé partiel et rapide de la critique de la thèse de Pomeranz par Peer Vries ne doit cependant pas laisser penser qu’il la rejette complètement. Il la trouve seulement insuffisante comme il l’explique en conclusion : « Le charbon et les colonies ont été décisifs dans l’ascension de l’Occident, ou plutôt de la Grande Bretagne. Bien des parties de l’Europe n’échappèrent pas à Malthus [comprendre ne commencèrent pas à s’industrialiser] par une combinaison « charbon et colonies », de même que beaucoup d’autres pays dans le monde au moment de leur décollage. Se borner à mentionner le charbon et les colonies ne peut même pas suffire à expliquer celui de la Grande Bretagne. » (page 338). Il mentionne plus loin, toujours dans la conclusion, les autres facteurs qu’il faudrait prendre en compte pour « résoudre l’énigme de la « grande divergence » » : « Les différences que j’ai soulignées entre la Chine et la Grande-Bretagne (nature des Etats, modes de production, systèmes des connaissances et des techniques) ont sûrement fait la différence. » (pages 339-340).
A défaut d’être en mesure de juger de la portée des arguments de Peer Vries, j’ajouterais que le commun des historiens ou des professeurs d’histoire du secondaire, qui ne maîtrise pas la totalité de la bibliographie portant sur la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle et encore moins celle portant sur la Chine du même siècle, a sans doute tendance à adhérer à la thèse de Pomeranz pour des raisons qui ont trait au présent plus qu’à l’histoire. Mettre en avant le rôle du charbon dans le décollage économique de la Grande-Bretagne renvoie immédiatement aux débats actuels sur la question des ressources en énergie et plus largement aux enjeux du développement durable, au sens large, et donc entraîne facilement l’adhésion du lecteur. De la même façon, attribuer un rôle central aux « colonies » dans le début de l’industrialisation en Grande-Bretagne ne peut qu’entrer en congruence avec la passion dont l’histoire coloniale fait l’objet en ces temps post-coloniaux.
Parmi les autres contributions, on notera en particulier celle de Maxine Berg, professeur à l’université de Warwik, « Les siècles asiatiques de l’Europe. Asie, luxe et approches nouvelles de la révolution industrielle. » Elle y présente les premiers résultats d’un programme de recherche qui porte sur « Le rôle joué par le commerce avec l’Asie dans les origines de la révolution industrielle » et se place dans le courant de l’histoire globale.