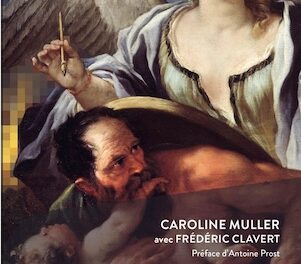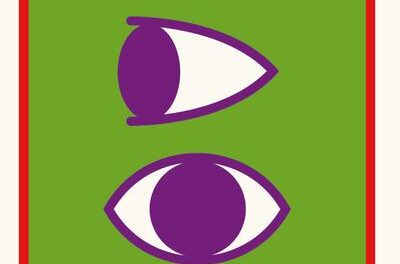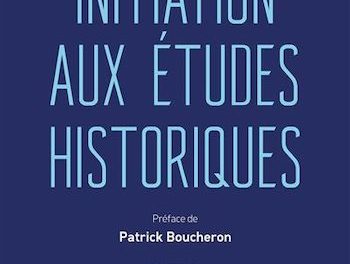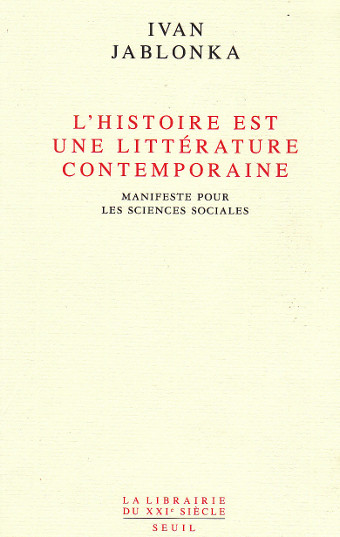
Ivan Jablonka est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris XIII (Sorbonne Paris-Cité). Il est rédacteur en chef de laviedesidees.fr et codirecteur de la collection « La République des Idées » au Seuil. Il a publié en 2007 une version de sa thèse Enfants en exil : transfert de pupilles réunionnais en métropole (1963-1982). Il y étudie le déplacement de 1630 enfants vers la métropole, pupilles de la DDASS de la Réunion. Cette migration forcée, orchestrée par Michel Debré, afin de lutter contre la « surpopulation » sur l’île et de repeupler les déserts ruraux de la métropole est définie comme « une institution républicaine, séquelle du colonialisme dans la France de la Ve République ». En 2012, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (Le seuil, « La Librairie du XXIe siècle ») raconte la vie et la mort de Matès et Idesa Jablonka, ses grands-parents paternels, depuis la Pologne jusqu’à Auschwitz en passant par l’engagement dans le Parti communiste polonais, l’exil en France et le régime de Vichy. Historiographiquement novateur, cet ouvrage est fondé sur l’étude de sources écrites et orales. Il cherche à faire revivre les disparus entre histoire, mémoire et travail de deuil. Ce livre a reçu le prix du Sénat du livre d’histoire, le prix Guizot de l’Académie française et le prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de l’histoire de Blois.
Ivan Jablonka publie aujourd’hui un essai épistémologique et historiographique d’un abord un peu difficile. Avec pour objet non seulement l’histoire mais l’ensemble des sciences sociales, avec des références historiques, littéraires, sociologiques et historiographiques extrêmement diverses, il exige pour être vraiment compris et apprécié une immense culture et d’innombrables lectures qui sont très loin d’être celles de l’auteur de ce compte rendu. Qu’il me suffise (l’un des chapitres les plus persuasifs et les plus accessibles de l’ouvrage plaide pour l’emploi de la première personne du singulier en histoire) par exemple de relever, en utilisant l’index des noms, les auteurs les plus fréquemment cités : Aristote, Cicéron, Hérodote, Platon, Thucydide, mais aussi Chateaubriand, Balzac, Georges Perec, Marcel Proust, Zola, mais encore Charles Bayle, Victor Langlois, Taine, Augustin Thierry, Seignobos, Michelet, Marc Bloch, et aussi Pierre Bourdieu, Carlo Ginzburg, François Hartog, Paul Veyne, Claude Lanzmann etc.
En trois parties (« La grande séparation », « Le raisonnement historique », « Littérature et sciences sociales) de chacune quatre chapitres et d’environ 100 pages, l’auteur développe l’idée selon laquelle la pratique d’une écriture subjective assumée par l’historien est la meilleure méthode pou exposer des connaissances objectives. Cet essai est se situe dans la continuité de son livre précédent dont il théorise la méthode originale.
La grande séparation
C’est le titre de la première partie qui traite de la genèse, des étapes et des modalités du divorce entre l’histoire et la littérature. Depuis ses débuts l’histoire était quasiment confondue avec la littérature, au sein de ce qu’il est convenu d’appeler depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, « les Belles lettres », avant de s’en détacher au XIXe siècle pour naître en tant que science. Au XVIe et au XVIIe siècle, la « littérature » désigne la connaissance des lettres, c’est-à-dire l’ensemble des savoirs profanes, y compris les mathématiques. Puis elle devient l’érudition que procure la connaissance des grands textes, la fréquentation des Anciens, les orateurs, poètes et historiens. À l’étape suivante la « littérature » définit le corpus des textes eux-mêmes et l’on commence à appeler « écrivain » celui qui constitue la littérature : celui qui crée des oeuvres appelées à faire partie du corpus. Le centre de gravité de la littérature se déplace alors vers le roman.
Quelle place pour l’histoire entre les sciences et les lettres ?
A mesure que les sciences et les lettres se séparent, les sciences sont parées de toutes les vertus et l’histoire entend être considérée comme telle : comme les sciences elle a l’ambition de dire le vrai et de produire un savoir socialement utile. Bien qu’elle mette en valeur ses sciences auxiliaires que sont l’épigraphie, la numismatique, la sigillographie et qu’elle prétende incarner une « troisième culture », celle des « sciences de l’homme », elle risque d’être laminée entre les sciences et les lettres. La menace est double : elle vient de la littérature avec le succès du roman historique de Walter Scott puis les romans réalistes naturalistes ; elle vient de la science qui prétend affirmer son monopole dans l’accès à la vérité. L’histoire cherche alors à se professionnaliser et à fonder ses propres méthodes : l’historien est celui qui étudie les faits par une démarche scientifique. L’histoire se sépare donc de la littérature pour choisir le camp de la science et de l’objectivité. La naissance de la sociologie qui se prétend plus scientifique que l’histoire la renforce dans cette évolution. Triomphe alors ce que l’auteur appelle le « mode objectif » du scientisme. Pour garantir son objectivité l’historien cherche à se détacher de son objet d’étude « expulse » l’utilisation du « je », adopte un point de vue universel et construit un texte qui se veut logique, transparent, accessible à tous. L’historien prétend avoir « le monopole du réel, du sérieux, de la science, de la vérité, et laisser l’écrivain régner dans la littérature, l’art, l’imagination, la subjectivité ». L’historien ne saurait donc être un écrivain ; la rupture est consommée dans les années 1880.
L’histoire choisit les sciences et renie la littérature
L’auteur caractérise et stigmatise alors ce qu’il appelle la « naissance du non-texte » que l’historien considère comme une garantie de sa scientificité : introduction, utilisation du « nous » de majesté, citations, notes en bas de page et bibliographie. L’écriture doit être d’une absolue discrétion, le style aseptisé, le plan classique de manière à ne pas masquer la réalité considérée comme « objective ». L’historien renie la littérature, « l’adieu à la littérature a permis à l’histoire de conquérir son autonomie intellectuelle et institutionnelle ». Même si certains historiens continuent de fort bien écrire, Fernand Braudel et Georges Duby par exemple, mais d’autres aussi, la littérature fonctionne désormais comme un repoussoir à l’histoire. Craignant d’être considéré comme des littéraires, et donc comme des dilettantes, des générations d’historiens vont se censurer… pour le plus grand ennui du lecteur affirme Ivan Jablonka.
Le raisonnement historique
Le rejet par l’histoire de la littérature est qualifié par l’auteur d’« automutilation » et de reniement. Pour le démontrer il se propose, dans une seconde partie « d’isoler ce qui, intellectuellement, fonde l’histoire en tant que science sociale ».
Le raisonnement au cœur de la méthode historique
La valeur de l’histoire ne repose pas, selon l’auteur, sur l’étude de tel personnage, de tel phénomène ou de telle époque, mais dans « la qualité des questions que le chercheur se pose ». Le raisonnement historique est le coeur de l’histoire, et il propose cette définition : « faire de l’histoire en tant que science sociale, c’est essayer de comprendre ce que les hommes font ». L’histoire est une activité intellectuelle définie par une démarche, non par un sujet. « Il en découle que l’histoire (comme raisonnement) est présente dans des activités qui n’ont rien d’historique : le reportage, le journalisme, l’enquête judiciaire, la relation de voyage, le récit de vie ».
Les opérations constitutives du raisonnement historique
L’historien chercheur poursuit la vérité au moyen d’un raisonnement. Ce raisonnement est commun à toutes les sciences sociales et comprend plusieurs opérations auxquelles l’auteur consacre un chapitre (chapitre 7) afin de bien les distinguer : la distanciation, qui permet de poser un problème ; l’enquête qui a pour fonction de collecter des sources ; la comparaison, « qui dissipe l’illusion de l’unique » ; la formulation-destruction d’hypothèses grâce à des preuves. Il en résulte que « l‘histoire comme science sociale est un rationalisme critique qui consiste à répondre aux questions que l’on se pose » et que « faire des sciences sociales ne consiste donc pas à trouver la vérité, mais à dire du vrai, en construisant un raisonnement, en administrant la preuve, en formulant des énoncés dotés d’un maximum de solidité et de pertinence explicative ».
Les « fictions de méthode », outil dans le raisonnement
L’auteur aborde alors (chapitre 8) l’étude de ce qu’il appelle « les fictions de méthode ». Il ouvre son raisonnement par un exemple : « Le père Goriot fait comprendre la société du XIXe siècle non parce qu’il l’évoque avec réalisme ou vraisemblance, mais parce qu’il pose des questions à son sujet en projetant le lecteur dans la hiérarchie des fortunes, la logique de la vente, la violence des rapports sociaux. » Cet exemple permet de considérer la fiction, non comme une représentation mais comme un outil qui aide à connaître. Cette fiction de méthode est constitutive du raisonnement historique. Elle ne se réduit pas à l’imagination ; elle est plus conceptuelle et diffère de la fiction romanesque sur trois points : elle se présente comme telle ; elle a pour objectif d’expliquer le réel ; elle n’est ni ludique ni arbitraire mais elle est un outil dans le raisonnement. Poussée à l’extrême les fictions de méthode aboutissent à l’anachronisme maîtrisé et à l’uchronie. La fiction peut être constitutive de la narration historique : ainsi de la narration par symboles qui consistent à rassembler la totalité d’un phénomène, d’une période ou d’un événement dans un individu ou un objet jugé représentatif. Dans son ouvrage Á bord du négrier (2007) Marcus Rediker « recourt à une double focalisation sur l’objet (le navire négrier) et sur les hommes, acteurs et victimes de la traite » ce qui permet de dynamiser la narration.
« L’histoire est avant toute une manière de penser, une aventure intellectuelle qui a besoin d’imagination archivistique, d’originalité conceptuelle, d’audace explicative, d’inventivité narrative. Si l’on veut comprendre les actions des hommes, il faut mettre en oeuvre un raisonnement, c’est-à-dire recourir à des fictions de méthode, fictions contrôlées et explicites pour lesquelles il n’est pas besoin de suspendre volontairement l’incrédulité. À la fois activées et neutralisées par le raisonnement historique, maillon d’une démonstration, ces fictions concourent à la production de connaissances. » Il faut donc s’éloigner du réel par le détour des fictions de méthode pour mieux le connaître et le comprendre.
Littérature et sciences sociales
Le projet de l’auteur et de contribuer à inventer de nouvelles formes littéraires pour les sciences sociales, sans revenir à une époque où l’histoire n’était pas une discipline, mais en infléchissant les règles existantes : « Je pose la question : quelle écriture pour quelle connaissance ? Quel est le texte du savoir ? »
La littérature du réel
Il fait la constatation de l’existence d’un « point de contact entre littérature et sciences sociales, une zone d’interpénétration ou les appartenances sont indécidables » et il cherche à faire l’inventaire de ces « oeuvres inclassables » : des textes réflexifs sous la forme de témoignages autobiographiques ; des comptes-rendus d’enquête de terrain ; des anthropologies de la vie quotidienne ; des récits de voyages ; l’ensemble des écrits concentrationnaires. Il propose de rassembler ses écrits sous l’étiquette de « littérature du réel », littérature qui s’enracine dans le XXe siècle tout en étant l’héritière du roman réaliste. Aux États-Unis dans les années 1960 des écrivains ont fondé la littérature non fictionnelle (nonfiction novel) qui « magnifie une histoire vraie au moyen d’un savoir-faire romanesque » et dont l’inventeur est Truman Capote dans De sang-froid (1965), qui raconte un quadruple homicide dans le Kansas avec une trame de fond réelle et des dialogues inventés. Le nouveau journalisme en est assez proche dans ses méthodes et dans ses objectifs : sujet tiré du monde réel et non de l’esprit de l’écrivain ; recherche détaillée et références vérifiables, recherche du style dans la narration
Fiction, factuel et enquête
L’auteur en arrive à distinguer la fiction qui est un récit imaginaire construit par un auteur, le factuel qui est un récit informatif qui ne pose aucune question (un guide de voyage ou une dépêche par exemple) et l’enquête qui est un récit animé par un raisonnement. L’enquête englobe toutes les sciences sociales ainsi que la littérature du réel et la littérature non fictionnelle. L’existence d’une littérature du réel prouve que le critère essentiel de la littérarité n’est pas le fictionnel, ni le romanesque. Ce qui nécessite à cette étape du raisonnement de tenter une définition de la littérature et l’auteur propose la suivante : la littérature, c’est la forme (un texte qui manifeste une intention esthétique), l’imagination, la polysémie (elle autorise plusieurs interprétations), la singularité (« un texte littéraire c’est l’irruption d’un moi qui, par sa vision propre, bouleverse l’ordre des choses »), c’est enfin un ensemble de textes reconnus comme tels par une culture un enseignement et des institutions. Force est de constater que « jamais le raisonnement historique n’a empêché d’écrire, de construire une narration, de mener un travail sur la langue, ni même d’avoir une intention esthétique ».
Le style est compatible avec la méthode historique
Le respect de sa méthode n’empêche pas l’historien d’être aussi un écrivain. Parce qu’elle estimait que c’était un gage de rigueur scientifique, l’histoire universitaire du XIXe siècle « s’est faite le chantre du non-style ». Si le non-style, le style agréable et le style romantique sont incompatibles avec la méthode de l’historien, le style ironique, le style attique (sobre, clair, rationnel, concis) et le style retenu « sont capables de faire vivre un raisonnement historique dans un texte, c’est-à-dire de conjurer l’alternative entre une méthode sans littérature (non-style et style agréable) et une littérature sans méthode (style romantique) ».
Grandeur et décadence de la note de bas de page
La note de bas de page est devenue en histoire « le ticket d’entrée pour le temple de la science », avec une fonction pédagogique, déontologique, critique et même charismatique. L’auteur refuse de la considérer comme « l’alpha et l’oméga des sciences sociales ». On peut aussi considérer qu’elle défigure le texte et multiplie les excroissances et chercher à « en faire un outil littéraire en disséminant le récit dans plusieurs niveaux de notes reliées au texte : références, commentaires réflexifs, état de la question, discussions savantes ».
Inventer de nouvelles fictions de méthode
L’auteur plaide pour l’invention d’autres manières de raconter, de débattre, de renvoyer au hors-texte et en fourni plusieurs exemples, les plus « révolutionnaires » intégrant des dessins, des gravures, des pièces d’archives, des photos etc. De nouvelles fictions de méthode lui semblent nécessaires : raconter par exemple une histoire de manière régressive ; respecter les possibles qui s’ouvrent à un personnage ; inaugurer un récit avec plusieurs débuts mais sans lui donner de fin (et vice versa) etc. Il juge impératif de réhabiliter le plaisir du lecteur, son intérêt, sa curiosité, sa passion, autant dire des sciences sociales qui procurent du plaisir… et qui donne du plaisir au chercheur au cours de son travail.
Plaidoyer pour un historien qui expose sa personne et sa méthode et incarne son raisonnement dans un texte
Ivan Jablonka consacre l’avant-dernier chapitre à une réflexion fondée sur l’expérience de l’écriture de son livre, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Il plaide pour des ouvrages d’histoire, ou d’autres sciences sociales, qui racontent au lecteur la méthode que suit l’historien-auteur : une forme nouvelle qui tient à la fois de l’enquête, du témoignage, de l’autobiographie, du récit et qui met en oeuvre « un raisonnement qui, déployé dans un texte produit une émotion ». Le chercheur-historien doit renoncer aux modes objectifs, ne pas craindre le « je », admettre qu’il est présent dans son histoire. L’objectivité en histoire doit être considérée comme la description par l’auteur de sa position, préalable à la critique individuelle et collective de ses hypothèses. Il doit reconnaître et faire connaître qu’il est en contact direct avec son objet d’étude, qu’il appartient au monde qu’il décrit. Il doit exposer sa méthode, démythifier sa personne et désacraliser son discours. « En dévoilant la position biographique, familiale, académique, sociale, politique d’où il parle (avant d’indiquer le cheminement de son enquête), il organise les conditions de sa propre critique : c’est parce qu’il est doté d’un point de vue qu’un discours est critiquable, donc scientifique. » Il doit montrer au lecteur comment la connaissance se fabrique, consacrer une part de son récit à la recherche elle-même, c’est-à-dire à la manière dont il a raisonné, enquêté, douté. « Le coeur du livre ne serait plus le récit historique, mais le récit du raisonnement historique. » L’auteur défend une histoire qui passe du mode objectif au mode réflexif. « Le narrateur objectif sait tout et dispense de l’information à son gré ; le narrateur réflexif ne sait rien et construit un raisonnement (…) Le mode réflexif se fait littérature pour mieux raconter l’activité scientifique du chercheur. »
« L’histoire est d’autant plus scientifique qu’elle est littéraire. »
« En refusant d’identifier la littérature au roman et les sciences sociales au non-texte académique, en choisissant d’incarner un raisonnement dans un texte, on aboutit à une autre manière de faire des sciences sociales et à une autre manière de concevoir la littérature (…) Le paradigme de l’enquête permet de fédérer à la fois les sciences sociales et les récits qui ressortissent aujourd’hui à la littérature. Toutes ses formes sont capables de déployer un raisonnement dans un texte (…) Cela signifie que la littérature fait du bien aux sciences sociales et que les sciences sociales font du bien à la littérature (…) L’histoire est d’autant plus scientifique qu’elle est littéraire. »
« J’ai parlé, dans ce livre, de la rencontre entre sciences sociales et littérature. Il en faudrait un autre pour évoquer les arts visuels et le cinéma. Mais l’idée est là : non seulement oser des expériences nouvelles, mais projeter sur mille supports les outils d’intelligibilité que nos devanciers ont forgé et auxquelx nous tenons. Le temps viendra où il ne semblera plus loufoque d’incarner le raisonnement historique dans une exposition de photos, une bande dessinée, un jeu vidéo, une pièce de théâtre. À cet égard Internet est notre plus fidèles alliés (…) Á nous de réinventer notre métier. »