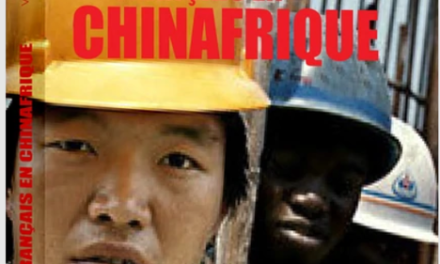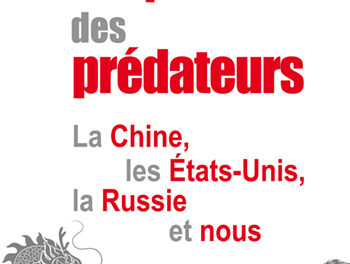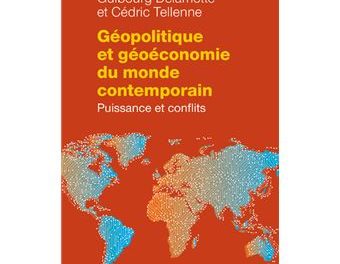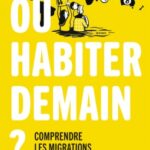L’Iran : Questions internationales, N° 25, mai – juin 2007.
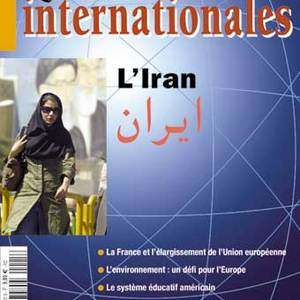
Avec ce numéro consacré à l’Iran, la revue Questions internationales publiée par la documentation française confirme l’excellente impression qu’elle avait donnée lors de ses précédentes parutions. Le titre qui semblait limiter son audience à des specialistes, familiers des grandes revues spécialisées comme foreign affairs, ou Politique internationale, destinées à un public très averti, a fait au contraire un autre choix éditorial. Tout en proposant des articles de très bon niveau, rédigé par des spécialistes reconnus, l’équipe éditoriale de Questions internationales a fait le choix de s’ouvrir à un lectorat d’enseignants et d’étudiants.
Certains numéros précédemment parus, comme celui sur le pétrole ou mondialisation et inégalités ont été largement utilisés dans l’enseignement secondaire par les professeurs mais aussi par leurs élèves. Certains centres de documentation se sont très rapidement abonnés à cette revue qui se caractérise également par un support cartographique d’excellente tenue. Autre caractéristique, et ce n’est pas dénué d’intérêt. Le prix au numéro (9,80 €) est particulièrement attractif.
Chaque numéro de la revue comporte un thème dominant, ici l’Iran, une partie consacrée aux questions européennes et à des regards sur le monde et à la fin des documents de référence. Originalité également, la revue comporte une rubrique internet, consacrée aux questions internationales avec une présentation de chaque site. Nul doute que les Clionautes et co-listiers d’H-Français, entre autres, sauront y trouver leur bonheur.
Ce N° 25 inaugure également une nouvelle rubrique, cette fois-ci consacrée au cinéma. C’est Serge Sur, professeur à Assas et rédacteur en chef de la revue qui ouvre le bal avec un article très dense, associant connaissance de la filmographie et des questions liées à la politique européenne, consacré au film de Cédric Klapish, les poupées russes ou un rêve d’Europe.
Point n’est besoin d’être spécialiste des questions internationales ou la géopolitique en effet, pour dévorer cette revue et spécifiquement ce numéro particulièrement riche. L’article de Yann Richard, professeur à Paris III situe l’Iran dans son contexte historique avec une évocation précise, et enrichie de cartes de l’histoire de l’Iran contemporain. Rare pays à échapper à la colonisation, l’Empire perse, qui était la puissance dominante de l’Asie Occidentale du VIè au IVè siècle avant de s’effondrer sous les coups d’Alexandre a su préserver son unité territoriale malgré les appétits de ses puissants voisins.
Un pays enjeu
Dès la fin du XIXe siècle en effet, les religieux chiites pèsent fortment dans le débat politique et s’opposent aux modernistes qui souhaitaient remettre en cause une monarchie absolue fortement inspirée par le modèle autocrate russe. Avec le XXe siècle, l’Iran devient un enjeu de la rivalité entre les grandes puissances. On apprendra notamment que les Russes, en 1911 exercent une pression directe sur le pays à propos de la présence d’un contrôleur financier américain. L’Empire ottoman exerçait déjà une influence de fait sur le Kurdistan iranien tandis que les Britanniques s’implantaient dans le Sud, champs pétrolifères obligent. Même les allemands s’implantent solidement en Perse centrale en 1915.
Cette histoire de l’Iran dans l’après première guerre mondiale est particulièrement intéressante. Incursions militaires, irruption de Reza Khan à la tête de son régiment cosaque, coup d’état et destitution de la dynastie Qadjare, fourniraient la trame d’un beau roman historique voire d’un film à grand spectacle. Il n’empêche que Reza Pahlavi Khan fonde une nouvelle dynastie de Shah, celle qui sera renversée avec son fils, en 1979 par les Ayatollahs chiites. Ce dernier cherche à imposer aux religieux des réformes modernistes très inspirées de la révolution kémaliste en Turquie. Il tenta, sans succès de lutter contre les prétentions de l’Anglo-Iranian Oil Company qui tirait des gisements iraniens plus de revenus que l’Iran lui-même. Ces appétits anglo-saxons ont amené Réza Pahlavi à se rapprocher de l’Allemagne nazie ce qui entraîne l’occupation anglo-russe de tout le pays en 1941.
Son fils, jeune prince jugé plus malléable, lui succède dès 1941.
L’article passe un peu vite par contre sur l’épisode de 1946, à propos du retrait des troupes soviétiques du Nord de l’Iran. Staline aurait bien voulu faire de la Caspienne un lac russe, tandis que les britanniques, soutenus par les Etats-Unis considéraient déjà le pays comme un élément essentiel de la stratégie de ce que l’on appellera par la suite le containment soviétique. L’article consacre, ce qui est normal, un large développement à la tentative de Mossadegh, premier ministre, de reprendre le contrôle des pétroles d’Iran aux britanniques et au coup d’état largement soutenu par Washington qui permet le retour du Shah au pouvoir.
La Révolution blanche
Ce dernier qui n’a plus rien à voir avec le jeune prince noceur de 1941, applique une politique de force contre les opposants, y compris les religieux, ce qui lui aliène de fait une partie considérable du pays. Les fastes de Persépolis pour le 2500e anniversaire de l’Empire perse, la folie dépensière liée au triplement des revenus du pays du fait du premier choc pétrolier attisent un mécontentement social que les religieux utilisent largement, inspirés par Khomeyni, l’Ayatollah Osma, ( Grand ayatollah réfugié un temps en Irak puis en France.)
La maladie du Shah, l’attitude très critique de Jimmy Carter précipitèrent la chute du régime et l’arrivée au pouvoir le 1er février 1979, de Khomeyni. La révolution islamique commence.
L’article de Azadeh Khan-Thiébaut, maître de conférence à Paris VIII explore les ressorts de la modernisation de ce pays, à différentes époques. L’Iran se différencie de ses voisins par l’irruption de mouvements populaires, 1906, 1952, 1979, contrairement à ses voisins où les changements sont liés à des coups d’état auxquels assistent en spectateurs les populations. Irak, Syrie.
La place spécifique de l’Iran, non arabe et chiite dans un environnement sunnite est également anlysée tout comme les spécificités de ce régime théocratique qui s’appuie sur un état fort.
Mohammed Reza Djalilli, professeur à l’IUHEI de Genève remet dans le contexte régional et mondial la place de l’Iran. Dans ce cas précis la place de l’Iran dans le Sud-Caucase fait l’objet d’un traitement riche d’enseignement pour percevoir les évolutions à venir de cette zone sensible. Le nucléaire iranien est l’objet d’un traitement particulier par Georges Le Guelte, de l’IRIS, tandis que Bernard Hourcade (CNRS) présente le fonctionnement de ce pouvoir iranien, qui n’est pas loin s’en faut totalement dominé par le remuant président Ahmadinedjad dont les dérapages verbaux défraient la chronique. L’économie est également abordée, et l’Iran qui bénéficie forcément de la hausse des cours du brut n’est pas forcément dans une très bonne situation, du fait de son absence d’ouverture économique et de la méfiance, compréhensible, des investisseurs internationaux. (Thierry Coville, CCI Paris). Ce dossier s’achève sur l’article de Faribah Adelkhah, (CERI-IEP Paris) consacré aux transformations de la société iranienne, la place des femmes et de la religion étant essentielles pour en cerner les évolutions.)
Le numéro 25 de la revue contient également, dans la partie consacrée aux questions européennes, des éléments sur la position française face à l’élargissement de l’Europe, qui ne devrait pas connaître, malgré des propos de campagne, de larges inflexions, et sur la politique environnementale à relier aux déclarations du dernier G8.
Enfin, pour ceux qui voudraient avoir une vision précise de leur avenir, les « réflexions sur le système éducatif aux Etats-Unis », de Véronique Gaultier, ( Université de Columbia) devraient les rassurer où les inquiéter, en cas de transposition dans l’hexagone de modèles d’outre atlantique.