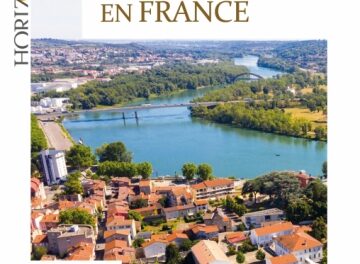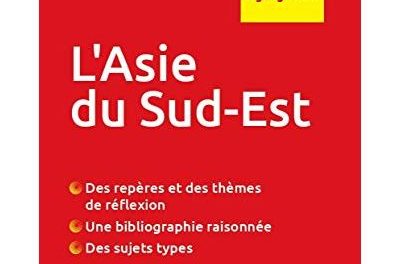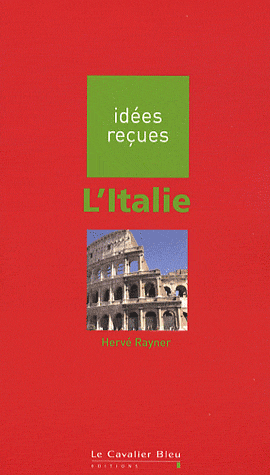 La collection « idées reçues » s’enrichit d’un nouveau volume, sur un pays au sujet duquel les préjugés abondent. Les premiers chapitres sur la beauté de l’Italie, Rome, la Renaissance, sont l’occasion de rappeler les grands traits de l’histoire italienne avec ses périodes de gloire mais aussi ses époques sombres. La réputation de l’Italie est aussi la conséquence d’évolutions récentes, de la diffusion de la pizza (on apprend que la Margherita doit son nom à la reine Marguerite de Savoie ; il aurait été donné en 1889 à l’occasion d’une visite au sud de la souveraine, par référence aux trois couleurs du drapeau que symbolisent le basilic, la mozzarella et la tomate) à l’affirmation de Milan comme capitale de la mode à partir des années 1970.
La collection « idées reçues » s’enrichit d’un nouveau volume, sur un pays au sujet duquel les préjugés abondent. Les premiers chapitres sur la beauté de l’Italie, Rome, la Renaissance, sont l’occasion de rappeler les grands traits de l’histoire italienne avec ses périodes de gloire mais aussi ses époques sombres. La réputation de l’Italie est aussi la conséquence d’évolutions récentes, de la diffusion de la pizza (on apprend que la Margherita doit son nom à la reine Marguerite de Savoie ; il aurait été donné en 1889 à l’occasion d’une visite au sud de la souveraine, par référence aux trois couleurs du drapeau que symbolisent le basilic, la mozzarella et la tomate) à l’affirmation de Milan comme capitale de la mode à partir des années 1970.
À mesure qu’on avance dans l’ouvrage, les questions traitées deviennent plus politiques et géographiques. L’analyse de la place tenue par la mamma est l’occasion de souligner le paradoxe démographique qui fait que l’Italie a un taux de fécondité de 1,4 enfant par femme alors même que le taux d’emploi (déclaré) des femmes demeure inférieur à la moyenne européenne (51%). Les écoles maternelles publiques ne furent créées qu’en 1968, les crèches municipales en 1971, les mesures natalistes demeurent limitées, les emplois sont extrêmement précaires et nombre de couples ne s’installent que très tard dans un logement propre, et n’ont en conséquence que peu ou pas d’enfants.
Voiture et calcio
Le chapitre sur l’automobile et les deux-roues, une passion italienne puisque les Italiens sont le peuple le plus motorisé d’Europe, rappelle le poids de la FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino), fondée en 1899, passée au bord de la faillite au début des années 2000, dans l’économie mais aussi dans l’identité nationale italienne. La récente entrée au capital de Chrysler par FIAT a été célébrée dans les journaux transalpins comme une victoire nationale.
Le chapitre sur le football est peut-être le meilleur du livre : le calcio est au coeur des préoccupations des Italiens et des Italiennes et l’attachement à un club est, comme en Angleterre, l’affaire d’une vie. Les passions qu’ils déchaînent en font un moyen d’affirmation politique – les victoires nationales et internationales du Milan AC ont beaucoup contribué à la popularité de son président, Silvio Berlusconi – et un objet de scandales, aussi bien dans les tribunes – des épisodes récents montrent que l’Italie peine à réprimer le racisme qui s’exprime dans ses tribunes, et à le considérer autrement que comme « folklorique » – que dans les coulisses. Le soutien apporté à l’équipe nationale apparaît comme une exception au localisme footballistique : l’auteur émet l’hypothèse que le comportement discipliné des azzuri en fait l’incarnation de l’idéal du bien public qui ne parvient pas à s’imposer ailleurs – et le tremblement de terre des Abruzzes est venu rappeler à quel point le non-respect des règles était la norme.
Église, fascisme et mafia
Longtemps omniprésente dans la vie sociale et politique de la péninsule, malgré les très fortes tensions avec les dirigeants italiens après l’unification et avant les accords du Latran en 1929, l’Église perd actuellement de l’influence et la déchristianisation progresse, comme en témoigne la véhémence des interventions politiques de certains prélats.
L’auteur est peut-être un peu bref lorsqu’il traite du rapport ambigu qu’entretiennent des parts importantes de l’opinion publique avec la période fasciste et de la guerre civile, que beaucoup préfèrent passer sous silence. Cette année encore, la célébration de la Libération de l’Italie le 25 avril a en effet donné lieu à divers débats, moins vifs peut-être que par le passé.
Les problèmes que rencontre le Sud italien sont en revanche traités de manière convaincante : depuis l’unification, ces régions ne se sont jamais développées en raison du conservatisme des élites. On aurait pourtant tort de parler d’un Sud éternel, dans la mesure où le développement des organisations mafieuses est lié à l’extension du suffrage mais aussi à l’insertion de ces régions dans une économie plus moderne, la mafia servant de lien entre les différentes parties. Le premier maxi-procès des chefs mafieux en 1986-87 a révélé la complexité extrême de l’organisation à l’époque et sa modernité ; l’opération « Mains propres » lancée en 1992 a entraîné la disparition de la Démocratie chrétienne, trop compromise, mais depuis la lutte antimafia semble marquer le pas, Silvio Berlusconi semblant plus inquiet du pouvoir des juges que de celui des mafieux. Le chapitre sur les années de plomb montre un autre exemple des collusions entre l’État et le crime, dont les formes demeurent toutefois floues à ce jour : il est très vraisemblable que les services secrets aient favorisé certains attentats pour discréditer les communistes, mais les enquêtes n’ont jamais été menées de manière satisfaisante, voire ont été sabotées. L’auteur souligne que si l’Italie réclame l’extradition des terroristes d’extrême-gauche comme Cesare Battisti, elle laisse en paix ceux d’extrême-droite, dont certains se trouvent dans la péninsule.
En conclusion, il est difficile de dire comment cet ouvrage peut être utilisé dans un cadre scolaire, sauf à faire lire un chapitre précis, mais il permet à ceux qui désirent se familiariser avec les principaux traits de la vie publique et sociale italienne de le faire rapidement et allègrement. On ne peut pas dire qu’il batte en brèche les idées reçues ; au contraire, il tend à montrer qu’elles sont en règle générale justifiées, mais qu’elles évoluent aussi au rythme des changements que connaît la péninsule. Il en est ainsi de l’idée selon laquelle les Italiens sont tous des voleurs, surtout au Sud, qui fut longtemps acceptée par tous, y compris par les Italiens : depuis que l’Italie est devenue un pays d’immigration, ces tares sont attribuées aux Roumains (et plus particulièrement, aux Roms), Albanais et Maghrébins, dont on pourrait dire qu’ils deviennent, souvent pour leur malheur, les Italiens des Italiens.