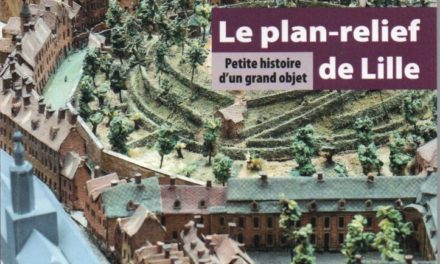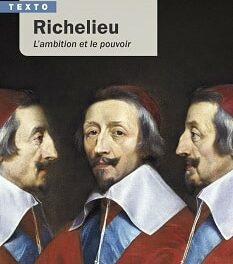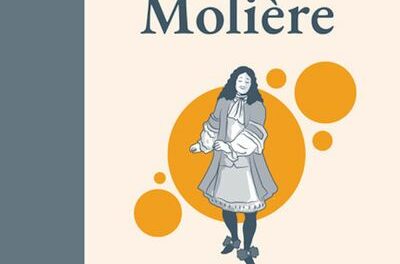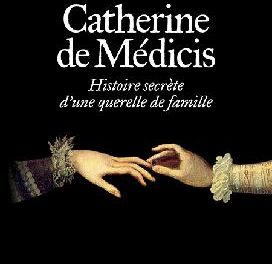Signalé pour la deuxième fois en quelques mois par la revue l’Histoire, le Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, société savante fondée en 1964, est régulièrement dépouillé par la Bibliographie annuelle d’histoire de France et par la Handbook of Latin American Studies (Library of Congress, Washington).
Le numéro d’avril 2015 montre l’étendue des champs d’investigation de cette revue savante avec une mise au point d’archéologie amérindienne des Antilles, des nouveautés sur une personnalité de la période révolutionnaire et l’étude minutieuse d’une sanglante « opération de maintien de l’ordre » de 1952 dont le bilan fut de 4 morts et 15 blessés dans la population d’une commune de Guadeloupe.
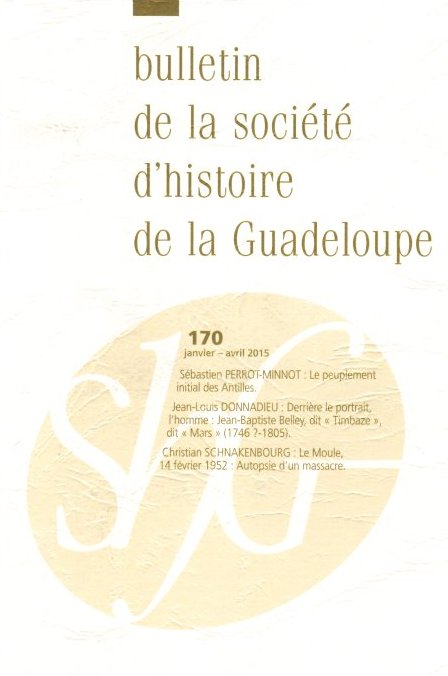
Yucatan ou Amérique du Sud ? D’où venaient donc les Amérindiens des Antilles ?
La contribution de Sébastien Perrot-MinotSébastien Perrot-Minot, « Le peuplement initial des Antilles », op. cit., p. 1-27., docteur en archéologie (Paris I) et enseignant à l’UAG, invite à un effort de familiarisation avec le découpage chronologique des archéologues. Elle permet malgré tout aux non-initiés de faire le point sur la question des origines des Amérindiens des Antilles. Parmi les questions posées figure celle du bouleversement social qui conduisit des groupes amérindiens continentaux à migrer vers les Antilles et à y établir de nouvelles organisations sociales il y a plus de 7000 ans. L’auteur questionne le problème de leur provenance, sachant que la route la plus courte, à partir du Yucatan, se révèle la plus dangereuse en raison des courants. La route la plus facile, à partir des côtes « vénézuéliennes », reste quant à elle la plus longue. La question porte aussi sur ce qui a pu décider ces hommes à partir vers des îles lointaines et invisibles depuis la terre. On oublie souvent ce fait quand on sait que, de chacune des petites Antilles, on peut apercevoir les îles riveraines qui s’égrènent le long de l’arc insulaire. L’article inclut plusieurs photographies d’industrie lithique, une carte, un tableau chronologique, un résumé et une bibliographie de près de 6 pages.
Jean-Baptiste Belley, le jacobin noir. Sénégalais ou Haïtien ?
Le numéro 166-167 du bulletin (2014) avait été remarqué pour une contribution renouvelant l’historiographie de Toussaint LouvertureJean-Louis Donnadieu, Philippe Girard, « Nouveaux documents sur la vie de Toussaint Louverture », op. cit., n° 166-167, avril 2014, p. 117-139.. 
Maintien de l’ordre en 1952 : 4 morts en Guadeloupe
Christian SchnakenbourgChristian Schnakenbourg, « Le Moule, 14 février 1952. Autopsie d’un massacre », op. cit., p. 55-81., économiste émérite de l’Université de Picardie et historien, est connu de longue date de l’historiographie guadeloupéenne pour ses nombreux travaux d’histoire économique et financière et pour sa récente thèse sur les migrants indiens de la GuadeloupeChristian Schnakenbourg, L’immigration indienne en Guadeloupe (1848-1923). Histoire d’un flux migratoire, Thèse d’histoire sous la direction de Philippe Mioche, U. Aix-en-Provence, 2005.. A soixante ans de distance, il s’attaque à un événement qui fait sans doute autant sens pour la mémoire locale qu’Amritsar (1919) ou Thiaroye (1944) sous d’autres cieux. Le souvenir en est particulièrement vivace chez les plus de 40 ans, au Moule, commune de Grande-Terre marquée par l’histoire des grèves sucrières. Peu de choses avaient été écrites de façon distanciée et c’est ce qu’entreprend Christian Schnakenbourg en faisant le point sur les sources et le contexte socio-politique du temps, marqué par la misère des ouvriers de la canne et l’importance de l’anticommunisme pour les autorités. L’événement est également replacé dans la série des manifestations réprimées par les armes dans la Guadeloupe du vingtième siècle, de 1900 à 1967. L’auteur a tenu compte des apports de certains témoins lors d’une récente conférence dans la commune du Moule. La minutieuse autopsie de l’événement est accompagnée d’une carte du bourg communalLes communes de Guadeloupe rassemblent plusieurs unités spatiales héritières des sections et habitations sucrières d’autrefois, groupées autour d’un bourg, seul à cette époque à être pourvu en noms de rues. et d’une liste précise des victimes. En son temps, le massacre du Moule devint un symbole de la violence coloniale dans une Guadeloupe départementalisée en 1946. L’auteur rappelle que les forces de l’ordre ouvrirent neuf fois le feu sur la population de 1900 à 1967, tuant à chaque fois entre trois à huit personnes. Les huit dernières victimes furent celles de mai 1967 (Mé 67) à Pointe-à-Pitre.