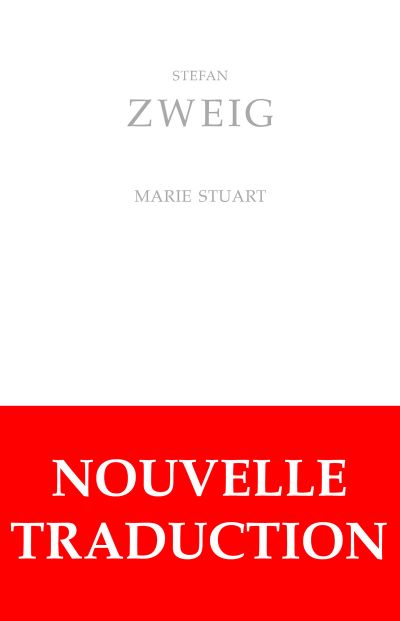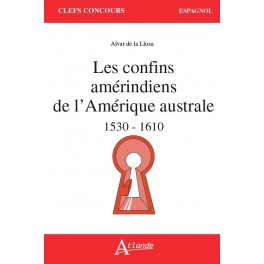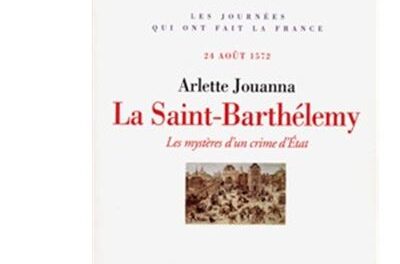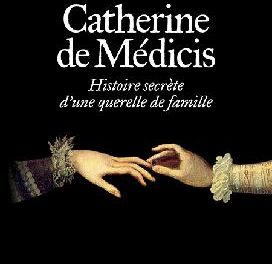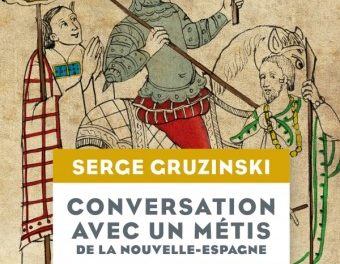Les éditions des Belles Lettres font paraître en ce début 2025 une nouvelle traduction de la biographie de Marie Stuart par Stefan Zweig. Largement commentées et étudiées, les biographies de Stefan Zweig sont à cheval entre l’étude historique et l’essai psychologique. En plongeant dans des figures riches et paradoxales de leur temps, Zweig souhaitait éclairer les problématiques de sa propre époque, comme le rappelle très justement la présentation de cette réédition.
Entamée en 2023 avec la parution d’une traduction nouvelle de Marie-Antoinette, la refonte de la bibliothèque allemande des Belles Lettres offre une nouvelle opportunité de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Zweig et son approche fortement teintée de psychologie. Une figure exaltée et passionnée, en contraste d’Elisabeth, une reine dont la vie regorge de témoignages et dont les ombres demeurent grandes pour autant, des éclairages historiques teintés de partialité (selon que vous soyez anglais ou écossais, catholique ou protestant, Marie est une sainte martyre ou condamnée aux tourments de l’enfer) : une figure qui brûle l’existence, Marie Stuart est cette « héroïne de fin du monde »Stefan Zweig, Marie Stuart, Belles Lettres, 2025, page 11, écho d’un monde qui prend fin en 1936 pour Zweig parti en exil.
Reine au berceau (1542–1548)
Venue au monde le 9 décembre 1542, Marie devient héritière du trône trois jours après suite à la mort de son père Jacques V qui eut un règne difficile face aux barons volontiers félons. Héritière de la couronne d’un « pays tragique, déchiré par de funestes passions »Ibid, p18, Stefan Zweig note combien la jeune reine est, dès ses premiers instants, un objet pour les puissances étrangères concurrentes, notamment l’Angleterre et la France qui se disputent la main de l’enfant pour les héritiers respectifs des deux couronnes. Pensée un temps comme futur reine d’Angleterre, Marie est finalement envoyée en terre catholique pour devenir la future reine de France. Elle vient tout juste d’avoir six ans.
La jeunesse en France (1548–1555)
Célébrée avec faste par les Valois à son arrivée en France, Marie va recevoir à la cour l’éducation nouvelle de la Renaissance mariant arts, lettres et activités sportives. Zweig dresse un portrait flatteur d’une princesse au charme simple, à l’inverse d’Elisabeth, dotée d’une prodigieuse beauté chantée par les aèdes de son temps. Une beauté qui dissimule le caractère fort en devenir « d’un être encore en sommeil »Ibid p33.
Mariée au dauphin François en 1558, ses droits la couronne anglaise sont mis en avant à la mort de Marie Tudor, à qui succède Elisabeth Tudor, cousine de Marie Stuart et fille d’Henri VIII et d’Anne Boleyn. Querelle dynastique et querelle de juristes à laquelle Marie répondra en prétendant, sans se montrer téméraire, être l’héritière en se faisant appeler reine d’Angleterre. Ce geste est lourd : ainsi elle « n’a rien obtenu et à tout compromis »Ibid p39, faisant d’Elisabeth sa plus farouche rivale et adversaire.
Reine, veuve et encore reine
Marie souffre, selon Zweig, du malheur d’une ascension brutale et si rapide qu’elle connaît « tout les triomphes possibles sans avoir eu le temps où le loisir de les assumer psychologiquement »Ibid p41.
Mais le deuil rattrape rapidement la jeune reine. Sa mère, Marie de Guise, décède en juin 1560. Le roi son époux suit le 6 décembre 1560. Si Zweig voit dans son deuil l’expression de noblesse de Marie, ses poèmes mettent en lumière la sincère tristesse de la perte d’un époux qui était un ami avec qui disparaît son pouvoir. Car Marie est désormais seconde, devant s’effacer derrière Catherine de Médicis. Le trait de caractère de Marie se dessine alors de plus en plus : l’orgueil impétueux qui la pousse à ne jamais se satisfaire de la seconde place.
Bien que souhaitant retarder son retour en Écosse pour réclamer sa couronne, Marie Stuart regagne sa patrie en 1561. Ce retour sera le théâtre de nouvelles tensions entre elle et Élisabeth sur la question de la couronne anglaise. Zweig déploie dans son analyse une interprétation et une lecture psychologique des deux reines qui nous apparaît aujourd’hui déplacée et relevant de biais misogynes : « en politique, Les femmes ont toujours cette dangereuse particularité de blesser leurs adversaires à coups d’épingle et d’aviver les conflits par des attaques personnelles.»Ibid p51.
Elles s’inscrivent pour autant dans les représentations habituelles de son temps et participent au style de l’auteur et de ses biographies psychologiques (ou psycho biographie). Désireuse de passer par l’Angleterre en geste amical, pour regagner l’Écosse, Marie demandait à Elisabeth un sauf-conduit. Document qui lui est refusé tant que cette dernière n’aura pas ratifié le traité d’Edimbourg, signé par le Parlement écossais, et reconnaissant Élisabeth comme la souveraine légitime du trône de la rose. Les échanges s’éternisent et sont marqués par Marie dont l’orgueil refuse d’apposer sa signature et de reconnaître la pleine légitimité de sa parente.
Retour en Écosse : août 1561
Marie pose le pied à Leith le 15 août 1561. Son arrivée misérable passe inaperçue aux habitants qui se réunissent par curiosité. Le fossé culturel entre les deux nations dont Marie est ou fut reine la marque au point de lui tirer des larmes. Gagnant le lendemain, sans faste ni pompe, le palais d’Holyrood, Marie fait face à une tâche immense. La voici reine d’un pays exsangue, en proie aux querelles des clans, aux trahisons de la noblesse, et depuis la Réforme, aux querelles religieuses. Marie fait face à une noblesse majoritairement acquise au calvinisme et trouvant des alliés en Angleterre auprès d’Elisabeth.
Mais Marie refuse de se convertir pour rétablir la paix : « Édimbourg ne vaut pas une messe ». La querelle gagne jusqu’à sa famille et son proche conseil : son demi-frère lord Murray est un défenseur farouche de la Kirk calviniste et occupe le poste de premier ministre auprès d’une reine farouchement catholique et qui le restera toujours en bonne fille des Guise.
Face aux envolées aux impulsions de Marie, son demi-frère se révèle calme et sûr de son influence et de son pouvoir. Celui qui a connu le tragique destin des bâtards royaux a su se hisser comme allié inamovible de Marie qui ne peut se passer de son parent protestant. Modéré, sachant se montrer ferme et décidé quand il le faut, Murray sait qu’il détient le vrai pouvoir et laisse sa sœur catholique donner la représentation d’un pouvoir qui ne tient que par le soutien calculé de sa parenté. Elle peut aussi s’appuyer sur Maitland son secrétaire d’État, habile diplomate qui suivra par intérêt la reine.
Marie devra affronter dès son arrivée en revanche le chef de la Kirk : John Knox qui est « peut-être le type le plus achevé du fanatique religieux que l’histoire ait connu. »Ibid p70. Avec lui aucune entente ou aucun compromis n’est possible. Les relations avec le puissant chef de la Kirk seront un combat permanent.
Le destin se met en marche (1561–1563)
Les premières années sur le trône d’Écosse se révèlent particulièrement calmes. Peu portée à la gestion quotidienne du royaume, Marie délègue à Murray et Maitland le soin d’administrer le pays. La reine préfère la joie des chasses et de la cour à la française qu’elle a recréée à Holyrood. Son orgueil la porte à se rêver reine d’une couronne bien plus prestigieuse que l’Écosse, elle qui fut célébrée au Louvre dès sa prime jeunesse. À 20 ans, Marie ambitionne beaucoup pour elle et porte peu d’intérêt à son peuple, à l’inverse de sa rivale Élisabeth.
Les relations entre les deux reines sont alors amicales. Une fausse proximité, chantée dans leur lettre, mais qui dissimule que bien mal la rivalité qui les lie et qui couve, s’installe. Chacune sait qu’elle devra, un jour, se défaire de l’autre. Mais elles sauvegardent la trêve installée entre Londres et Édimbourg.
Cependant, dans ce temps heureux et béni pour la reine Marie, le destin la rattrape selon Zweig : chaque inclination à son être profond se révélera funeste à partir de ce moment pour la reine. Le jeune Chastelard, troublé par la beauté et la geste de la reine, aura une imprudence qui le conduira à l’échafaud. Il sera le premier d’une longue liste d’hommes et de prétendants entraînés dans la chute par la bel et jeune Stuart : « Et, comme à chaque fois qu’elle cherche à briser, le temps d’un instant, ce carcan glacé qui étouffe la vraie vie qui bouillonne en elle, elle brise le destin d’un autre temps que le sien. »Ibid p93.
Le vaste marché matrimonial : 1563–1565
La rivalité entre les deux reines grandira au moment où la convoitise matrimoniale de toute l’Europe se porte sur les deux royaumes. Convoitées par les grands de ce monde, elles le dominent intellectuellement. Au-delà de leurs esprits vifs, les trajectoires des deux reines divergent complètement. Le destin favorable dont a bénéficié Marie lui a octroyé ce caractère posé et désinvolte qui la caractérise. Celle qui a réchappé à la mort et a obtenu par l’effort sa couronne garde en elle l’intime conviction de la fragilité du pouvoir et de la nécessité de le défendre. Marie représente l’héroïsme suranné d’une époque qui disparaît, Élisabeth représente le réalisme d’un monde dont l’aube point. 25 années d’intrigues de palais de tractation opposeront la reine du passé, appelée à régner dans les légendes, et la reine du monde à venir, couronnée par l’histoire.
Cette lutte habile entre les deux reines se focalise en ces années sur les projets de remariage de Marie. Veuve de François II, la voici courtisée par les plus grandes couronnes du continent, et notamment Don Carlos prétendant espagnol. Élisabeth ne peut accepter une telle union, qui placerait sa rivale à une plus haute place qu’elle. La reine vierge pousse alors et propose son amant éconduit, véritable affront que de proposer l’amant de sa rivale qui plus est un amant sans sang royal. Le ballet diplomatique perdure pour donner une issue inattendue : le retour en Écosse du comte de Lennox Henri Darnley, ennemi des Stuart mais de sang royal par les Tudor. En ses bras Marie connaîtra son éveil : le « prétendant venu rendre visite à Marie Stuart va découvrir en elle, de manière inattendue, une femme. »Ibid p117.
Second remariage (1565)
Tombée sous le charme du comte de Lennox, Marie se jette éperdument dans la quête qui pourra satisfaire le plaisir qui s’était éveillé en elle. Malgré les appels à la modération de sa famille (le comte de Lorraine), de ses conseillers (qui craignent de voir arriver un roi consort catholique) et les menaces d’Elisabeth, Marie n’en n’a cure : Marie épouse le comte de Lennox à Holyrood le 29 juillet 1565. L’union provoquera les foudres d’Elisabeth qui usera ainsi de « duplicité »Ibid p129.
Tout en gardant une apparente neutralité, cette dernière armera et soutiendra la rébellion des barons protestants écossais contre le jeune couple royal, portée par le protecteur du royaume lui-même Lord Murray. La rébellion est largement et rapidement défaite. Par sa détermination, Marie ramène dans le droit chemin les lords et pousse les chefs de la rébellion à l’exil, Murray trouvant refuge au sud auprès de la « très chère sœur » de Marie.
La nuit tragique de Holyrood (9 mars 1566)
Le mariage à peine consommé que la passion se transforme en aversion. Cette force qu’avait manifestée Marie, son entêtement à ne pas entendre les conseils de ses proches concernant Darnley, tout concourait à lui masquer la réalité : le nouveau roi est un homme faible et charmeur, à l’ego démesuré. L’élégant jeune homme cède le pas à l’homme vulgaire et sûr de lui. L’aversion pour ce mariage gagne la chambre à coucher et toutes les sphères publiques. Alors qu’il se rêvait en roi le voici rejeté par son épouse.
La reine trouve refuge dans les arts et accueille, dans son entourage, le ménestrel piémontais : David Riccio. Bien que de basse extraction, Riccio gagne rapidement la confiance de la reine et joue un rôle de plus en plus grand dans son action royale. Les barons ne goûtent que peu ces évolutions : le nouveau conseiller de Marie est un ultramontain et son influence peut faire basculer l’Écosse dans la Contre-Réforme. Il faut se défaire de son influence pour les lords protestants. Darnley voit également son épouse atteindre son orgueil et se refuser à lui. Il sera aisé pour les lords fêlons de convaincre le roi de participer au complot qui se ourdit contre son épouse.
La date est fixée au 9 mars 1566. Les comploteurs se préparent, l’Angleterre sait mais ne bouge pas. Le 9 mars aux soir Riccio est arrêté dans les appartements de la reine et tué, son corps lancé depuis le fenêtre dans la cour du château. Enceinte est retenue prisonnière, Marie ne peut le sauver. La nuit tragique du 9 mars fait de cette dernière une prisonnière en son propre palais, les comploteurs étant convaincus de leur victoire complète.
Les fêlons trahis : mars–juin 1566
Le meurtre de son serviteur va avoir l’effet d’une épiphanie sur Marie. La reine innocente presque naïve cède le pas à une souveraine résolue à faire payer à tous le prix de la trahison. Pour cela elle s’attaque au maillon le plus faible de la conjuration : son époux Darnley. En feignant de se montrer de nouveaux courtoise, presque soumise, Marie parvient aisément à le convaincre du bien-fondé de la laisser partir et d’organiser sa fuite. Cela est réalisé deux jours après le meurtre. Gagnant Édimbourg, Marie va feindre le pardon aux conjurés et nier la participation de son époux qu’elle sait coupable. Ainsi Marie retrouve la paix et relégitime son trône. Elle donne naissance le 9 juin 1566 à Jacques Stuart. La nouvelle parvient le 12 juin à Élisabeth, dévastée intérieurement mais maintenant les apparences.
Fatal enchaînement juillet à noël 1566
Aussitôt après avoir été utile pour ce relégitimer, Darnley est abandonné par Marie dont l’aversion ne cesse de grandir. Consciente que son époux a comploté, se reprochant d’avoir cédé si facilement à la passion pour un homme lâche, Marie fuit le roi consort pour ne pas avoir à accomplir ses devoirs conjugaux. Piqué au vif, ce dernier refuse de se laisser aller au plaisir de la chair avec une autre femme. Ce dernier menace de quitter le pays et Marie parvient encore, en feignant l’intérêt, à le maintenir à proximité et même à l’humilier en abordant publiquement son projet de fuite.
Darnley est utile encore le temps du baptême de son fils. Vaste fête auquel ce dernier n’assiste pas en signe de bravade. Mais Marie en a terminé avec lui : elle se réconcilie avec les anciens comploteurs qui reviennent alors à la cour. Le roi doit fuir, car il craint pour sa vie. Mais déjà Marie est de nouveau sombre, dévorée par la passion qui s’est réveillée en elle de nouveau.
Tragédie d’une passion 1566–1567
Cette passion nouvelle, qui l’amènera à tout perdre, c’est l’amour qu’elle porte à son proche conseiller et chef des armées d’Écosse : Bothwell. Pour lui Marie se compromettra grandement, notamment via l’affaire de la cassette ou les poèmes et lettres de la reine, adressés à Bothwell, seront retrouvés et utilisés par ses ennemis.
Si plusieurs partisans de Marie ont plaidé la falsification de ces écrits, Zweig défend la véracité desdits documents, témoignages la psychologie exaltée alors de la reine. Cette passion pour un homme, a contrario de ses précédents époux, plein de fougue, débute dans une relation violente que l’on peut aisément qualifier de viol. Ce feu dévorant provoque chez la reine une frénésie : ses proches découvrent avec une nouvelle force, infatigable et déterminée. Cette force s’accompagne d’une terrible crise d’abattement, d’une grande fatigue psychologique (apprenant que Bothwell a été lourdement blessé lors d’une partie de chasse, Marie le veille et est frappée à son tour d’une crise psychologique qui fait craindre pour sa propre survie).
Cette passion est d’autant plus funeste et tragique que Marie connaît déjà la conclusion : relation adultérine, condamnée à mort par sa propre loi, auprès d’un homme qui en plus ne l’aime pas et assouvi avec elle ses pulsions. Tragédie de la femme transie d’amour et prête à tout pour rendre cette passion réelle, malgré l’issue funeste qui viendra immanquable. La seule chose pouvant retenir son amant à ses côtés serait la perspective de la couronne. Intéressé, Bothwell fomente un complot pour se débarrasser du roi consort. Tous le veulent déjà « en dehors de la piste », Bothwell opte pour le faire le plus vite possible et sait que seule Marie pourra l’attirer assez loin de Glasgow pour le mettre à mort.
Le chemin du meurtre : 22 janvier–9 février 1567
Le trajet funeste de Marie la conduit à sa participation à la machination autour de la mort de Darnley. Le roi éconduit depuis des mois doit mourir pour permettre à Bothwell d’avoir le trône et demeurer ainsi auprès de Marie. Cette dernière connaît de forts scrupules, sachant qu’elle s’apprêtait à commettre l’irréparable. Mais guidée par sa passion pour son amant, elle continue de jouer son rôle dans le complot. Elle gagne le lit de Darnley, malade de la petite vérole, et le conduit vers Édimbourg. Le roi est ravi de cette évolution, s’imaginant de nouveau près de l’élue de son cœur. Marie joue, essaie de masquer son dédain, rédige une lettre à Bothwell qui sera lourde de conséquences.
Reconnaissant dans cette dernière son rôle dans le complot, mais rejetant sa responsabilité, Marie guide le roi à sacrifier vers Édimbourg. Mais aucune résidence à Holyrood ou Stirling : le roi consort est mené dans un coin sombre et dangereux de la ville : Kirk O’Field, loin de tout. Le complot entre dans sa phase finale. Le soir du 10 février 1567 tous les comploteurs quittent les lieux du crime pour assister à un mariage au palais d’Holyrood, et se fournir ainsi un alibi. Dans la nuit une explosion retentit : Darnley et son domestique sont retrouvés morts à côté de la maison.
Quos Deus perdere vult
Alors même que l’intérêt devrait pousser Marie a feindre le désarroi et la tristesse pour se dédouaner, aux yeux de tous, du crime qui vient d’avoir lieu, celle-ci adopte l’attitude la plus dommageable pour elle : l’indifférence. Marie fait part d’aucune tristesse à la mort de son époux et reprend ses activités dès le lendemain en écrivant à toutes les cours d’Europe pour expliquer l’attentat et éloigner toute suspicion. Mais personne n’est dupe : toutes les cours, toutes les maisons d’Écosse savent. Les noms des coupables sont d’ailleurs placardés partout : Bothwell et Balfour, son principal lieutenant, ont tué le roi.
Élisabeth incite Marie à agir « dans son propre intérêt » et le père de Darnley ne tarde pas à demander justice. Le silence est devenu intenable pour la reine et un procès doit se tenir. Mais Bothwell impose sa dictature militaire et malgré toutes les suppliques de ses proches, Marie ne peut et ne veut arrêter son amour. La parodie de procès qui s’ouvre l’acquitte et, triomphant, Bothwell réclame le trône pour lequel il ne cache point son attrait. L’abysse approche pour Marie.
La voie sans issue avril–juin 1567
Zweig dresse, sur cette période, un parallèle entre Marie Stuart et lady Macbeth : femmes joyeuses et énergiques devenues sombres et tourmentées et hagardes, une fois le crime réalisé. Shakespeare a peut-être entendu parler des récits de ces semaines et s’en inspire ? Toujours est-il que Marie Stuart se terre et s’agite, les cris du peuple qui réclame justice ne cesse de grandir. Et pourtant Marie dans la fuite en avant veut accélérer le mariage avec Bothwell. Pour Zweig cela ne peut s’expliquer que par une grossesse qui ferait éclater la faute de Marie et son infidélité sans mariage avec son amant. Le destin est scellé : seuls, de nuit, Bothwell et Marie Stuart se marient le 15 mai 1567. Aucun conseiller, lord ou ambassadeur est présent. Aucune fête populaire n’est organisée.
Marie a atteint son but mais perçoit désormais le néant qui l’entoure. Peu à peu on la quitte, les lords n’obéissent plus et préparent une attaque contre Bothwell. Marie ne peut se défaire de son amour, malgré la défaite inéluctable. Le rejoignant à Dunbar et regagnant avec l’armée de son époux Édimbourg, elle croise les troupes des lords à Camberry Hill. C’est ici que Marie acceptera de se séparer de Bothwell et de gagner, sous la surveillance des seigneurs, Édimbourg puis le château de Lochleven afin de s’éloigner de la couronne et la protéger du peuple réclamant la mort de la « putain ». Elle entre en captivité le 17 juin 1567.
La destitution été 1567
Retenue à Lochleven, Marie va devenir un sujet d’embarras pour les lords qui gardent une souveraine et ne savent que faire d’elle. La découverte de la cassette et de son contenu va apporter l’issue aux seigneurs : en reconnaissant de sa main sa participation dans le meurtre du roi consort et son adultère, Marie a fourni les preuves accablantes pour l’amener à renoncer à la couronne. Murray, qui avait fui le pays depuis la mort de Riccio, revient et gagne la prison de sa sœur pour l’amener à renoncer au trône pour son fils, et à lui demander spontanément d’assurer la régence.
Habilement il parvient à amener Marie à lui réclamer la régence et à signer les documents où elle abdique, passe la couronne à son fils Jacques (devenu Jacques VI) et à faire de Murray le régent. Par cela on évitera à Marie un procès public et la crainte de l’humiliation, voire du bûcher. Murray cependant ne pourra laisser Marie si proche de redevenir reine, et il organisera la lecture des lettres compromettantes au Parlement pour la perdre aux yeux du peuple.
Adieu la liberté : été 1567–été 1568
Au cours de ces mois de détention, Marie Stuart, éloignée de la capitale de son tumulte, mettra au monde le ou les enfants de Bothwell. On ne saura jamais ce qu’il advint de celui ou de ces derniers : naissance non viable ou cachée ? Il en demeure pas moins que Marie ne laisse aucune trace de cet accouchement dans ses écrits.
Retirée et éloignée de Bothwell, la reine se remet à espérer son retour sur le trône et au pouvoir. Elle use de ses charmes pour s’échapper de Lochleven et devra s’y reprendre alors à deux fois. La fougue qui la caractérise et l’énergie qui l’accompagne semblent avoir regagné la souveraine. Très rapidement les lords se rallient majoritairement à Marie. Le souvenir du régicide, il y a un an, est peu de chose face à l’autorité de la régence de Murray, de plus en plus contesté. Les deux camps s’arment et se rencontrent à Langside le 13 mai 1568. Défaite, Marie s’enfuit à bride abattue pour sauver sa vie. Le désespoir et la précipitation, fâcheuses conseillères, la poussent à se tourner alors vers sa « sœur » Élisabeth. Elle traverse la frontière pour se réfugier en Angleterre. À 25 ans sa vie vient de prendre un tournant décisif.
Une machination se trame 16 mai–28 juin 1568
Réfugiée en Angleterre, Marie devient un fardeau pour Élisabeth : celle qui voulait la chute de sa rivale l’a obtenu sans agir et la voici qui réclame l’asile ou du moins un droit de passage. Élisabeth et son conseiller Cecil vont alors tendre un lent piège à Marie pour justifier l’emprisonnement de cette dernière. Ceci n’étend pas concevable sans l’accord de l’intéressée (au sens où une reine ne peut être jugée par sa cousine à l’étranger ce qui nécessite qu’elle en vienne accepter un procès), la diplomatie et la duplicité anglaise vont peu à peu se resserrer sur Marie qui prend conscience d’être « quasiment » retenue. Lasse elle finira par accepter l’ouverture d’une « conférence » sur les troubles dans l’Écosse. Le piège vient de se refermer.
Le filet se resserre : juin 1568–janvier 1569
La trahison d’Elisabeth éclate à l’ouverture de la conférence : si les lords et Murray peuvent assister aux audiences et fournir les preuves, Marie ne peut s’y rendre. La farce judiciaire tourne néanmoins plusieurs fois à son avantage. Les lords ne veulent pas trop accabler Marie et incriminent davantage Bothwell malgré les lettres de la cassette. En effet Marie pourrait répondre par un bond qui stipulait que ces derniers connaissaient le projet d’assassinat du roi consort.
Mais Élisabeth ne peut se satisfaire d’une telle situation qui pourrait se retourner en faveur de Marie : elle intimide les juges et parvient à faire présenter les documents qui incriminent Marie.
Le procès vient de lui échapper et la princesse Stuart sait qu’elle va être retenue captive si ce n’est renvoyée en Écosse. Mais Élisabeth ne tranche pas. La captivité en Angleterre, légitimée par cette conférence, va durer et marquer le règne élisabéthain. Ce faisant elle va faire passer la reine d’Écosse, par l’injustice dont elle est l’objet, au rang de martyre.
Les années dans l’ombre 1569–1584
Les quinze années suivantes seront celles d’une longue et morne captivité pour Marie. De château en château, la reine prisonnière est transportée et retenue tel un fardeau qui pèse sur la reine vierge. Durant ces années Marie a maintenu une mini cours à ses côtés et entretient des liens avec les diplomates et les princes de son temps. Se satisfaisant pas de cette captivité, Marie s’agite en secret pour mener des entreprises afin de fuir et retrouver son trône : messages cachés et codés, délégations secrètes, Marie déploie une énergie continue mais qui ne peut aboutir. Si les deux reines sont de forces égales, Marie se bat seule et se heurte à toute la force d’un État. Et Marie joue toujours de malchance face à sa rivale. Elle continuera jusqu’à la fin, et malgré la « vanité de l’entreprise »Ibid p372de se battre.
L’ultime combat 1584–1585
Lasse, Marie perçoit, elle qui vieillit, combien il faut agir pour espérer sortir de sa prison. Elle se rapprochera de son fils dont elle a été séparée alors qu’il était tout enfant. Jacques est devenu presque adulte et a hérité du caractère rustre et calculateur de son père. Élevé par les ennemis de sa mère, il n’a que dédain pour elle mais accepte de se rapprocher de cette dernière si cela peut lui permettre de réaliser ses ambitions. Consciente du danger, Élisabeth mais à bas les projets de Marie et brise la relation qu’elle venait de reconstituer avec son fils. L’abattement de la reine écossaise cède la place à une haine qui appelle à la vengeance. Elle veut désormais frapper Élisabeth et en découdre définitivement. Les alliés proches des deux reines également appellent au sang. Le dénouement est proche.
Il faut en finir septembre 1585–août 1586
Le coup porté le premier sera fatal à l’une ou l’autre, et ce sont les ministres d’Elisabeth qui organiseront le piège pour faire chuter Marie. Pour cela un projet d’attentat sera monté pour attirer Marie et l’amener à se découvrir et se trahir en approuvant, par écrit, le projet visant à assassiner Elisabeth. Le complot de Babington, du nom du jeune catholique retenu pour porter cette mascarade à son insu, est magistralement mis en place et exécuté par les services de la reine anglaise. La correspondance de Marie est en effet lue et connue, rien n’échappe au ministre d’Elisabeth. Si Marie est retenue par ses plus proches pour ne pas se dévoiler par écrit, cette dernière se perdra définitivement par son imprudence. Piégée, elle voit son espoir disparaître définitivement.
Élisabeth contre Élisabeth août 1586–février 1587
Dans les mois qui suivent la révélation du complot, Élisabeth va entrer dans une profonde introspection et dans un doute tenace : que faire ? Laisser le procès se poursuivre bien évidemment, et Marie sera condamnée à mort, il ne peut en être autrement. Mais que faire ensuite ? Doit-elle lui donner sa grâce ou laisser la hache s’abattre ? Sa main tremble aux lourdes conséquences d’un tel acte pour l’instituton royale dans son ensemble : exécuter une reine ointe revient à la ramener à la justice terrestre et la redevable devant elle. Ce précédent ferait jurisprudence. Alors Élisabeth hésite, offre à Marie une porte de sortie si elle reconnaît ses torts par écrit. Mais Marie a l’orgueil chevillé ne craint pas de périr. Élisabeth finit par signer l’acte. L’exécution est inévitable, le bourreau est parti à Fotheringhay.
« En ma fin est mon commencement » 8 février 1587
Le 7 février le bourreau parvient au château et on annonce à Marie l’exécution prévue au lendemain matin. Aucun report ni aucune confession de lui sont permis. La reine accueille calmement la nouvelle et entend préparer sa mort pour faire d’elle une martyre. Marie a vécu en reine catholique et meurt en catholique. Elle passera la nuit à préparer ses dernières lettres et mettre en ordre ses affaires. On vient la chercher à huit heures pour être menée au billot. Là, après un dernier duel avec le pasteur et les lords protestants, Marie retire sa robe, enfile des gants rouges qui viennent compléter une chemise de même couleur, embrasse le billot et attend avec calme. Le bourreau frappera trois fois.
Le 24 mars 16103 Élisabeth s’éteindra. Les messagers partiront alors annoncer à Édimbourg la nouvelle. Le fils de Marie, Jacques VI, devient le nouveau roi d’Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Déplacée à Westminster, la dépouille de sa mère Marie rejoint sa « soeur » Élisabeth dans la nécropole royale. La haine entre ces deux cousines laisse place désormais au repos.
En ma fin est mon commencement.