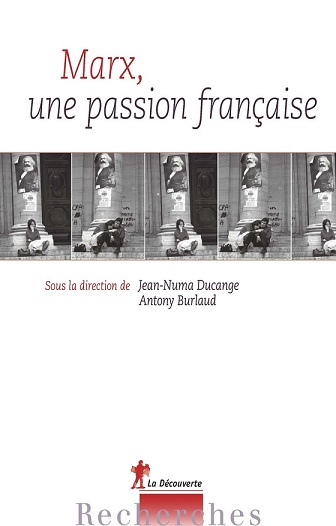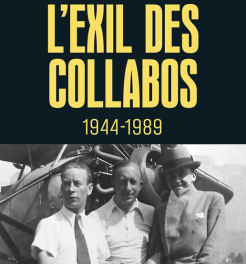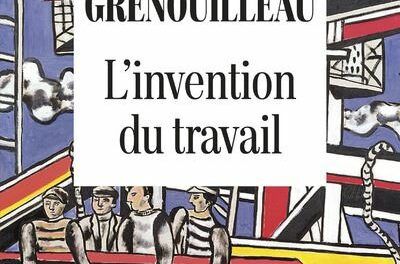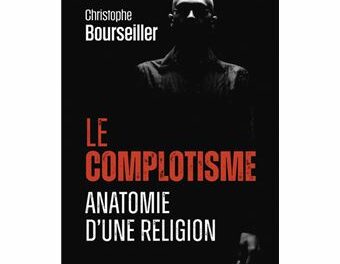Jean-Numa Decange est historien, maître de conférences à l’université de Rouen-Normandie (GRHIS). Codirecteur de la revue Actuel Marx (PUF), il est spécialiste de l’histoire des gauches françaises et germanophones. Il est notamment l’auteur de Jules Guesde. L’anti-Jaurès ?, Paris, Armand Colin, Nouvelles biographies historiques, 2017.
Antony Burlaud est ancien élève de l’ENS Ulm, doctorant en sciences politiques, spécialiste de l’histoire du socialisme.
Ils participent tous les deux à la GEME ( Grande Édition Marx-Engels en français).
Le bicentenaire de la naissance de Karl Marx (1818-1883) a été l’occasion de la parution ou de la réédition de nombreux ouvrages consacrés au penseur allemand. L’ambition quelque peu différente de ce livre est d’offrir un éclairage historique et sociologique sur la façon dont la pensée de Marx a été reçue en France, du XIXe siècle à nos jours. En effet la vie intellectuelle et de façon plus générale, l’histoire de notre pays, ont été fortement et durablement marquées par les travaux de Karl Marx.
L’ouvrage souhaite proposer une approche globale de la réception de Marx en France en rassemblant des contributions de chercheurs de différentes disciplines : l’histoire, la sociologie, les sciences politiques mais aussi la philosophie.
Cette histoire des marxismes, qui s’inscrit résolument du côté de l’histoire intellectuelle, propose d’étudier le marxisme des organisations politiques, puis sa dimension textuelle et éditoriale, son influence dans les sciences sociales, l’hybridation intellectuelle du marxisme avec d’autres traditions théoriques. Enfin, l’ouvrage aborde le marxisme par ses marges, géographiques ou par le regard d’individus ou groupes non marxistes.
La trajectoire des marxismes en France est analysée dans ses grandes étapes essentielles. La fin du XIXe et le début du XXe siècles sont des décennies d’acclimatation du marxisme en France. La révolution d’Octobre 1917 le fait ensuite entrer dans une phase nouvelle avec la naissance et l’affirmation du Parti Communiste Français (PCF). Dans l’après-guerre, le marxisme français connaît son apogée, avant de perdre sa centralité dans les années 70 et de subir un reflux, ses « années d’hiver ». La fin des années 2000 semble toutefois marquer une certaine forme de regain pour Marx et ses idées.
Comme le rappelle utilement le prologue, Marx a entretenu un relation forte avec la France. Elle a bien sûr été par son histoire (Révolution française, 1848 ; la Commune…) et ses expériences politiques ( Second Empire, IIIe République) une source d’inspiration. Elle a aussi été un lieu d’asile, un pays de mission, mais aussi parfois, un repoussoir.
La première partie est consacrée au marxisme des organisations politiques, en accordant une large place aux Marx des socialistes, puis à celui des communistes, mais aussi à celui des formations d’extrême-gauche.
A la fin du XIXe siècle, l’oeuvre et la pensée de Marx ne sont ni centrales ni incontournables au sein du socialisme français, fortement marqué par la tradition républicaine. Si le « duel » Jaurès-Guesde ne résume pas à lui seul les rapports des socialistes français avec le marxisme, beaucoup de socialistes réformistes restent critiques vis-vis vis du marxisme. Au sein de la S.F.I.O (Section Française de l’Internationale Ouvrière), créée en 1905, il existe des écarts importants entre la théorie et la rhétorique marxistes qui restent fondamentales et la pratique, beaucoup plus réformiste. La synthèse réalisée par Jaurès est celle de la tradition française du républicanisme avec le marxisme, dans un parti qui connaît une forme d’aversion pour le débat théorique. Avec la Première guerre mondiale et l’assassinat de Jaurès, l’internationalisme marxien de la SFIO fait long feu et les socialistes rejoignent l’Union sacrée.
La question de la commémoration par les socialistes du centenaire de la naissance de Marx, en mai 1918, provoque un tollé dans dans la majorité de la presse française, à droite en particulier. Elle est finalement célébrée assez timidement dans la presse du parti (L’Humanité et le Populaire) et dans les sections du parti. La vigueur des attaques contre les socialistes finit d’ailleurs par les conforter dans leur choix de quitter la majorité gouvernementale.
Dans les années 1920 et 1930, la référence au marxisme devient une sorte de marqueur identitaire face aux bolchéviques mais aussi face à la droite du parti (les néo-socialistes de Marcel Déat). Cette dénonciation de l’hérésie bolchévique devient évidemment moins virulente avec le Front populaire. Les études réalisées dans les années 1930 chez les dirigeants et militants de la SFIO montrent que la venue au socialisme ne s’explique que rarement par la lecture de l’œuvre de Marx. Le marxisme est un élément certes important de la culture socialiste, mais secondaire, auquel beaucoup de militants accèdent par la lecture de brochures de vulgarisation, la plus célèbre étant celle de Gabriel Deville, publiée en 1883.
La SFIO de Guy Mollet continue de laisser une place centrale dans son discours aux références marxistes, mais ce marxisme socialiste perd de plus en plus de son attrait. Une remise en cause du marxisme s’effectue dans les années 1960 aux marges de la SFIO avec par exemple la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) ou les clubs Jean Moulin. Après 1968, on assiste à un retour à Marx au sein du nouveau Parti socialiste (avec le CERES par exemple), en particulier dans le contexte du programme commun. Après l’élection de François Mitterrand, la référence au marxisme décline fortement et finit par disparaître à la fin des années 1990. Marx n’a plus aujourd’hui sa place dans les débats au sein du PS.
Si Marx n’est pas un enjeu essentiel du congrès de Tours de 1920 au sein de la SFIC ( Section Française de l’Internationale Communiste) puis du PCF, le marxisme devient vite un marqueur de gauche. Pour les 50 ans de la mort de Marx, en 1933, le PCF s’érige en seul héritier légitime du marxisme. Il s’agit de diffuser et d’étudier dans les écoles du parti un marxisme passé au filtre du léninisme, avant que ne s’impose ensuite la doxa stalinienne. Avec la Guerre froide, le marxisme devient un outil de combat politique (revue La Nouvelle Critique) mais ce retour à Marx reste limité, bien qu’il retrouve une actualité après 1956 chez les intellectuels communistes. Après cette date, le PCF contribue à une diffusion importante des textes et idées de Marx dans la société française, notamment grâce à son réseau d’école de formation. Critiquée par certains intellectuels, la diffusion de ce « marxisme vulgaire » se fait à une échelle alors inédite. Dans les années 1960, le PCF connaît un aggiornamento qui passe notamment par un retour aux textes de Marx et l’ouverture de nouveaux débats théoriques (avec par exemple la revue La Pensée ou plus tard Les cahiers marxistes léninistes) qui cherchent à rénover le marxisme. Cette aggiornamento aboutit à une mise au point doctrinale complète lors du comité central d’Argenteuil en 1966. Après mai 1968, le PCF cherche de nouvelles alliances et tente de renouveler sa doctrine en reprenant certains concepts de Gramsci. En 1976, Georges Marchais abandonne officiellement la dictature du prolétariat. Les années 1980 sont celles des adieux au marxisme-léninisme ce qui n’empêche, pas malgré tout, l’existence de lectures plurielles de Marx ( revue Actuel Marx). Robert Hue abandonne dans les années 1990 toute référence au marxisme. Depuis 2008 on assiste cependant à une forme de renouveau marxien dans les débats du PCF qui se traduit notamment par une soif de formation au sein de la jeunesse communiste.
A l’extrême-gauche, le trotskisme à partir de la fin des années 1920 et le maoïsme dans les années 1960 critiquent le modèle soviétique du PCF. Ces deux mouvements ont un apport non négligeable à l’histoire du marxisme. Leur faible implantation structurelle, leur absence de clientèle électorale et leur fort ancrage en milieu étudiant et à l’Université ont renforcé leur tropisme théoricien et favorisé une connaissance érudite du marxisme. Cette tradition s’est poursuivie jusqu’aux débuts du XXIe siècle, avec par exemple les travaux de Daniel Bensaïd.
Dans une seconde partie de l’ouvrage, plusieurs contributions abordent la question de la traduction et de l’édition de Marx en français. La traduction des œuvres de Marx est en effet un enjeu majeur. Le livre I du Capital a bénéficié d’une traduction par Joseph Roy (1872-1875), relue et corrigée par Karl Marx. Ce n’est pas le cas des autres ouvrages qui composent l’énorme corpus d’écrits. La traduction de Marx revêt en effet un enjeu théorique, ses textes étant saturés par de nombreux concepts hérités de la philosophie classique allemande. Traduire Marx est aussi source de débats, Louis Althusser n’hésitant pas à retraduire un passage de la postface de la 2ème édition allemande du Capital. Aujourd’hui encore, avec les travaux de la GEME (Grande Édition Marx Engels), la question de la traduction de Marx reste ouverte.
L’édition des textes de Marx et Engels dans les années 1930 se fait sous la houlette du Komintern. Le PCF se montre particulièrement intéressé par la diffusion de brochures de vulgarisation pour ses militants, notamment par le biais de ses Éditions Sociales. En effet, jusqu’aux années 1950 les œuvres du penseur allemand n’ont qu’un faible poids dans l’édition française. A partir des années 1960, Marx devient une référence intellectuelle majeure, notamment au sein de l’Université. Le nombre d’exemplaires et d’éditions augmente fortement. Les œuvres de Marx sont même éditées dans la prestigieuse collection La Pléiade chez Gallimard grâce aux travaux de Maximilien Rubel . Publiés dans les années 1960, les Oeuvres connaissent un succès commercial. Les décennies 60 et 70 sont celles de l’âge d’or éditorial du marxisme avec par exemple les éditeurs Maspero ou Anthropos. La fin des années 1970 est cependant marquée par un reflux de l’édition de Marx.
Dans sa troisième partie, l’ouvrage aborde la place de Marx au sein des sciences sociales françaises . Dans les années 1930, Marx s’impose comme une figure cardinale de la pensée rationaliste française et les intellectuels proches du PCF sont invités à développer un « marxisme à la française » et à montrer la filiation de Marx avec les penseurs rationalistes français (Descartes, A. Comte…). D’autres opèrent une nouvelle lecture des rapports entre le marxisme et le « père » de la sociologie française, Émile Durkheim. Un dialogue fécond s’ouvre aussi avec l’école des Annales. Après la Seconde guerre mondiale, la science sociale marxiste ne retrouve pas le même élan ni la même place, elle est de plus en plus marginalisée.
Dans les sciences économiques, le marxisme connaît un destin singulier. Ce sont dans les universités de droit de Paris (où sont enseignées les sciences économiques) dans les années 1950, que plusieurs professeurs introduisent le marxisme dans leurs cours. Cette école de pensée, qui met en exergue le Marx humaniste, plus que le révolutionnaire, devient ensuite de plus en plus importante. Plusieurs pôles contribuent dans les années 1 60 à diffuser plus largement le marxisme en économie dans le champ universitaire. A la fin des années 1970, la visibilité du marxisme s’érode et connaît un reflux, notamment face à l’offensive néolibérale.
En sociologie, dans un paysage français longtemps dominé par la figure de Durkheim, le marxisme connaît d’abord une place marginale, malgré les travaux d’intellectuels comme Henri Lefebvre ou Georges Gurvitch. Si le marxisme occupe une place centrale dans le paysage intellectuel, dans les années 1960 la sociologie subit la forte attraction de Raymond Aron. Dans les années 1970, le marxisme s’effondre. Les travaux de Pierre Bourdieu, qui s’inscrit dans la pensée critique mais qui ne se réclame pas du marxisme, ne peuvent inverser cette tendance.
Chez les historiens, les idées de Marx sont passées d’une influence quasi nulle au XIXème siècle à une très large audience. Cette influence se retrouve dans la lecture de la Révolution française par Jaurès, Aulard, Mathiez, Soboul… L’école des Annales de Lucien Febvre et Marc Bloch entretient elle aussi une grande proximité avec le marxisme, tout en conservant une distance critique. On retrouve bien entendu cette influence essentielle chez Fernand Braudel mais surtout chez Ernest Labrousse dont le modèle d’histoire économique et sociale est conçu comme une hiérarchie de l’économique, du social et du mental. Toute une génération de jeunes historiens français proches du PCF dans les années 1950, domine alors la scène historique (Chambaz , Furet, Richet, Le Roy Ladurie…) et l’histoire marxisante commence à dépasser l’économie pour prendre en compte les « superstructures », c’est à dire le domaine des mentalités. On retrouve cette évolution chez Georges Duby, Michel Vovelle qui passent de l’étude de l’économique, puis celle du social, pour aboutir à celle de l’imaginaire. En histoire antique, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet ou Pierre Lévêque renouvellent la discipline en pratiquant une approche globalisante de l’histoire et en défendant un marxisme ouvert. Avec l’effondrement du communisme, le contexte change, les historiens « prennent les acteurs aux sérieux », remettent en question les déterminismes explicatifs et réévaluent les phénomènes contingents. On assiste ainsi dans les années 1980 au retour en force de la biographie.
Enfin, la question du marxisme et de son influence n’est pas absente d’un champ intellectuel comme celui de la critique littéraire.
Dans sa quatrième partie, l’ouvrage aborde les « hybridations théoriques », c’est à dire le « croisement » du marxisme avec d’autres influences théoriques. Une contribution analyse ainsi le rapport ambigu et complexe entretenu par Marx et les marxistes français avec les Lumières et la Révolution française. Un autre texte traite du projet qui, à la Libération, et pendant près de 20 ans, a tenté d’articuler le marxisme et la phénoménologie. La question des rapports entre marxisme et structuralisme est aussi largement étudiée. Les travaux de Louis Althusser, intellectuel d’abord très proche du PCF, sont au coeur de cette tentative de concilier marxisme et structuralisme. Ce dernier est accusé de maoïsme par les organes intellectuels du PCF et rejeté vers l’hétérodoxie.
La pensée et les écrits de Marx ont également eu une influence importante chez les avants-gardes, c’est à dire principalement en France le surréalisme, et l’Internationale Situationniste (I.S). Les surréalistes associent la formule « transformer le monde » de Marx au « changer la vie » de Rimbaud, avant de s’éloigner du PCF. Les travaux de Guy Debord et de l’I.S sont eux aussi marqués par la lecture de Marx.
Une contribution tente de nuancer l’idée généralement admise comme un postulat, d’un effondrement du marxisme dans les discours des intellectuels à la fin des années 1970. Cette crise, liée au contexte historique, s’explique notamment par les attaques des « Nouveaux philosophes » qui associent le totalitarisme stalinien au marxisme. Le mouvement de concentration dans l’édition explique aussi le reflux du nombre de publications marxistes. Dans l’Université, l’allégeance au marxisme devient souvent un stigmate professionnel, qui se paye par un ralentissement dans l’évolution des carrières pour certains professeurs. Le marxisme n’est cependant pas « mort » et de nouveaux champs de réflexion apparaissent. La revue Actuel Marx est ainsi créée en 1987 et la fin des années 1990 est marquée par un renouveau dans l’édition contestataire ( Agone, La Fabrique..) et le succès d’intellectuels comme Slavoj Zizek, Antonio Negri, Alain Badiou…
Une contribution retrace les liens conflictuels entre le marxisme et le féminisme avec, au cœur du conflit, la question de l’autonomie des femmes. Les tentatives des féministes socialistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle pour imposer leurs revendications n’ont que peu d’impact. Dans les années 1920, la naissance du PCF change la donne mais celui-ci, qui défend l’égalité des sexes, ne cesse de dénigrer les mouvements féministes, considérés comme bourgeois. Avec le Front Populaire, l’attitude du PCF change et celui-ci crée de nombreuses organisations satellites de masse destinées aux femmes (l’Union des Femmes Françaises). Dans les années 1960, les mouvements féministes se radicalisent. Au sein du MLF (Mouvement de Libération des Femmes), dans les années 1970, au moins deux tendances se réclament du marxisme. Dans les années 2000, de nouveaux paradigmes apparaissent avec la prise en compte des travaux de Judith Butter et de la question du genre (mouvement LGBT). Aujourd’hui encore, un nouveau courant marxiste et féministe dénonce les modes d’exploitation économique, le consumérisme et les inégalités Nord/Sud.
Enfin, une dernière partie du livre aborde le marxisme français par ses marges ou ses dehors. Il s’agit d’abord de voir comment le marxisme a été « découvert » et analysé dans un premier temps en France par des économistes libéraux ou d’autres,proches du « socialisme de la chaire » (des universitaires qui souhaitent l’intégration de la classe ouvrière à la nation pour éviter toute tentation révolutionnaire). Une autre contribution passionnante traite d’un des plus fins et grands connaisseurs du marxisme, Raymond Aron. Le grand penseur libéral a toujours entretenu un dialogue très suivi avec l’oeuvre de Marx. Certes très critique vis à vis des conclusions de Marx ou de son prophétisme, classé dans le camp anticommuniste en raison de son rejet du totalitarisme, Aron était aussi capable de reconnaître la part de vérité de Marx. On comprend ainsi mieux pourquoi il était parfois qualifié de « marxiste de droite ».
Les rapports complexes du marxisme avec le catholicisme français des années 1930 à 1968 sont également étudiés. Le marxisme, dans sa version humanistes, a eu une influence indéniable sur la pensée de certains intellectuels français catholiques (Jacques Maritain). Le dialogue marxisme/catholicisme connaît son apogée à la Libération, en lien avec le modèle de l’Action catholique. Si le progressisme chrétien connaît une crise dans les années 1950, l’on retrouve jusqu’en 1968 des auteurs catholiques et protestants qui participent d’une certaine forme d’un gauchisme chrétien. A la fin des années 1970 la référence catholique à Marx retombe.
Pour finir, deux contributions s’intéressent aux marges géographiques. L’une étudie la réception de Marx dans l’Afrique francophone. Cette réception est inséparable de celle de Marx en France. Elle est rendue encore plus complexe par la question coloniale et par l’absence de véritable classe ouvrière en Afrique. Le dernier texte de l’ouvrage est consacré à la venue de jeunes étudiants chinois en France dans les années 1920-1925 dans le cadre du programme « Etudes-Travail ». Certains deviennent communistes et seront appelés aux plus grandes responsabilités dans leur pays (Zhou Enlai, Deng Xiaoping…). S’ils repartent de France avec des rudiments de la pensée marxiste, beaucoup sont convaincus que le redressement de leur pays passera par la création en Chine d’un parti communiste sur le modèle soviétique.
La lecture de cet ouvrage dense et riche, permet d’avoir une idée précise et fine des formes complexes de la réception de l’œuvre de Marx en France. Les nombreuses contributions qui composent cet ouvrage, par la variété des thèmes abordés et la pluralité des disciplines mobilisées, lui permettent de reconstituer de façon très convaincante la trajectoire des marxismes en France. Si l’historien portera naturellement une attention particulière aux contributions qui relèvent de synthèses générales sur la réception politique de Marx, ou celles qui abordent le rapport des historiens français au marxisme, les esprits curieux liront avec profit toutes les autres contributions, notamment les études de cas.
Cet ouvrage passionnant vient donc combler un manque historiographique, puisque une histoire globale des rapports de Marx et du marxisme avec la France, des origines à nos jours, n’avait jamais été vraiment tentée.
Il nous permet ainsi de mieux comprendre, pour reprendre les propos de ses deux directeurs, pourquoi « le spectre de Marx n’a pas fini de hanter la France ».