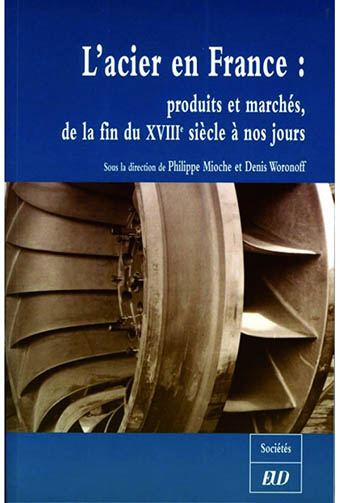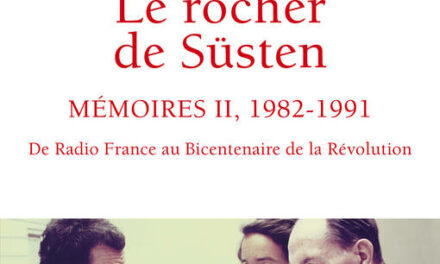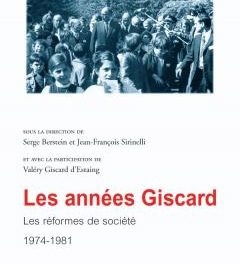Le succès récent de l’ouvrage qu’Erik Orsenna[1] a consacré au coton montre bien tout l’intérêt d’une démarche qui, tout en braquant résolument la focale sur un produit banal en apparence, permet de convoquer les questions les plus brûlantes. Bien sûr le Voyage aux pays du coton d’Orsenna est d’abord un récit littéraire, tandis que L’acier en France relève d’une catégorie plus austère et parfois injustement méconnue, celle de l’histoire économique.
Cet ouvrage collectif réunit les contributions croisées d’une vingtaine d’auteurs qui ont été choisis pour permettre de confronter des approches d’historiens ou d’économistes, mais aussi, ce qui est moins attendu, celles d’autres catégories d’acteurs : professionnels de l’acier avec des responsables commerciaux ou des ingénieurs, conservateurs du patrimoine … Ce petit volume offre donc un panorama très complet de l’histoire en longue durée de l’acier, que l’on peut ainsi suivre des débuts de l’industrialisation jusqu’aux bouleversements économiques les plus contemporains, à la veille du rachat du sidérurgiste européen Arcelor par l’indien Mittal.
La force de l’ouvrage tient d’abord au parti pris initial. On connaissait en effet assez bien les manières de produire. Elles ont été longtemps envisagées à travers l’étude des techniques ou des entreprises qui les mettent en œuvre. On connaît plus mal (ou de manière approximative) les produits et les marchés de l’acier. Les produits, parce que la dénomination « acier » a longtemps été très floue (on lira ainsi avec délice une recette de trempe de l’acier, donnée en 1884 pour des forgerons, qui inclue 100 gr de cendre de semelle de vieux soulier et 500 gr de suie de bœuf) sans que l’on sache toujours ce qui se cache, entre fonte et fer, sous cette appellation. Les marchés, alors que c’est pourtant à travers eux que s’élaborent les qualités, les normes et les prix dans un affrontement sans cesse renouvelé avec les autres matériaux. Démarche remontante donc puisqu’il s’agit de partir de l’aval plutôt que de l’amont
Les contributions sont regroupées en quatre grandes parties dessinant ainsi une double trame à la fois chronologique et thématique.
Définitions et usages
La première partie permet de suivre l’étonnante variation des conceptions et des dénominations au XIX°. Des errements de Lavoisier, à la fin XVIII°, jusqu’aux débuts de la métallurgie scientifique issue de l’analyse thermique des aciers vers 1895, nous sommes à une époque où, malgré les progrès pratiques (acier puddlé puis acier Bessemer), les industriels font de l’acier mais ils ne savent quel acier ils font. S’agissant des produits, autant préciser qu’en réalité, en 1850, la production d’acier n’atteint qu’à peine 2% de celle du fer (la tour Eiffel est en fer puddlé, pas en acier !). On l’utilise pour fabriquer des faux, des petits bijoux (spécialité de Birmingham) des aiguilles, et des broches de filature ou des cylindres pour les machines. Plus tard on nous montre comment le catalogue Manufrance (1887) lance un produit nouveau (avec les mêmes machines que pour les fusils), la bicyclette.
Le mouvement des marchés
Denis Woronoff analyse la manière dont on passe en France d’une période d’acier rare (que l’on préfère importer pour être sûr de sa qualité) à l’acier Bessemer, après 1860, en production de masse tournée vers l’exportation. Yves Cohen se penche sur les pratiques de l’acier aux automobiles Peugeot, dirigées au début du XX° par E. Mattern qui y introduit le taylorisme. Dans une perspective de micro histoire, il examine les configurations qui relient la gestion de la main d’œuvre avec la recomposition des qualifications (citons Mattern : lorsque je visite une usine, il me suffit de faire la proportion entre les ajusteurs et les hommes de machines pour vous dire si le travail est bien compris, bien fini et s’il revient bon marché), les modes d’intervention sur le marché (standardisation des pièces qui, avec l’interchangeabilité des pièces, permet des économies d’échelle … et l’élimination des ajusteurs) et l’intégration des capacités métallurgiques (Mattern exige une standardisation, définie en laboratoire, des aciers qui sont regroupés en un nombre restreint de classes). Il s’agit de rendre visible la manière dont s’opère concrètement le passage de l’atelier de mécanique traditionnel, caractéristique des premiers pas de l’automobile, à la grande usine intégrée sur le modèle américain de la taylorisation.
Mutations des produits
Le lecteur trouvera d’intéressants aperçus sur l’introduction des aciers Thomas et Martin, des aciers électriques avec le cas des industries alpines au début XX°, ainsi que sur la question des blindages, ou encore sur la lutte entre l’acier et le béton dans le bâtiment des années 20 aux années 60. Pour des enseignants de lycée, l’étude intitulée « Du chemin de fer au chemin d’acier », qui retrace la victoire de l’acier Bessemer sur le fer pour le remplacement des rails à partir des années 1870 (on est passé de 7% de remplacements par an à 1% en 7 ans) mérite un détour car on devrait pouvoir en tirer des supports (graphiques, cartes, extraits de rapports) et des idées pour une étude de cas sur les étapes du processus de l’industrialisation en classe de Première.
L’acier aujourd’hui
On parcourt, à différentes échelles, toute la deuxième moitié du XX°. Ainsi, à Usinor, pendant les Trente Glorieuses, s’esquisse une politique orientée produits plats, pour approvisionner les marchés de l’électroménager et de l’automobile. Dans ces années, c’est la production qui « pousse » le produit et non le client qui impose ses conditions. Les compétences commerciales sont minorées ce qui rendra la crise des années 70/80 d’autant plus redoutable : on a commencé à parler de qualité et non plus de tonnage au début des années 1980. Là on a commencé à avoir des rebuts … et des retours. Changement d’échelle pour l’historien P. Mioche qui montre que si ce sont les marchés qui ont produit les transformations de la sidérurgie dans la période de la CECA (le traité signé en 1951 vient d’expirer), ce ne sont ni les entreprises, ni l’Etat français (ils n’ont pas su prendre les bonnes décisions aux bons moments), mais l’Europe qui a sauvé la sidérurgie française. Cette contribution est illustrée de nombreux graphiques à la fois très visuels et très commodes (un exemple : l’évolution chiffrée de l’emploi sidérurgique en France).
Au total c’est un ouvrage précieux qui pourra servir de référence et qui stimulera la réflexion. On peut en tirer assez facilement des supports pédagogiques pour le lycée et il devrait être très utile pour les enseignants et les étudiants de classe préparatoire HEC.
[1] Erik Orsenna, Voyage au pays du coton, Fayard, 2006