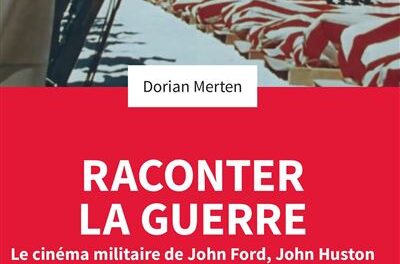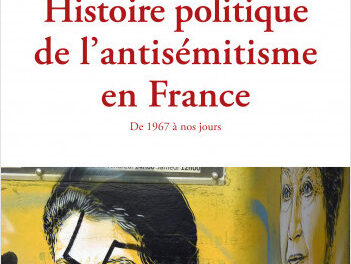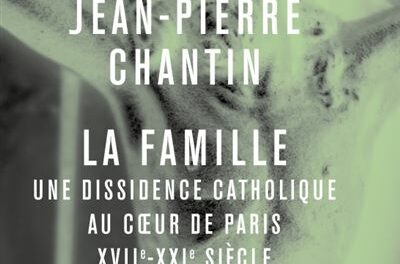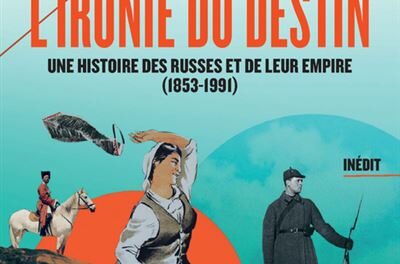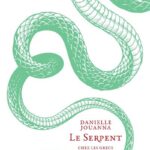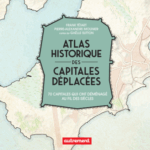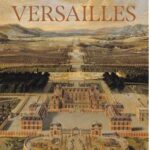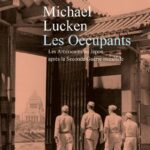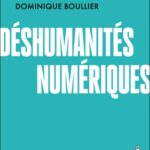Le présent ouvrage est consacré à ceux qui ont su très tôt percevoir l’ampleur et la nature spécifique de l’extermination des Juifs, plus particulièrement deux Polonais : le juriste juif Raphaël Lemkin (1900-1959), et le résistant catholique Jan Karski (1914-2000). Ces deux « messagers du désastre » sont parvenus à transmettre ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient vu dans les ghettos et les camps de Pologne, à leurs interlocuteurs en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Ils se sont heurtés à un mur d’incompréhension et à un clair refus d’intervenir de la part des dirigeants alliés. La question n’est plus de savoir « qui savait quoi ? », car tous savaient, mais pourquoi fut-il impossible d’appréhender l’extermination au point de la laisser se poursuivre. Annette Becker nous propose une étude approfondie qui repose sur l’analyse de sources nombreuses issues de fonds d’archives publics et privés britanniques, américains, français, israéliens, suisses, allemands et polonais.
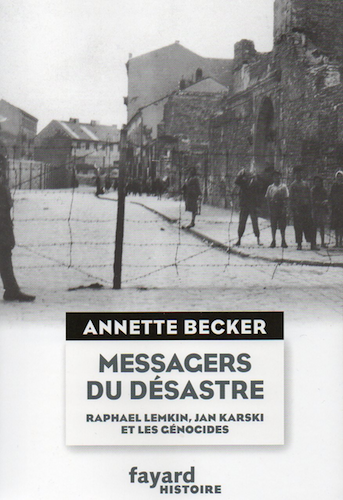
Témoins et messagers… au message inaudible
Dès 1941 et 1942, quelques hommes perçurent la spécificité de l’extermination des Juifs. Raphael Lemkin, juriste juif polonais, prend la route de l’exode dès la reddition de son pays. Sa famille entière sera massacrée. Des pays baltes, il rejoint la Suède, puis les Etats-Unis, avec beaucoup de difficultés car les visas sont délivrés avec parcimonie. Convaincu que le peuple juif est en train de « disparaître de la Terre », il envoie un mémorandum au président Roosevelt, dont il croit qu’il manque d’informations. De simples conseillers lui répondent des semaines plus tard qu’il faut prendre patience. Mortifié que Roosevelt ne perçoive l’urgence de la situation, il en conclut que les Alliés sont en train de se rendre complices indirectement d’un crime contre le peuple juif.
Le résistant catholique Jan Karski (de son vrai nom Jan Kozielewski) est un résistant polonais catholique. Il voit de ses propres yeux « l’anéantissement du monde de Lemkin ». A l’été 1942, il se rend avec une étoile jaune dans le ghetto de Varsovie, où il est témoin du sort qui est réservé aux Juifs. « Ils étaient encore vivants, mais à part la peau qui les recouvrait, les yeux, la voix, il n’y avait plus rien d’humain dans ces formes palpitantes », écrit-il dans ses récits, qui seront ensuite publiés à Londres et à New York. Ses guides du ghetto lui indiquent que des crimes plus horribles sont perpétrés dans l’Est de la Pologne. Après avoir endossé en fraude l’uniforme d’un supplétif ukrainien des nazis, Karski se rend à Izbica, puis à Wolkowysk, le village d’enfance de Lemkin. Là, il voit, sent et entend les cris et la mort d’êtres humains entassés dans des wagons où l’on a versé de la chaux vive. Il ressort de cet enfer, traverse l’Europe, gagne Londres, puis Washington.
Lui aussi envoie un mémorandum à Roosevelt, dans lequel il l’avertit qu’« une politique bestiale d’extermination » est « commise de sang-froid ». Réfugié aux Etats-Unis fin 1942, il rencontre le président américain. Roosevelt, qui a déjà lu des dizaines de rapports sur le sujet, et se montre plus préoccupé par l’économie de la Pologne que par le sort des Juifs. Il fait remettre à Karski une liste de personnalités juives à rencontrer. Nombre d’entre elles refuseront simplement de le croire, tel Felix Frankfurter, juge à la Cour suprême.
« Qui lisait, regardait, écoutait, pouvait savoir que l’on éliminait un peuple »
Les informations sur l’extermination parvinrent nombreuses dans les bureaux des ministères des Affaires étrangères de Londres et de Washington, et dans ceux des gouvernements en exil, polonais et tchèque à Londres, dans ceux de la France libre, dans les organisations juives, à Genève et en Palestine. Textes, photographies, dessins étaient publiés dans la presse clandestine, et dans les grands journaux britanniques et américains. Ils ne laissaient aucun doute : les Juifs étaient l’objet d’une extermination massive. Les documents ne furent pas cantonnés aux cercles des pouvoirs, l’essentiel des informations était mises à la portée du grand public. Roosevelt a reçu dès le 8 décembre 1942 le mémorandum de Karski, 19 pages précises. Quand il rencontre Karski en juin 1943, il a déjà lu son rapport ainsi que des dizaines d’autres. Le 17 décembre 1942, le New York Times publie la déclaration « sur la politique bestiale d’extermination des Juifs » proclamée conjointement à Londres, Moscou et Washington. On connaît les chambres à gaz, on connaît les camps d’extermination de Pologne.
L’extermination des Juifs est perçue comme une « atrocité » parmi d’autres. Intervenir pour sauver les Juifs serait différencier les souffrances infligées aux habitants des pays occupés, donner raison à Hitler et Goebbels qui affirment que les Alliés font « la guerre des Juifs », une guerre voulue et fomentée par les Juifs. D’autre part l’expression « exterminer complètement », « exterminer tout un peuple », est prononcée, écrite et reprise, mais « ce sont des mots qui ne font pas sens, car ils sont insensés ».
Le poids des mensonges de la propagande de la Grande Guerre
Spécialiste de la Première Guerre mondiale, Annette Becker montre que l’impossibilité à appréhender l’extermination des Juifs trouve ses racines au moment de l’invasion de la Belgique par l’armée allemande, en août 1914. A la suite des atrocités commises par les troupes du IIe Reich – des milliers de civils belges tués et de maisons détruites –, quatre-vingt-treize intellectuels et artistes allemands signèrent un « Appel au monde civilisé » qui niait ces atrocités.
Durant la Grande Guerre, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, en particulier, la propagande, qui insiste alors sur la « barbarie allemande », va jusqu’à affirmer que les soldats allemands ont coupé les mains des bébés belges, et que les cadavres des combattants sont utilisés par l’industrie pour faire des engrais. Cette mythification des atrocités convaincra par la suite de nombreux Américains et Britanniques qu’ils avaient été abusés pendant la Grande Guerre. En 1942, beaucoup, dont Lord Selborne, chef du Special Operations Executive, à Londres, pensent que les rapports sur l’extermination des Juifs sont très exagérés. « Comment, en effet, Britanniques et Américains qui avaient baigné dans l’idée qu’ils avaient été abusés pendant la Grande Guerre auraient-ils pu être convaincus qu’il s’agissait cette fois d’événements d’une autre ampleur, à une autre échelle que les « atrocités » – les guillemets prouvant qu’elle étaient largement hypothétiques- de la Première Guerre mondiale ».
Genèse du concept de génocide et de son émergence dans le droit international
A la fin des années 1920, Lemkin s’est passionné pour deux procès : celui Salomon Tehlirian qui a assassiné, en 1921 à Berlin, Talaat Pacha, l’un des responsables du génocide (le terme n’existe pas encore) arménien ; et celui de Shalom Schwartzbard qui a assassiné, en 1926 à Paris, Simon Petlioura, le général considéré comme le principal responsable des pogroms de 1918-1920 en Ukraine. Il constate qu’un Arménien et un Juif, dont les familles avaient été victimes de crimes collectifs, s’étaient fait justice dans les pays où ils avaient trouvé refuge. Les sociétés française et allemande ne pouvaient ni les condamner, ni les acquitter ; aussi dans les deux cas furent-ils jugés irresponsables de leurs actes. Lemkin écrivit un article où il regrettait l’absence de toute loi internationale pour l’unification des standards moraux en relation avec la destruction de groupes nationaux, raciaux et religieux.
Raphael Lemkin est convaincu qu’il faut un mot nouveau pour désigner « ce crime sans nom ». Lui qui s’est penché sur les crimes de la Première Guerre mondiale a relevé très tôt que les Arméniens avaient été victimes en 1915 d’une politique d’extermination comparable. Les notions de « crime de barbarie » (massacres, pogroms et cruautés collectives) et de « crime de vandalisme » (destructions d’œuvre d’art et de culture), qu’il a développées en 1933, n’ont toutefois pas été retenues par le droit international.
Lemkin forge alors en 1943 le concept de « génocide ». « La gestation du concept se situe en un temps et un espace étendus, les années vingt et trente en Europe, son invention précise aux Etats-Unis en 1943, quand Lemkin rédige le chapitre IX de son livre Axis Rule in Occupied Europe, intitulé « Génocide». Une fois le livre publié en 1944, le concept passe dans le domaine public, il est commenté, critiqué et échappe à son inventeur qui se lance dans un lobbying international pour sa reconnaissance au tribunal de Nuremberg – en vain -, puis pour sa légitimation par l’ONU : comités, commissions, amendements, votes, refus ». Ce barbarisme, qui associe le mot grec ancien genos (le collectif visé ou peuple) et le mot latin occidere (signifiant tuer), fait d’abord l’objet de vives critiques. « Nous voilà enrichis d’un monstre », peut-on lire dans l’éditorial du Monde du 11 décembre 1945. Le juriste français Eugène Aroneanu estime pour sa part qu’il est « trop étroit pour embrasser l’ensemble des crimes contre l’humanité ».
Non retenu comme chef d’accusation et de condamnation au tribunal de Nuremberg, le concept de génocide sera finalement adopté par l’ONU en 1948, avec la « Convention pour la prévention et la punition du crime de Génocide ». Après le vote de décembre 1948, Karski commence son combat pour la ratification puisque la signature de 20 Etats est nécessaire pour que la convention prenne force de loi. Ce sera fait en 1951, mais la convention demeure fragile car il n’existe pas de tribunal international. « Jusqu’à aujourd’hui, les organes des Nations unies ont d’ailleurs fait un usage parcimonieux du concept, inversement proportionnel à son usage public courant et souvent inadapté. »
Karski « Juste parmi les nations » et citoyen d’honneur de l’Etat d’Israël
« Pendant que Lemkin se débattait pour sauver sa conception du génocide, Karski perdait sa Pologne. » Pour le régime communiste il est « une marionnette naïve aux mains du gouvernement en exil », un instrument de sa propagande anticommuniste. En 1954, il obtient la nationalité américaine, sous son nom de guerre, Karski. Il reprend ses études de sciences politiques, soutient sa thèse et entame une carrière universitaire. Annette Becker observe que dans les années suivantes, l’extermination des Juifs disparaît de son discours universitaire et public : « Il participera à l’anamnèse publique de la destruction des Juifs d’Europe ». En 1978, il passe deux jours devant la caméra de Lanzmann qui tourne pour Shoah. L’auteure pense que ce tournage a sans doute catalysé sur le sujet le désir de parler de nouveau. Il ressent un sentiment d’urgence, et de culpabilité de n’avoir pas parlé. Pour la première fois en 1981, il prend la parole à Washington dans un colloque international consacré à l’extermination des Juifs, en présence d’Elie Wiesel. Sa parole fait grande impression ; « Hanté par le péché de l’abandon des Juifs, le catholique qui avait pourtant témoigné pour leur survie dès 1942 se proclamait désormais juif. Une adhésion affective, culturelle, politique, non religieuse ». Il fut invité en Israël et déclaré « Juste parmi les nations » en 1982.
Dans le montage de Shoah, Claude Lanzmann délaisse le résistant héroïque au service de la Pologne (choix de Karski dans ses Mémoires), tout autant que le porteur de messages auprès des Alliés qui tenta de convaincre le président des Etats-Unis de la réalité de l’extermination. Il lui assigne la tâche unique de rapporter ce qu’il avait vu dans le ghetto de Varsovie. Il apparait dans une séquence filmée dans le nouveau musée de Yad Vashem, celle où il raconte sa rencontre avec Roosevelt. Dans les dernières années de sa vie, il multiplie les interventions et les interviews. Il devient citoyen d’honneur d’Israël, en 1994.
Annette Becker évoque aussi son entrée en littérature, avec l’ouvrage de Yannick Haenel, Jan Karski, roman, publié en 2009 ; et la polémique ouverte par Lanzmann à ce propos, ce dernier « se considérant comme le propriétaire des témoins de Shoah » Elle porte un jugement positif sur ce « roman », considérant que l’auteur « a choisi la satire et la parabole ».
Karski a été le témoin des événements de 1989 en Pologne, et de sa libération du joug communiste. Mais « certaines associations polonaises, des historiens peu scrupuleux ou les gouvernements récents tentent de minimiser ou gommer l’aspect de la mission de Karski dénonçant le sort spécifique des Juifs et d’en faire avant tout un héros de la Résistance (polonaise) ». Il s’agit de nier la participation de Polonais au génocide des Juifs, et de le minimiser au nom des souffrances de tous les Polonais.
Annette Becker étudie les parcours de Karski et de Lemkin, mais elle cite aussi d’autres messagers du désastre, tels les écrivains Arthur Koestler, George Orwell ou Franz Werfel, montrant ainsi que derrière l’histoire des mots et des idées, il y a des combats d’hommes et de femmes. Elle inscrit son travail dans les pas de ces « messagers du désastre », rappelant que les hommes continuent de perpétrer des génocides et de les nier. Si les Arméniens exigent la reconnaissance du génocide de 1915, l’Etat turc se tient jusqu’aujourd’hui sur sa position négationniste. L’ouvrage se conclut chez les Tutsi du Rwanda, qui, dans l’indifférence générale, furent victimes d’un génocide en 1994.
© Joël Drogland
___________________________________________________________________________________________________________________________________
REcension de Laurent Bensaid
D’autres enfin n’ont pas vu ou voulu voir le processus d’extermination, par aveuglement, indifférence ou antisémitisme. Dès mars 1942,le Foreign Office britannique était en possession de photos qui montraient les exécutions de prisonniers soviétiques ,ainsi que les populations mourant de faim des ghettos. Mais certains hauts fonctionnaires britanniques semblent avoir douté de l’ampleur du massacre et l’un d’eux avait ajouté en marge des photos : « Aucune action ne semble nécessaire ». L’un des enjeux cachés de cette passivité était de ne pas développer l’immigration juive dans la Palestine mandataire. De même, certains responsables du Département d’État américain semblent avoir ,par antisémitisme, minimisé l’ampleur des massacres. Le rapport Karski ne provoqua pas de prise de conscience : l’extermination des juifs était perçue comme l’une des violences perpétrées par les nazis. Certains ne voulaient pas non plus être « soupçonnés « de faire la guerre pour les juifs , comme les en accusaient les nazis .Arthur Koestler et Annette Becker critiquent sévèrement ceux que l’historien américain Raul Hilberg nommait des « bystanders », ceux qui étaient contemporains du massacre et ne sont pas intervenus ou ont participé au massacre. Le 17 décembre 1942, les Alliés publient une déclaration promettant de juger les responsables des massacres des Juifs, mais ne proposent pas de mesures immédiates d’intervention.
Flash-back : La Première guerre mondiale, matrice explicative.
La Première guerre mondiale peut servir de matrice explicative à l’aveuglement de certains .En effet ,lors de la première guerre mondiale les Allemands avaient commis des exactions bien réelles en Belgique et dans le nord de la France, mais les puissances de l’ Entente les avaient accusés de crimes imaginaires , en particulier d’écraser les mains des enfants. Cette «Greuelpropaganda » (propagande sur les atrocités) eut des effets catastrophiques sur la prise de conscience du génocide. Beaucoup crurent avec plus ou moins de bonne foi ( « cécité fonctionnelle » disait Raul Hilberg) qu’il s’agissait de propagande. En 1944,une grande partie des Américains croyaient que les récits de l’extermination des juifs relevaient de la propagande de guerre. Mais ,à l’inverse, la guerre provoqua une prise de conscience des violences exercées contre les civils et une réflexion sur les moyens de les prévenir et des les sanctionner. La première guerre mondiale donna lieu à de nombreuses violences contre les civils . Sur le front oriental ,l’armée russe pratiqua des déplacements massifs et se livra à des massacres de populations qu’elle considérait comme suspecte , en particulier les juifs. A la fin de la guerre ,certains juifs furent victimes de pogroms de la part des Polonais . Mais c’est surtout le génocide des Arméniens ( et des Assyro- Chaldéens) qui provoqua des protestations et des réflexions. Dès 1915 , Français ,Anglais et Russes avaient qualifié le génocide de crime contre l’humanité . Dans l’Entre-deux guerres, un certain nombre de juristes ,parmi lesquels figurait Lemkin cherchèrent à caractériser juridiquement le crime contre l’humanité. Lemkin ne limitait pas son étude au génocide des Arméniens ou aux pogroms , il cherchait à remonter dans l’histoire ( croisade contre les Cathares ,persécution des protestants ,massacre des Hereros en Namibie) .Lemkin retenait trois critères principaux : l’arrêt des communications entre l’État auteur du crime et le reste du monde ,les violences exercées contre des individus et groupes déterminés, et la destruction de leur patrimoine culturel. Il pensait que ces actes devaient être sanctionnés à l’échelle internationale.
Après –guerre.
Après la guerre, Lemkin et Karski connurent des destins singuliers. Aucun d’eux ne pouvait ou ne souhaitait rentrer en Pologne et tous deux travaillèrent et enseignèrent aux États-Unis. Lemkin , qui avait perdu 49 membres de sa famille dans le génocide participa de manière marginale au procès de Nuremberg . C’est alors la notion de « crime contre l’humanité » c’est-à-dire les violences contre les civils pris individuellement qui dominait. Toutefois, la notion de génocide , c’est-à-dire les violences contre des groupes entiers, commençait à être connue et discutée. Elle était peu à peu dissociée de la notion de crime de guerre. L’objectif de Lemkin était avant tout dans l’avenir de protéger les populations. En 1948 l ‘Assemblée générale de l’ONU réunie à Paris adopta la Convention pour la prévention et la punition du crime de génocide. Il s’agit de lutter à la fois contre les massacres des personnes et contre la destruction de leur patrimoine culturel et de dénoncer les « génocides camouflés»..La Convention fut ratifiée par de nombreux États ,mais peu appliquée. Toutefois ,la Convention eut une portée symbolique importante auprès des Arméniens, car Lemkin avait trouvé un mot et une qualification juridique pour dire ce qu’ils avaient subi en 1915 (en arménien génocide se dit Tséghasbanoutyoum) et des militants noirs américains qui s’approprièrent le concept pour souligner que la discrimination et les conditions de vie déplorables dont étaient victimes les Noirs du Sud des États-Unis ou dans l’ Afrique du Sud de l’apartheid pouvait être un facteur de génocide. Lemkin dénonça aussi l’antisémitisme dont étaient victimes les juifs soviétiques. A sa mort, en 1959, il travaillait sur une encyclopédie des génocides et s’intéressait particulièrement à la grande famine en Ukraine.
Le destin de Karski fut lui aussi singulier. Lorsque les États-Unis reconnurent le gouvernement communiste polonais, Karski cessa de travailler pour l’ambassade de Pologne et enseigna les relations internationales,en particulier les relations entre les Grandes puissances et la Pologne , sujet de sa thèse. Très anticommuniste dans le contexte de la guerre froide, il travailla pour la CIA et dénonça la mainmise de l’URSS sur la Pologne. Il n’évoque guère le génocide des juifs. Pourtant, un retournement va se produire. Lors du procès Eichmann, le procureur général Gideon Hausner cite Karski parmi ceux qui ont aidé ou sauvé des juifs et l’ État d’ Israël lui décerna le titre de « Juste ».et il devint citoyen d’honneur d’Israël en 1994. Après de longues hésitations, il accepta en 1978 d’être filmé par Claude Lanzmann et évoqua ce qu’il a vu dans le ghetto de Varsovie . sans doute fut-il pris par l’urgence de témoigner. Il participe à de nombreux colloques , dans lesquels il souligne qu’il a témoigné quand il était encore possible d’arrêter le génocide. La renommée de Karski répond aux interrogations des années 1990- 2000 sur l’absence d’action des puissances alliées. Comme le soulignait Elie Wiesel : « Nous devons être les messagers des messagers ». Karski meurt en 2000, mais connaît une postérité artistique et littéraire . Des romans/récits de Bruno Tessarech et de Yannick Haenel mettent en scène Karski et il est représenté par deux statues à Washington et à Varsovie. Dans la conclusion de son ouvrage
Annette Becker évoque les réflexions poignantes des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda comme Emilienne Mukansoro , s’adressant à toute sa parentèle exterminée « J’ai passé plus de temps avec vous qu’avec ma famille vivante. J’ai essayé d’être mon père et ma mère » ou Esther Mujawayo : « La puissance d’un génocide, c’est exactement cela :une horreur pendant, mais encore une horreur après. Intérieurement, il n’ y a pas fin à un génocide». Et Annette Becker conclut : « Génocide :les victimes et le droit enfin sur le même plan : souffrances sans fin, crime imprescriptible ».