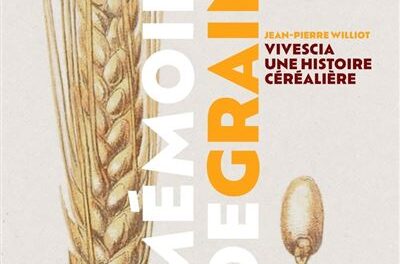Il y a quatre ans, comme le précise Paquot dans sa préface, « nous étions conviés à ne pas quitter notre domicile, sauf pour une brève promenade quotidienne de proximité », « de nombreux confinés découvraient leur ville à pied […] Ils prenaient conscience des alentours, de la population composite de leur quartier, des architectures et des jardins voisins, des enseignes dont ils ignoraient tout. Bref, leur habita leur apparaissait autre » (p.1). Le présent ouvrage du philosophe de l’urbain Thierry Paquot est une réédition d’un travail publié en 2020 au moment du premier confinement.
Quatre ans après, rien n’a véritablement changé, les pratiques d’avant le confinement ont reprises de plus belles. L’exurbanisation annoncée n’a pas eu lieu. L’idée n’est plus d’aller chercher la « nature » à la « campagne » mais de la développer « en ville », « d’enverdir », de « déminéraliser », de « végétaliser », de « décarboner », de « résilier »… En se référant à Lewis Mumford, dans « Histoire naturelle de l’urbanisation », Paquot reprend une idée, déjà développée dans « Désastres urbains » : la montée en puissance du productivisme brise le coupe essentiel ville/campagne et transforme chaque partenaire en non-ville et non-campagne.
« La Terre est devenue urbaine », nous dit Thierry Paquot, et c’est à partir de ce constat que l’auteur nous invite à imaginer « ses avenirs ». L’idée de l’ouvrage est de trouver des solutions pour remettre du lien entre ville et campagne. Paquot analyse l’urbanisation des mœurs qui a unifié et uniformisé les modes de vie, les valeurs, les comportements, les paysages, indifféremment que l’on se trouve à la ville ou à la campagne. Parmi les pistes balisées par Paquot figure celle de la « biorégion urbaine », une idée inspirée par le travail du territorialiste italien Alberto Magnaghi et qui pourrait limiter l’expansion urbaine.
L’introduction étoffée de l’ouvrage revient sur les mots et leur étymologie, passion que Paquot aime à faire partager avec ses lecteurs. Les termes qui sont passés en revue participent à la « démesure » du fait urbain. L’obsolescence programmée, l’hubris, la frugalité et l’abondance, la saturation sont des phénomènes inhérents à notre société contemporaine et les fruits d’un productivisme à tous crins. Il est temps, nous alerte Paquot, de « désaturer avec délectation », de trouver la juste taille des villes, celle qui garantit le débat public, la qualité des relations de voisinage, la réussite scolaire, la détente… Pour ce faire, l’auteur revisite la géohistoire des villes, explore les propositions quantifiées par certains auteurs, développe enfin une solution possible à travers l’exemple du biorégionalisme urbain.
Un peu de géohistoire des villes…
L’origine des formations urbaines remonte au tournant du quatrième et troisième millénaire avant J.-C. Ces espaces d’habitation dense rassemblent une population dont la principale caractéristique est de ne pas produire ce qui la nourrit. Les villes s’approprient donc une bonne partie de la production céréalière tout en contrôlant l’eau indispensable à l’irrigation des terres. Ces villes sont donc souvent les embryons des premiers États, avec leurs lois, leur fiscalité, leur administration, leur armée.
Depuis les Étrusques, toute fondation antique d’une ville entraîne les mêmes étapes : l’inauguratio (la projection sur le sol du templum rectangulaire tracé dans le ciel pour la consultation des présages), l’orientatio (détermination du cardo et decumanus, les deux axes principaux de la ville N-S et E-O), la limitatio (les limites de la ville sont tracées à la charrue) et la consecratio (sacrifice rituel qui sacralise la nouvelle ville et la protège).
Bond dans l’histoire, avec le dépôt du brevet de la machine à vapeur en 1784, nous entrons, pour Paul Josef Crutzen et Eugene Stoermer, dans l’anthropocène, nouvelle ère géologique conditionnée par l’activité humaine. Les villes se débarrassent de leurs fortifications et certaines d’entre elles voient leur population augmenter. À la suite du dénombrement de la population nationale de 1846, le politique distingue population urbaine et population rurale et fixe le seuil à 2 000 habitants entre les deux. L’historienne Christine Lamarre reconstitue l’historique de ce seuil et de ses critiques depuis la période prérévolutionnaire, à un période où, dit-elle, « le nombre, le quantifiable, dépassent la singularité, l’appréciation particulière[1] ».
En 1970, le philosophe Henri Lefebvre, en observateur des changements opérés depuis le milieu du XXe siècle, propose la fin de l’opposition entre ville et campagne et l’annulation des deux termes pour leur préférer un troisième, l’urbain. Le sociologue Zygmunt Bauman comment le développement du capitalisme a accéléré l’expansion urbaine. La capitalisme industriel (ou capitalisme solide), celui du XIXe siècle, avait tendance à s’implanter dans des territoires qu’il valorisait, il y fixait la main-d’œuvre, s’intéressait aux logements, à la formation de ses employés. Le capitalisme post-industriel (ou capitalisme liquide) se libère du salariat, s’émancipe du territoire en le précarisant. L’industrie ne s’y fixe pas mais utilise le site comme un plateau technique, préparé et financé par les collectivités territoriales. Le productivisme « liquide » s’urbanise sans s’industrialiser, ce qui produit d’autres paysages et de l’étalement urbain.
Quelle taille idéale pour la ville ?
Dans cette deuxième partie, l’auteur recherche chez un bon nombre d’auteurs qui ont imaginé la ville idéale quels étaient les critères de taille énoncés. Platon, dans Les Lois, indique, par exemple, qu’une population idéale devrait être composée de 5 040 foyers pour une cité digne de ce nom afin de pouvoir garantir la plus juste égalité, une bonne défense collective et une administration efficace. La taille idéale du phalanstère de Charles Fourrier est de 810 hommes et 810 femmes. Pour Howard Ebenezer, l’inventeur de la cité-jardin, le seuil est fixé à 32 000 habitants. Dans Urbanisme, Le Corbusier parle de 3 millions d’individus répartis dans des blocs de 4 000 personnes. Walter Gropius, dans Rebuilding Our Communities, évoque 100 000 habitants.
Bien difficile de conclure sur autant d’écarts entre les auteurs. Paquot en vient à penser que la juste mesure n’existe pas dans l’absolu, qu’elle diffère suivant les individus, les sociétés, qu’elle dépend de beaucoup d’autres facteurs. La biorégion devient alors pour lui une solution pour le devenir urbain. Il la définit ainsi :
« Il y aura, alors, une ou deux « grandes villes » (disons de 100 000 et 300 000 habitants), quelques villes de 20 000 à 30 000 habitants, des villages urbains de 1 000 à 3 000 habitants et des hameaux et des grappes urbaines de quelques maisons. L’essentiel se tient au-delà du nombre, il dépend de la composition de cet ensemble territorial et de sa capacité à faire communauté et à assurer à chaque membre les conditions de son autonomie et de son bonheur » (p.169).
Pour un biorégionalisme urbain
L’auteur part encore une fois d’un constat fondamental : les découpages administratifs récents sont arbitraires et ne tiennent absolument pas compte de l’avis des habitants, des conditions environnementales, des cultures locales ou régionales. Il explore les écrits des penseurs, urbanistes et sociologues, comme Patrick Geddes, Léopold Kohr, qui ont étudié les liens entre métropolisation et environnement. Un cas particulier est accordé à Alberto Magnaghi. Pour cet architecte italien, l’urbanisation contemporaine détruit à la fois les campagnes et les villes. Il prône un « retour à la ville » en divisant les mégalopoles en petites unité urbaines mêlant, selon leur histoire et leur culture, les nouvelles campagnes et villes, autogérées, rhizomées et autonomes. Dans La Biorégion urbaine (2014), il écrit :
« La biorégion urbaine est le référent conceptuel approprié pour traiter d’une manière intégrée les domaines économiques (système local territorial), politiques (autogouvernement), environnementaux (écosystème territorial) et de l’habiter (lieux fonctionnels et lieux de vie dans l’ensemble de villes, bourgs et villages) d’un système socioterritorial qui cultive un équilibre de co-évolution entre établissement humain et milieu ambiant, rétablissant sous une forme nouvelle les relations de longue durée entre ville et campagne pour atteindre l’équité territoriale ».
Du travail de Magnaghi, Paquot tire un certain nombre de conclusions sur l’habiter et sur l’existence humaine sur Terre. Pour lui, la territorialisation, l’implantation de l’humain dans un site propice n’est pas le propre de l’humain, ce n’est pas « habiter la Terre ». L’être humain migre, nomadise, circule… rêve. Ce sont les rythmes et temporalités que l’humain adopte qui expriment sa condition d’humain. Bachelard n’affirmait-il pas dans La Poétique de l’espace : « Dans ses mille alvéoles, l’espace tient du temps comprimé. L’espace sert à ça » ?
Ainsi, à la suite de Deleuze et Guattari, Paquot propose que le territoire soit d’abord la distance critique entre des êtres de même espèce : « Ce qui est mien, c’est d’abord une distance, je ne possède que des distances. Je ne veux pas qu’on me touche, je grogne si l’on entre dans mon territoire, je mets des pancartes ». Temporalités et territorialités vont ensemble, aussi bien pour chaque humain que pour chaque société. La recherche du temps opportun accompagne celle du milieu propice.
Dans un dernier chapitre, l’auteur nous fait voyager dans le temps et nous projette en 2050 : « La France n’existe plus comme État-nation, ses cent et quelques biorégions sont fédérées au sein d’une vaste Europe constituée également de biorégions… ». L’utopie nous amène à réfléchir sur nous même, comme toujours et pour notre plus grand bien, avec Thierry Paquot. L’auteur nous invite à habiter mieux et non à habiter plus. Il interroge notre véritable condition de vie sur Terre, mobile, parsemée de capsule temporelle que sont les lieux que nous traversons par habitude, au fur et à mesure, où nous grandissons, vieillissons.
[1] Christine Lamarre, « Aux origines de la définition statistique de la population urbaine en France : le seuil des 2000 habitants », Histoire & Mesure, 1987, vol.2, n°2, p.71.