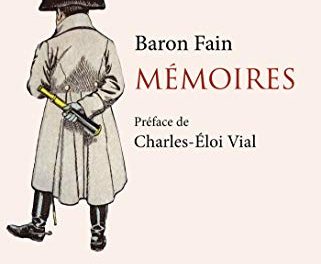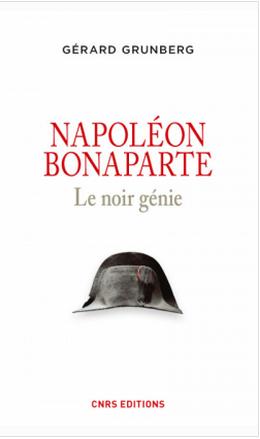
Si G. Grunberg affirme que cette dernière est pour le moins difficile à déchiffrer, tiraillée qu’elle est entre l’héritage « archaïque » légué par les monarchies absolues et les idées nouvelles produites par le mouvement libéral, il met en évidence que la politique intérieure comme étrangère napoléoniennes sont mues par le même refus du libéralisme et des libertés publiques, ainsi que par la volonté d’acquérir une gloire personnelle. L’échec final de l’empereur serait donc conjointement celui de ses armées et de son projet antilibéral.
Le lecteur néophyte découvrira ici un manuel dense malgré son petit volume et, plus averti, il lira un ouvrage aux choix de périodisation originaux et un propos documenté à partir de sources émanant, pour l’essentiel, des écrits de Napoléon lui-même et de ses contemporains. Le texte est stimulant et agréable à lire et il donne aux enseignants des outils pour mieux concevoir certaines séquences, en quatrième et seconde. En effet, le dialogue complexe qu’entretien la période du Ier empire avec le phénomène révolutionnaire reste au cœur des problématiques pédagogiques.
Dans une courte introduction, G. Grunberg refuse la rupture traditionnelle autour de la date de 1804 distinguant le temps de la splendeur (le Consulat) de celui du déclin, après le sacre. Au contraire, il démontre que la volonté de restaurer un pouvoir absolu est inscrite dans le projet napoléonien dès le Coup d’État et il n’y discerne guère d’inflexion que ce soit en politique intérieure ou étrangère.
UNE CERTAINE IDÉE DE LA POLITIQUE
La 1ere partie est consacrée à la culture politique de Bonaparte. L’auteur dépeint ainsi un homme influencé par Machiavel et les grandes figures historiques, pour qui le pouvoir se légitime davantage par la force et le soutien des masses que par des institutions solides. Mais aussi un politicien cynique excluant de la sphère politique femmes et intellectuels, usant de menace, de corruption et de mensonge pour convertir toute forme de rapport en subordination, jusqu’au sein de sa propre famille. Un dirigeant hostile à toute forme de liberté publique et aux corps intermédiaires.
L’analyse de Grunberg éclaire aussi le rapport de Bonaparte à la Révolution. Défenseur opportuniste de certaines de ses conquêtes (la fin de la féodalité, la souveraineté populaire, l’égalité des droits), il en blâme les luttes de faction et l’incapacité à produire un pouvoir fort. Il rejette cependant en bloc le régime représentatif et le modèle anglais. Ce système pluraliste lui semble en effet inutile dans un pays qui a déjà abattu l’absolutisme ainsi que l’aristocratie, où le gouvernement constitue déjà en soi une représentation nationale.
La conception napoléonienne du « despotisme démocratique » est enfin présentée comme une synthèse, contradictoire seulement en apparence, entre le renforcement de l’Etat et de l’administration centrale hérité de l’Ancien Régime et les idées de libertés issues du mouvement libéral. Ainsi, si la souveraineté populaire n’est pas écartée, elle est neutralisée par un retour à une conception organiciste du rapport de la Nation à l’Etat selon laquelle Napoléon est à la fois incarnation de la première et tête du second.
L’ÉTAT NAPOLÉONIEN CONTRE LE RÉGIME REPRÉSENTATIF
Comment Bonaparte a-t-il traduit cette pensée en actes ? Il fallait d’abord en finir avec un Directoire impopulaire, corrompu, en difficulté militaire et intérieure. Bonaparte lui témoigne une fidélité de façade qu’il négocie contre la conduite de la lucrative campagne d’Italie. Le retour d’Egypte en 1799, est le moment de la prise du pouvoir présentée par l’auteur en trois temps.
Le coup d’état de Brumaire, habillé d’un vernis de légalité par le plébiscite de 1800, a pour but de lui donner le contrôle de l’exécutif tout en marginalisant le législatif. Cet objectif est entériné par La Constitution de l’an VIII analysée par l’auteur comme un 2e temps du coup d’état mais « en chambre » cette fois-ci. Dictée pour l’essentiel par Napoléon, désormais Consul à vie, son texte est adopté sans débat ni vote, et elle achève la Révolution tant sous son aspect représentatif que démocratique. Le régime, consolidé par la victoire de Marengo, dernier temps de l’ascension, prend alors un tour nettement monarchique.
Trois assemblées sont créées : le Sénat, le Tribunat et le Corps Législatif mais le suffrage indirect ainsi que les nominations à vie leur ôtent rapidement toute légitimité. De plus, elles sont peu à peu déshabillées de leurs attributions. Ainsi, le Sénat devient « une machine à constitutionnaliser des décisions relevant de l’arbitraire napoléonien » grâce à la procédure du Sénatus-consulte, moyen privilégié de l’exercice du pouvoir. Epuré à plusieurs reprises de son opposition libérale et jacobine, le Tribunat est lui tout bonnement supprimé en 1807. Guère plus d’autonomie enfin du côté du Corps législatif convoqué, ajourné (entre 1811 et 1813) ou prorogé au bon vouloir du gouvernement. Quant au Conseil d’Etat son fonctionnement est révélateur de l’immixtion des pouvoirs : il est à la fois cabinet du monarque, sommet de la hiérarchie de l’administration et de la justice administrative, organe de législation…
Un Etat centralisé et pyramidal, où prolifèrent les conseils privés, se substitue donc au régime représentatif. Ses petites mains sont des fonctionnaires nommés par l’exécutif, efficaces, plus nombreux et mieux payés. Il n’existe ainsi plus de contrepoids politiques, préfigurant les appareils politiques des systèmes totalitaires.
L’ASSUJETTISSEMENT DES FRANÇAIS
Comment maintenir sous obéissance des Français qui faisaient leur Révolution moins d’une décennie auparavant ? Si l’adjectif totalitaire est inapproprié pour qualifier l’Empire, ses pratiques liberticides, exposées dans les chapitres 3 et 4, seront reprises à leur compte par les dictatures du XXe siècle et justifient, sous la plume de G. Grunberg, le terme de « tyrannie modérée » :
– un culte du chef célébrant le génie militaire et la figure providentielle de Bonaparte est instauré. Les arts (peinture, architecture, théâtre ), une presse censurée et nationalisée à partir de 1811 mais aussi le monopole pris par l’Etat sur l’instruction publique (lycées d’Empire en 1802) en sont les instruments.
– le paysage politique est épuré de ses adversaires : jacobins, libéraux, monarchistes récalcitrants, tous les milieux subversifs sont l’objet d’une surveillance. Elle est mise en œuvre, particulièrement après 1810, par l’inflation de l’appareil policier, le recours au fichage des individus, des arrestations arbitraires, l’emploi usuel de la déportation et de l’exil…
– l’assujettissement passe également par l’utilisation de tous les Français au service d’un effort de guerre ininterrompu, préfigurant les guerres totales. Bonaparte généralise la conscription et organise, de vastes campagnes de mobilisation rendues nécessaires par les pertes considérables, surtout après la saignée de 1812.
– le volet familial du Code civil de 1804 est aussi révélateur. En restaurant les institutions sociales mise à mal par la Révolution, Bonaparte entend rétablir l’autorité de l’Etat. La famille, marquée par la mise en minorité juridique de la femme et des enfants et la toute-puissance du père érigé en pater familias, est utilisée comme courroie de transmission d’une obéissance plus générale à l’Empereur.
G. Grunberg met cependant en évidence les échecs et résistances nés de cet endoctrinement :
– celle des catholiques dont Napoléon, pourtant surnommé le « restaurateur des autels » après le Concordat, perd le soutien après son annexion des états du Pape (1806) et le conflit avec Pie VII autour de l’investiture des évêques.
– celle de la classe de notables liés à l’Etat qu’il s’efforce de créer. Réunissant des hommes faits et d’anciens émigrés revenus en France, il tente de la cimenter et de la fidéliser par des avantages matériels et symboliques (légion d’honneur, majorats) bientôt héréditaires. Mais la fusion ne prend pas et le ralliement reste ambigu. Ce sont en effet les maréchaux qui obligent Napoléon à abdiquer en 1814 tandis que les sénateurs prononcent sa déchéance.
– celle des républicains, détournés du régime par son caractère monarchique, par les purges dont ils sont l’objet et la promotion sociale de l’ancienne noblesse contre-révolutionnaire.
– le blocus et ses conséquences, enfin, lui attirent les foudres des milieux d’affaires, des villes commerçantes et industrielles ainsi que des classes modestes face à la colère desquelles, Napoléon n’a qu’une répression croissante à opposer.
La collusion des monarchistes, des républicains, des catholiques, des anticléricaux et des libéraux pour abattre le régime en 1814 montre que l’ambition pertinente de réconciliation de la société française se fit en fait aux dépends de l’Empereur.
LA DIPLOMATIE DE L’ÉPÉE
Dans ce chapitre, G. Grunberg aborde la politique extérieure de l’Empire. Le récit militaire lui permet surtout de déconstruire la propagande napoléonienne selon laquelle l’état de guerre quasi permanent avait deux justifications : stabiliser un régime toujours conçu comme fragile et se défendre contre des nations européennes agressives car incapables de traiter Bonaparte en égal. Pour en terminer avec le mythe, l’auteur divise le propos en deux périodes dont la paix de Tilsit (1807), et le divorce qu’elle induit avec le projet de Talleyrand d’une paix européenne équilibrée obtenue par la satisfaction des intérêts réciproques, est la charnière.
La 1ere période, de 1800 à 1805, est celle des victoires. La France écrase l’Autriche, dépecée et mise en quasi faillite par les terribles conditions de la paix de Presbourg (1805) puis après Wagram (1809). Les relations conflictuelles avec l’Angleterre se détériorent encore de par la volonté inflexible de l’Empereur d’établir son hégémonie en Europe par la conquête et bientôt le blocus. Si l’empereur vient à bout de la 3e coalition à Austerlitz (1805), il ne le doit qu’au manque de coordination des efforts militaires adverses.
Bonaparte redessine alors les frontières de l’Europe et place des membres de sa famille sur différents trônes, brisant la 4e coalition à Iéna et Eylau. La domination française s’élargit encore, aux dépends de la Prusse, de l’Autriche et l’Italie. Son intérêt bascule ensuite vers la péninsule ibérique où il s’empare du Portugal puis de l’Espagne en 1808, provoquant une nouvelle intervention anglaise.
La 2e période, après Tilsit, est conditionnée par le blocus décidé en 1806. Afin de fermer les ports européens aux navires anglais, Napoléon poursuit la politique d’extension du Grand Empire, le fortifie d’un rempart de royaumes frères et tente de persuader la Prusse, l’Autriche et la Russie d’y participer. Ici encore, G. Grunberg montre comment l’empereur gâche les bonnes relations nouées avec celle-ci. Alexandre Ier, confronté à l’impasse politique et économique du blocus, assiste aux premiers revers de la Grande Armée en Espagne. Les pertes territoriales subies à la paix de Schönbrunn (1809) et le changement d’alliance de Talleyrand précipiteront son retournement contre la France. La suite est bien connue : Napoléon prépare mal une campagne de Russie qui se termine en désastre en 1812. Alexandre Ier, aidé de Talleyrand et Metternich, redessine les alliances européennes contre Napoléon. La 6e coalition (Autriche, Prusse, Suède, Russie, Angleterre), la seule qui se soit vraiment donnée les moyens de le faire, le vaincra en 1814.
L’intérêt de l’ouvrage est de ne pas se limiter à l’analyse d’un échec militaire mais de proposer une lecture politique de la faillite du Grand Empire :
– ce dernier n’a jamais correspondu qu’à une vision empirique de Bonaparte tant du point de vue de son extension, jamais arrêtée, que de son gouvernement. Au-delà des différents statuts en son sein (départements, « royaumes frères », Etats alliés), une autorité absolue s’exerce indifféremment sur ces ensembles, y compris sur la France qui n’est pas moins pressurée que ses dépendances en matière fiscale ou militaire.
– Napoléon n’obtient donc pas l’adhésion des peuples conquis. Il considère que la révolution a libéré de leurs chaînes des peuples qui n’attendaient que la France pour les briser. L’accueil initialement favorable de certaines élites s’éteint quand l’Empereur impose, au mépris des traditions et institutions existantes, les lois et le Code Civil français. Les pillages, l’oppression fiscale, la conscription et les effets du blocus feront le reste. C’est ainsi le cas en Espagne où les exactions françaises aboutissent à une guerre sauvage entre 1808 et 1814 ou encore en Hollande où son frère Louis est contraint de quitter son royaume en 1810 face au soulèvement populaire après avoir vainement tenté de convaincre l’Empereur d’y adoucir le blocus.
Ainsi, pour l’auteur, les conquêtes napoléoniennes, jamais porteuses d’une solution politique durable, sont pour beaucoup dans la genèse des nationalismes qui devaient s’exacerber au XXe siècle.
– enfin, G. Grunberg met en évidence que, si Napoléon est « contraint » de relégitimer sans cesse le régime par une guerre, devenue en vérité une véritable fin en soi, il le doit à sa conception absolutiste du pouvoir et à son refus de faire des concessions tant sur le plan national qu’extérieur jusqu’au point final de Waterloo.
QUEL HÉRITAGE ?
Le chapitre final s’apparente à une conclusion. On passera sur le récit évènementiel qui sépare la déchéance de Napoléon en 1814 prononcée par le Sénat jusqu’à son exil à Sainte-Hélène après l’ultime défaite de Waterloo. Car il s’agit ici pour G. Grunberg de poser une question à laquelle les polémiques récentes sur les célébrations accompagnant l’anniversaire de la fameuse bataille donnent une résonnance particulière. Quel peut être l’héritage d’un souverain qui appauvrit le pays au point de le mettre en quasi faillite, le rend à lui-même plus petit qu’il ne l’a trouvé malgré son génie militaire indiscutable, et qui ne fonde pas un régime politique durable ? L’auteur nous montre que la réponse est nuancée, à l’image de la posture des libéraux, principaux opposants sous l’empire et pourtant à l’initiative de la coûteuse translation des cendres de Napoléon vers les Invalides quelques années plus tard.
Aucun des régimes suivants ne saura en fait se passer de deux éléments qui ont, un temps, conforté l’Empire :
– la gloire : inscrite dans la tradition monarchique depuis le roi soleil, les régimes monarchiques comme républicains du XIXe siècle auront conscience de son rôle structurant pour l’identité nationale. Il faudra les guerres totales du XXe siècle pour que ces deux valeurs se disjoignent.
– L’État : jamais l’état puissant, centralisé et professionnalisé créé par Napoléon ne sera remis en cause. Au-delà de son efficacité, il joue le rôle de garant de l’unité d’une nation qui n’est liée ni par la communauté ethnique ou religieuse, ni par une guerre d’indépendance, ni par une tradition parlementaire comme en Angleterre, ni par une structure fédérale à l’américaine.
Cependant, la postérité politique napoléonienne est plus discutable selon G. Grunberg. Il démontre en effet qu’elle a aussi créé en France une sorte d’addiction à une conception monarchique de l’exercice du pouvoir dont le gaullisme est, selon lui, le meilleur exemple par son attachement au principe d’un Etat fort mais aussi à l’autorité du chef, sa méfiance vis-à-vis du parlementarisme et des partis politiques. Ainsi donc, l’héritage antilibéral du bonapartisme a retardé l’entrée de la France dans la modernité.
.