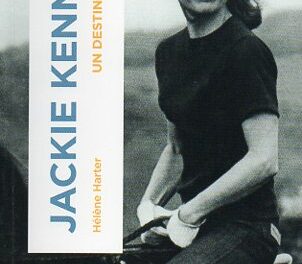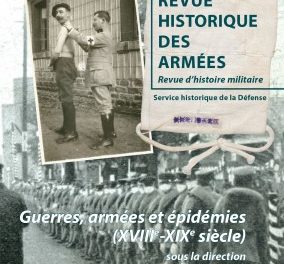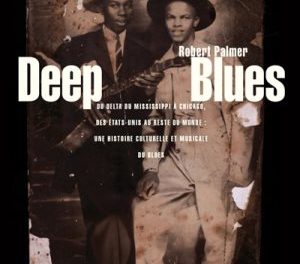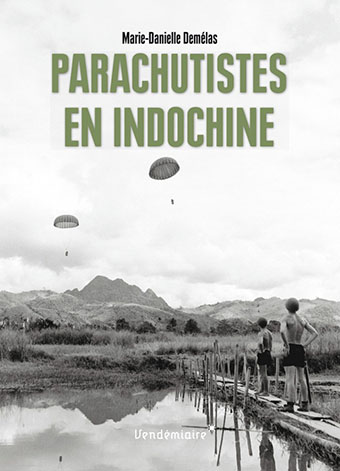
Les éditions Vendémiaire avec laquelle La Cliothèque travaille depuis de nombreuses années nous ont habitués à explorer des périodes de l’histoire sous des angles particulièrement originaux. On se souvient de cet ouvrage de Jean-Yves le Naour sur la légende noire des soldats du midi ou celui sur l’occupation de la ville de Nice de Jean Louis Panicacci, En territoire occupé. Italiens et Allemands à Nice. 1942-1944, dont la recension avait été rédigée en 2012 par notre regretté Alain Ruggiero.
Il suffit d’ailleurs de taper le nom de cette maison d’édition dans le moteur de recherche interne de La Cliothèque pour mesurer à quel point nos rédacteurs ont été séduits par les productions de cette jeune maison d’édition qui maintient une qualité éditoriale remarquable.
Cet ouvrage ne relève pas de l’histoire militaire à proprement parler, du moins dans la conception que l’on peut en avoir dans des ouvrages plus traditionnels qui ne manquent d’ailleurs pas d’intérêt. Marie Danielle Demélas est une spécialiste de l’histoire politique et militaire de l’Amérique latine de l’Espagne et s’est intéressée à la genèse de la guerre de guérilla en 2007.
Il serait intéressant de savoir dans quel cadre elle a été amenée à travailler sur cet aspect de la guerre d’Indochine qui n’est pas forcément très connu. Monsieur et cher collègue, Merci pour votre recension et pour l’intérêt que vous avez pris à ce livre.
Je réponds à votre question : pourquoi une spécialiste du monde hispano-américain a-t-elle écrit sur un sujet pareil ? Tout est venu de la demande d’anciens paras d’Indochine qui m’ont demandé de les aider à mettre en forme leurs souvenirs en leur fournissant des données tirées du SHD. Je me suis piquée au jeu, d’autant que cette histoire ne m’était pas si étrangère : j’ai travaillé sur le monde militaire et consacré quelques études à la guerre de guérilla. Cela m’a aidée à ne pas perdre de vue mon objectif — comprendre comment on a tenté, après 1945, de reconstituer une armée qui puisse faire oublier le désastre de la défaite. Je saisis l’occasion pour féliciter l’équipe des Clionautes. Ancien professeur du secondaire, je suis très sensible à la rigueur et l’efficacité de cette entreprise. Bien à vous, Marie-Danielle Demélas
Faut-il dire pour autant que la guerre d’Indochine est totalement ignorée des programmes scolaires ? Assurément non. Les lecteurs de La Cliothèque qui sont pour beaucoup des enseignants en activité dans le second degré savent que la guerre d’Indochine intervient à plusieurs reprises dans les programmes du collège, en troisième, lors de l’étude de la décolonisation en première. On relie également la guerre d’Indochine à la période du début de la guerre froide.
On l’ignore trop souvent mais le parachutisme militaire est apparu en Union soviétique dans les années 30, et cela a été repris également par l’armée allemande dont le modèle d’opérations aéroportée a été l’invasion de la Crête. L’armée britannique comme l’armée des États-Unis ont également développé cette spécialité pendant la seconde guerre mondiale.
L’opération aéroportée permet en effet de déployer des troupes dans la profondeur du champ de bataille, souvent sur les arrières de l’ennemi en utilisant l’effet de surprise. Pour des raisons évidentes qui tiennent aux capacités de transport aérien de l’époque les effectifs déployés sont forcément plus limités que ceux du transport motorisé terrestre. Pour autant, en utilisant des planeurs de grande taille, des effectifs très importants ont pu être déployés, notamment lors du débarquement de Normandie.
Le parachutisme militaire relève également de l’infiltration clandestine, et dans les conditions techniques des années 1940 et 1950, il supposait que ses pratiquants soient particulièrement aguerris et physiquement aptes, ce qui explique la spécificité de ces régiments parachutistes, issus dans les forces françaises libres d’un recrutement par le spécial air service, les SAS, formés aux actions coup de poing plutôt qu’à la guerre classique.
Lorsque la guerre d’Indochine commence, elle s’inscrit dans une démarche de pacification, les premières unités parachutistes recrutent de très jeunes gens qui s’étaient engagés dans la résistance, avaient rejoint les forces françaises de l’intérieur et parfois après leur démobilisation, souhaité rejoindre l’armée régulière dans une unité d’élite.
C’est dans le Sud-Ouest de la France, là où se trouve toujours installée là 11e brigade parachutiste, et notamment à Tarbes et à Pau que se sont installés les premiers camps d’entraînement. La cohabitation avec la population locale n’est pas forcément très harmonieuse et de très nombreux incidents sont signalés.
Les premiers engagés dans les bataillons coloniaux de commandos parachutistes ne sont pas forcément des enfants de chœur. Pour ceux qui étaient issus des forces françaises de l’intérieur ils se considéraient encore comme des francs-tireurs plutôt que comme des soldats dans une armée conventionnelle. Il arrive aussi que la greffe prenne plutôt mal lorsque ces bataillons ont à leur tête des officiers issus de l’armée française d’avant 1939.
Les unités parachutistes ont très vite intégré la nécessité de constituer des bataillons autochtones, trois bataillons vietnamiens et un bataillon khmer ont également été formés. C’est le général De Lattre qui impose à tous le béret amarante, tandis que les légionnaires restent fidèles au béret vert.
Dès leurs premières opérations, les bataillons parachutistes payent un lourd tribut lors des premiers combats, sans parler des maladies et des accidents. Il semblerait que un sous-effectif de 30 à 40 % soit le lot commun de ses troupes assez particulières.
La spécificité des unités parachutistes réside dans la nécessité de disposer de moyens de transport aérien, mais aussi d’un personnel apte à assurer la logistique nécessaire pour la maintenance des parachutes qui représentent alors 60 m² de soie industrielle.
Les moyens de l’armée française ne permettent pas de laisser les parachutes sur place après le saut, ce qui conduit au transport, dans des conditions difficiles, d’un poids de 17 kg supplémentaires.
Le pliage et la préparation de ces parachutes a été confié à partir de 1948 à des jeunes femmes, auxiliaires féminines de l’armée de terre, qui étaient considérées comme beaucoup plus consciencieuses que les hommes. Enfin, en raison d’un nombre insuffisant d’avions, les sauts d’entraînement sont trop peu nombreux ce qui explique le nombre très important d’accidents à la réception.
Le recrutement a plutôt concerné des jeunes gens, issus de milieux urbains, tandis que dans la légion les Allemands formaient un groupe important. En 1945,un bon tiers d’Allemands et Autrichiens formaient le gros de l’effectif, auquel se rajoutent des Français qui avaient quelque raison de fuir les rigueurs de la libération pour avoir servi dans la légion des volontaires français contre le bolchevisme, et beaucoup de ressortissants des pays des Balkans qui avaient pu combattre sous le mauvais drapeau. On y trouve même, mais en nombre très réduit, des Espagnols qui avaient participé à la guerre d’Espagne et à la seconde guerre mondiale.
Des parachutistes, pourquoi faire ?
Parmi les questions que l’auteur pose avec énormément de pertinence, il en est une qui demeure, toutes proportions gardées, encore d’actualité. Les sauts opérationnels sont plutôt rares, même si celui de Kolwezi en 1976 avec la Légion reste encore présent dans les mémoires. Lors de l’opération serval au Mali, un saut de même type a été effectué également.
Dans les opérations extérieures de l’armée française, depuis la fin de la guerre d’Algérie, les régiments parachutistes ont été utilisés comme force de choc dans des interventions au Tchad notamment. En Afghanistan, elles ont été intégrées au dispositif de l’ISAF, comme une force d’infanterie classique.
Dès les débuts de la guerre d’Indochine les troupes aéroportées semblent avoir été utilisées à contre-emploi par des commandements territoriaux soucieux d’obtenir des résultats mêmes ponctuels en matière de contrôle des territoires qui leur étaient assignés.
Les parachutistes sont utilisés comme des unités d’infanterie classiques, faisant du ratissage ou de la présence, se substituant souvent à des troupes statiques notoirement insuffisantes.
On ne peut s’empêcher de penser, à titre de comparaison, à l’utilisation de troupes aéroportées pour tenir des gardes statiques, lors des opérations Vigipirate ou Sentinelle actuellement.
Confronté à un adversaire qui connaissait parfaitement le terrain et qui utilisait tous les ressorts de la guerre révolutionnaire, l’encadrement des troupes aéroportées s’est très vite adopté à la façon de penser de l’ennemi.
Dans la pratique cela signifiait réaliser des opérations basées sur la légèreté, la souplesse, la mobilité et l’imprévisibilité, le plus souvent lors de combats nocturnes. Parmi les troupes aéroportées des commandos se sont constitués, notamment dans la légion ou au troisième RPIMa qui pratiquait, souvent avec des troupes indigènes, ce que l’on pouvait appeler une guerre de bandits. Ce sont souvent des membres des minorités ethniques du Vietnam qui ont servi de troupes supplétives à ces unités particulièrement efficaces sur le terrain.
Contrairement ce que l’on pourrait penser les troupes aéroportées ne bénéficiaient pas d’un traitement de faveur de la part des services de l’intendance. Comme il est de tradition dans l’armée française, le système D semble être la règle. Dès 1945 une missions française s’installe aux Philippines et en Inde pour se fournir en matériel dans les surplus anglais et américains de la guerre du Pacifique. L’adaptation du matériel aux exigences du terrain fait partie de ces problèmes récurrents souvent évoqués par celui qui était alors commandant, Marcel Bigeard. Ce dernier dénonce l’invraisemblable barda que doivent porter les hommes, une charge de 22 à 31 kg sans compter 2 kg de plus par journée de vivres supplémentaires.
Le mythe de la guerre asymétrique
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce ne sont pas les troupes de la puissance coloniale qui était les mieux équipées. À partir de 1951, le Vietminh dispose d’armes modernes, sa structuration rappelle celle des armées classiques, avec des bataillons et des régiments. Il existe également ce que le Vietminh appelle l’armée populaire qui sert sur le terrain et qui mène la guerre du faible au fort, caractéristique de la guérilla. La caractéristique de l’armée du général Giap a été d’associer une guerre artisanale, avec des fabrications de munitions dans les paillotes, et une chaîne logistique particulièrement performante alimentée par la Chine et l’Union soviétique. Dans le cas de la Chine ce sont souvent des armes modernes récupérées sur l’armée nationaliste et qui avaient été fournies par les États-Unis pendant la guerre civile chinoise.
Les opérations militaires qui ont été conduites par les troupes aéroportées en Indochine sont décrites avec la volonté de montrer les difficultés spécifiques qui ont pu exister en matière de coordination entre les unités parachutistes et les autres forces.
L’opération Léa, en octobre novembre 1947 aurait peut-être pu changer le cours de la guerre. Dans le Tonkin, près de la frontière chinoise, près de 1000 parachutistes sont largués et l’état-major du vietminh, avec la présence de Ho Chi Minh et de Giap, parvient à s’échapper de justesse. À chaque fois que les troupes parachutistes sont employées, de façon autonome et en effectifs suffisants, notamment lors de l’opération de Dong Khé, lorsque 469 hommes sont largués sur la position qui avait été perdue, l’ennemi recule, malgré des effectifs, et même un équipement d’artillerie, largement supérieur.
À partir de 1950, le Vietminh dispose d’une artillerie de qualité, servi par un personnel compétent, s’appuyant sur une masse de coolies qui déchargent les troupes régulières de toutes les opérations de manutention.
Marie Danielle Demélas insiste également sur un certain nombre de scandales qui ont touché le commandement français en Indochine, et notamment l’affaire, assez mal connue, de l’inspection du général Revers. Le rapport sans concession se retrouve publié par la radio Vietminh, ce qui jette un discrédit sur un commandement qui semblait davantage soucieux d’obtenir quelques étoiles que de la conduite des opérations. Pour de surprenantes raisons les rapports sur les mouvements de troupes chinoises la frontière nord du pays sont le plus souvent ignorés.
En septembre 1950 les combats de la RC 4, que l’on connaît mieux sous le nom de bataille de Cao Bang, à proximité de la frontière chinoise opposent 5000 soldats français à plus de 35 000 vietminh largement équipée en artillerie. Les survivants fait prisonniers précéderont ceux de Dien-Bien-Phu quatre années plus tard. Ce sera la première défaite incontestable de l’armée française.
Entre 1951 et 1954, et sans doute en ayant tiré les enseignements de la défaite de Cao Bang, les troupes françaises parviennent à réaliser des opérations dans lesquelles les troupes aéroportées s’adaptent aux conditions d’une guerre de guérilla appuyée par des troupes conventionnelles.
Si le Vietminh doit reculer après avoir tenté différentes offensives, notamment dans le nord du pays, il se révèle comme un adversaire particulièrement pugnace et remarquablement équipé. C’est le cas lors de la bataille de Vinh Yen, sur la route de Hanoï, en janvier 1951, à Mao Khé, en mars 1951, à Nghia Lo en octobre, ou à Hoa Binh en novembre. Ces succès sont obtenus au prix de pertes importantes mais permettent d’obtenir un renforcement du soutien des États-Unis est un vote plus facile des crédits de guerre à l’Assemblée nationale.
La bataille de Dien-Bien-Phu n’a pas été la plus meurtrière du conflit, mais elle constitue véritablement un tournant puisqu’elle conduit à une prise de conscience brutale en métropole, c’était déjà le cas bien avant sur le terrain, que cette guerre ne pouvait être gagnée. Le général Navarre cherche à installer ce camp retranché afin de contrôler le nord du pays et empêcher le vietminh de pénétrer au Laos. L’idée est de fixer le Vietminh au nord du pays pour pouvoir protéger le delta du Tonkin d’une attaque massive. Et il faut noter que ce dispositif a effectivement fonctionné.
Cette bataille de Dien-Bien-Phu est très rapidement évoquée lorsque l’on traite la guerre d’Indochine, mais en dehors de la date de la chute du 7 mai 1954, on ne présente que très rarement les lieux de ce combat qui reste emblématique aujourd’hui dans la tradition des régiments parachutistes d’infanterie de marine, héritier de ces bataillons de parachutistes coloniaux.
Le vietminh rassemble près de 50 000 soldats face à 12 000 combattants du corps expéditionnaire. La proximité des collines voisines ou le Vietminh installe des pièces d’artillerie en nombre considérable lui permet de neutraliser très rapidement le terrain d’aviation, ce qui rend indispensable le recours à des parachutages massifs. Les tirs d’artillerie commencent le 13 mars 1954 pour s’achever le 7 mai. Du 1er avril au 6 mai plus de 3000 hommes, dont 750 volontaires qui effectuaient leur premier saut, s’engagent dans la bataille.
Du point de vue des opérations elles-mêmes, les parachutistes engagés se sont retrouvées dans une guerre qui relevait davantage de la guerre de tranchées que les opérations coup de poing. Loin de raconter le détail des combats, que l’on peut largement trouver par ailleurs, l’auteur insiste sur la perception que l’on a pu avoir en métropole de ce qui a pu apparaître comme un sacrifice rédempteur.

Loin d’avoir mené cette guerre de la meilleure des façons, l’autorité politique a mis en avant la résistance dans le camp retranché de Dien-Bien-Phu comme un objet de communication.
Paris-Match a publié à la une « un soldat de Dien-Bien-Phu » qui était en réalité un correspondant de presse égratigné par la chute du toit de son abri le 13 mars 1954. Profitant de l’aubaine, le correspondant du journal Caravelle se fait faire un pansement, mettre le bras en écharpe, barbouiller la figure de mercurochrome, avant de poser en se présentant comme un héros blessé.
Cet ouvrage est parfaitement documenté, mais il pourra sans doute déplaire à ceux que l’on qualifie de « Fanamilis », qui se contentent parfois d’une démarche historique plutôt sommaire.
Ce travail de recherche peut en effet dérouter puisque l’organisation est davantage thématique que chronologique. Mais la plupart des aspects évoqués sont, sinon inédits, au moins largement novateurs dans la démarche. On s’intéressera par exemple au traitement par Hollywood de la bataille de Dien-Bien-Phu, au sort des prisonniers, mais aussi au retour de ces prisonniers de guerre dont certains se sont ensuite engagés dans la guerre d’Algérie.
La mémoire de la guerre d’Indochine est toujours entretenue dans un certain nombre de régiments parachutistes de l’armée française. Je ne peux m’empêcher de citer le huitième bataillon de parachutistes coloniaux, constitué en 1951, présent en Indochine jusqu’en 1954 et dont la totalité des hommes a disparu dans les combats du camp retranché et dans les camps de prisonniers du Vietminh. Le huitième régiment parachutiste d’infanterie de marine de Castres en est aujourd’hui l’héritier.