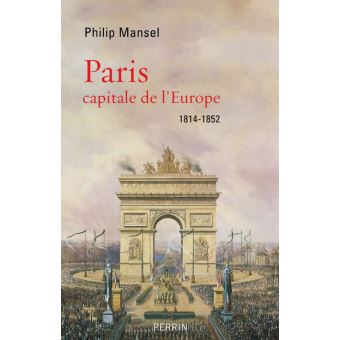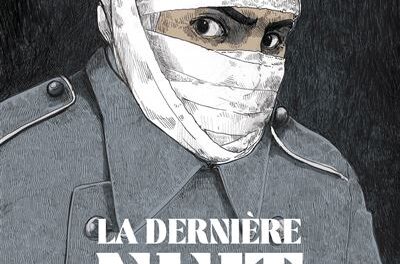L’ouvrage s’organise en chapitres à la fois chronologiques et thématiques. De l’invasion européenne de 1815 à l’anglophilie des années 1820, des péripéties politiques juilletistes aux réseaux littéraires et politiques préparant la II° République, d’une histoire des mouvements artistiques à l’étude de la propagande royale, Philip Mansel s’efforce de ne laisser de côté aucun des éléments qui font de Paris un moteur de la civilisation européenne. Si l’essentiel de l’ouvrage concerne le premier XIX° siècle, il s’achève par une fresque synthétique et efficace des réalisations impériales jusqu’en 1871.Les quatre premiers chapitres s’attardent, parfois trop longuement pour le lecteur, sur les années 1814-1815, riches du double départ napoléonien, de la double réinstallation des bourbons et de la mise en place des réseaux de sociabilité tant liés à un camp qu’à l’autre. La création de la Quadruple Alliance, le 20 novembre 1815, en puissances occupant la France, est la partie visible d’un iceberg diplomatique et intellectuel minutieusement décrit, symbole de l’unanimisme des gouvernants européens considérant la nécessité d’une alliance informelle de tous les Etats pour préserver la paix sur le continent. La France, exsangue de 916 000 hommes, y encourage. Les débuts de la monarchie constitutionnelle y sont dépeints d’une manière vivante, en cherchant toujours à voir la construction de Paris comme modèle européen. Les descriptions des assistances féminines internationales aux séances du Palais-Bourbon (pages 120-126) ne manquent pas de sel. Enfin les salons, tant libéraux que royalistes ou bonapartistes, ont trois points communs : tenus par des femmes, ils sont fréquentés tant par d’anciens impériaux que par des émigrés enragés, et sont les principaux lieux de sociabilité de la noblesse européenne. Le mode de fonctionnement de ces salons y est décrit avec minutie, installant pour longtemps la mode parisienne, pour confirmer le dicton faisant de Paris « le paradis des femmes, le purgatoire des hommes et l’enfer des chevaux » (p.164).L’influence britannique entre 1814 et 1830 fait l’objet d’un chapitre à part. Les « émigrés », dont Louis XVIII lui-même, ont gardé de leur séjour anglais des habitudes, références et réflexes politiques. En 1816, 68% des visiteurs étrangers à Paris sont britanniques, attirés par la cour et ses bals, et ce sont le plus souvent des membres de la haute aristocratie économique et politique, plus écossaise et irlandaise qu’anglaise, trouvant « la société parisienne moins condescendante et plus accessible que celle de Londres » (p.173). Les romans britanniques inspirés par Paris, les collections d’œuvres d’art franco-britannique, les cercles parisiens fondés sur le modèle des clubs, comme le « Cercle de l’Union », lié aux milieux diplomatiques, l’anglophilie des écrivains français rendant visite au « grand écrivain » (Charles Nodier à Walter Scott en 1821), l’intérêt grandissant pour les chevaux, tout semble témoigner d’une très forte anglophilie dans les pratiques de cour françaises. Beaucoup voient dans le modèle constitutionnel britannique un modèle pour la nouvelle France. La multiplication des ouvrages consacrés au sort des monarques britanniques du XVII° siècle ne laisse que peu présager d’une pérennité des Bourbons.
Le chapitre consacré au meurtre du duc de Berry, le dimanche 13 février 1820, « à 22h58 » (p.192), s’il n’est pas nouveau dans les faits traités, est une agréable synthèse, très documentée, des étapes de l’agonie et de l’influence de cet assassinat sur les milieux parisiens. Le meurtrier, Louvel, bonapartiste isolé et fanatique, excita par son geste les affrontements entre monarchistes et bonapartistes. Michelet écrit dans son Journal : « Louvel a vengé Ney ». En juin 1820, les 5000 étudiants des facultés, des écoles, de Saint-Marcel – 30 000 personnes le 9 juin, crient contre les Emigrés. Louvel, exécuté l’avant-veille, est brandi comme un martyr de la liberté. Deux factions s’opposent, dans la rue comme à la Chambre : les ultras, autour d’Artois, et les libéraux, autour de La Fayette, Laffitte, Constant. La naissance du duc de Bordeaux, héritier de la Couronne, calma les esprits, mais il fallut la présence à l’accouchement du bonapartiste maréchal Suchet pour que la rumeur d’une substitution fût écartée. Charles X, ancien comte d’Artois, accéléra les liens entre aristocratie et haute bourgeoisie d’affaires, à la différence des autres cours européennes qui y trouvaient motif à discussion. Les anciennes familles émigrées et l’Eglise catholique assirent plus fortement leur emprise sur l’Etat. Mais l’institution emblème des sentiments des Parisiens envers le roi et le gouvernement est la Garde nationale de Paris. De 1817 à 1821 ses effectifs avaient diminué de moitié, et si elle bénéficiait des largesses du roi, ancien lieutenant-colonel de la Garde, sa revue était parfois l’occasion de crier « Vive la liberté de la presse » ou « à bas les ministres » (p.246). Le peuple de Paris progressivement se fit menaçant à l’encontre des grands nobles ; cet état de fait semblait menacer le roi, qui s’appuyait sur la province et le sentiment anti-parisien ; la multiplication des ouvrages à la gloire de la campagne, les séjours fréquents de la cour et des élites économiques dans les villages de Neuilly, à Saint-Cloud, dans la vallée de Montmorency, incitaient au manichéisme anti-parisien, même si les étrangers louaient toujours, comparant avec le smog londonien, la « transparence de l’air » parisien (p. 252).
Les « Trois Glorieuses » de juillet 1830 font l’objet d’un chapitre où chacune des journées est traité dans le détail. Les destructions, les menaces de la foule, l’effroi mêlé d’enthousiasme des étrangers présents à Paris, y sont décrits, tout comme les désillusions des cours européennes vis-à-vis de Louis-Philippe aussi, surtout après l’annonce de l’abandon de l’hérédité pairiale, « dernier faible boulevard de l’aristocratie française ». La description des années de la monarchie de Juillet à Paris commencent par une commémoration, celle du coup d’Etat de 1830 par l’érection de la colonne de la Bastille, et par une description de l’épidémie de choléra de 1832. Les accusations traditionnelles d’empoisonnement des puits visaient cette fois le roi lui-même, et son gouvernement. La procession populaire pour l’enterrement du général Lamarque, libéral et adversaire de Louis-Philippe, faillit provoquer une révolution, la foule criant « A bas la poire molle », « vive la République », « aux armes ! » : 3000 insurgés, 200 barricades, 150 morts et 500 blessés en deux jours de combats. Le dévoilement de la statue de Napoléon sur la colonne Vendôme en 1832 permit aux « Vive l’Empereur » de fleurir ; en 1834 une insurrection républicaine de 1500 personnes et 30 barricades, organisée par Cavaignac échoua. L’enterrement des victimes de l’attentat dit de la « machine infernale » de juillet 1835 provoqua le rétablissement de la censure. Londres devenait « la terre nourricière de la révolution » tant les opposants à la monarchie de juillet s’y réfugiaient. Orléanistes et républicains s’affrontent, orléanistes et légitimistes aussi. La Chambre, les cafés, les gazettes, surtout étrangères, sont les espaces d’expression principaux de l’opposition.
Le chapitre intitulé « la ville d’encre (1830-1848) » est consacré aux liens entre littérature et politique. L’industrie de l’édition, le poids de journalistes comme Thiers ou Rémusat, le statut quasi divinisé pour leurs lecteurs de Balzac ou Eugène Sue, est une constante de l’époque, tant en 1830 qu’en 1848. Comme le prophétisait Chateaubriand : « une monarchie qui devait son ascension à la presse tomberait par la presse » (p.345). Paris lit : sur 1000 parisiens en 1830, 193 illettrés, quand il est de 496 dans le reste du pays. Mais ces chiffres restent supérieurs au reste de l’Europe ou aux Etats-Unis. Lecture silencieuse, lecture à haute voix pour les illettrés, tout est lecture : Lady Morgan écrit « Entrez dans la loge de concierge la plus grossière de l’hôtel le plus simple du quartier le plus reculé, vous y trouverez des éditions bon marché des meilleurs auteurs : seule la pire indigence ne peut se les offrir ». Les auteurs se voient offrir des contrats mirifiques : le libraire Paulin donne 500 000 francs à Thiers à la remise du manuscrit de son Histoire du Consulat et de l’Empire. Le jour de sa publication, 10 000 exemplaire furent écoulés. Beaucoup d’auteurs continuent de recevoir un soutien financier du gouvernement et de la Cour : Lamartine, Hugo, Nodier, Heine, recevaient des pensions annuelles de plus de 1000 francs. Charles X en exil après 1830 continuait à verser 12000 francs par an à Chateaubriand. Sainte-Beuve, Dumas, Musset, étaient employés comme bibliothécaires de ministères. Jules Michelet enseigne l’histoire à la fille de la duchesse de Berry, bien qu’il chante les louanges de la Révolution française. Un « torrent de Mémoires » est publié dans ces années-là par des hommes politiques à l’âme d’écrivain (Talleyrand, Thiers, Guizot) ou des écrivains devenus politiques (Constant, Lamartine, Chateaubriand). Le genre littéraire de l’Histoire naît dans ces années-là : la fondation en 1822 de l’Ecole des Chartes en fut le premier signe. La publication de collections de Mémoires, les écrits d’Augustin Thierry, protégé par La Fayette et par le duc de Broglie, sont des éléments des 40 millions de pages annuelles imprimées pour ce genre littéraire (en 1825).
Paris est aussi une ville de journaux : 60 000 abonnés en 1830, 200 000 en 1848. Le journal La Presse d’Emile de Girardin double ses tirages entre 1836 et 1845 (22 000), grâce aux premières insertions de publicité. Beaucoup lus, beaucoup critiqués aussi : les journalistes sont dénoncés comme corrompus et parangons de vertu déplacée, mais leur influence politique n’a jamais été aussi forte. Barbey d’Aurevilly critique les « prostituées masquées qu’on appelle des articles » mais en écrit le plus possible (p.359). Les romans de Balzac sont d’abord édités dans les journaux.
Paris assure aussi une très importante correspondance : 3.2% de la population française écrit et reçoit 27% des lettres françaises… 200 boîtes aux lettres, 7 distributions quotidiennes, assurent la distribution de 9 millions de lettres (1829). Les correspondances se gardent, se publient sous forme de mémoires, se recopient et se volent : Louis XVIII puis Charles X entretenaient un réseau d’informateurs (le « Cabinet noir ») dans toute l’Europe chargé d’intercepter et recopier les lettres des hommes politiques et hommes de lettres comme Chateaubriand. Goethe est émerveillé par l’activité parisienne : « des hommes tels qu’Alexandre von Humboldt [qui habitait Paris] (…) m’en disent plus en un seul jour que ce que j’aurais appris en continuant des années à suivre mon chemin solitaire » (lettre à Eckermann).
Capitale politique et littéraire, Paris est aussi la capitale scientifique de l’Europe : les cours de minéralogie de Cuvier au Jardin des Plantes, d’histoire par Guizot à la Sorbonne, de philosophie par Victor Cousin, d’économie par Charles Dupin, sont complets deux heures avant : les cours sont gratuits et ouverts à tous. La Bibliothèque et les Archives royales sont visitées par tous les étrangers. Gay-Lussac, Arago, Daguerre, Ampère, Geoffroy Saint-Hilaire, sont connus et réclamés dans toute l’Europe. Des étudiants venus de toute l’Europe se pressent aux cours de dissection de Dupuytren, et avaient fondé à Paris leur propre association, la « Paris Medical Society » (p. 363). Paris attire aussi les orientaux : en 1826, 50 étudiants égyptiens y sont envoyés par Mehemet-Ali ; Ismaïl Pacha, futur Haussmann du Caire, est formé à l’école militaire égyptienne de Paris entre 1845 et 1848. Les grands réformateurs de l’Empire ottoman, Mustafa Rechid Pacha comme Ali Pacha, ont fait leurs études à Paris. Le français devient vers 1830 la langue de communication entre Orient et Occident, remplaçant l’italien. La langue de l’Académie militaire de Constantinople comme celle des Arméniens instruits est le français. Madrid, Moscou, les Etats-Unis, Constantinople, remplacent Londres dans les phares de l’imaginaire parisien. L’essor de l’image parisienne tant en Europe qu’à Paris même développa un fort nationalisme culturel.
Le nationalisme français se développa à partir de 1830 comme une « religion » (p.399), la France devenant, pour Le Globe, le « Christ parmi les nations ». Dans le même temps, jamais Paris n’avait été autant vue comme la capitale de l’Europe : 47000 étrangers à Paris en 1830, 104000 en 1849, 174000 en 1847 : près de 10% de la population du département de la Seine était d’origine étrangère. La crise ottomane de 1840 développa un fort sentiment anglophobe et germanophobe à Paris. L’attentat manqué de Darmès contre Louis-Philippe le 15 octobre 1841 unit dans les faits la monarchie et le sentiment nationaliste : les foules cessèrent de demander la Marseillaise à la fin des représentations théâtrales. Les efforts de Louis-Philippe pour empêcher une guerre européenne se retournèrent alors en sa faveur, le nationalisme s’apaisa dans les journaux, chacun appelant à une « paix européenne » sous l’égide de la France, et Guizot remplaça Thiers. Mais la vie quotidienne parisienne ne changeait pas, toujours à la recherche « de l’or et du plaisir » (p.408) : les Boulevards se développaient, avant que les Champs-Élysées, vers 1848, ne les surpassent. Paris était apaisé.
Les funérailles napoléoniennes du 14 décembre 1840 furent un instant d’unanimité nationale : le « retour des cendres », malgré le froid (14°c en dessous de zéro) 600 000 personnes se sont pressés le long des Champs-Élysées et aux Invalides, dans une discipline rare, selon les très nombreux observateurs étrangers – mais peu d’Anglais. Les conséquences de la crise ottomane, qui faillit provoquer une guerre entre la France et les anglo-allemands, étaient toujours palpables, et Heine « jugeait plus simple en France de restaurer un Bonaparte que d’instaurer la république », tant l’indignation nationaliste était forte. La même année, Louis Napoléon Bonaparte avait tenté son lamentable second essai de coup d’Etat à Boulogne-sur-Mer. La mort du duc d’Orléans, héritier du monarque, en 1842, d’une fracture du crâne, forgea une nouvelle étape de la « religion du nationalisme », ouvrant de nouvelles perspectives pour les napoléoniens, les libéraux et les républicains.
Le dernier chapitre est consacré au peuple de Paris et aux sentiments qu’il inspire aux écrivains et aux étrangers. Le Paris des salons, bals, restaurants, Boulevards, laisse de côté celui des « classes dangereuses » (Louis Chevalier), celui des « douze heures noires » (Simone Delattre, 2003). Si entre 1820 et 1847 la richesse produite à Paris a doublé, le contraste entre riches et pauvres n’a cessé de se creuser. Dans les années 1820, 75% des parisiens sont enterrés dans des fosses communes. 8% des parisiens sont classés comme « indigents » par les autorités municipales, chiffre sans doute minoré. 24 asiles de pauvres, 69 000 personnes gérées par les bureaux de charité des arrondissements. « Si les riches venaient à Paris pour le plaisir ou l’instruction, de nombreux étrangers pauvres s’y installaient pour le pain bon marché » (p.431). Cette situation développe les écrits socialistes : Louis Blanc, Armand Barbès, Auguste Blanqui, Charles Fourier, Proudhon, même Georges Sand (dans Le compagnon du tour de France), développent leurs écrits de transformation de la société. Karl Marx vient à Paris en 1843. La ville est le centre intellectuel des penseurs allemands (Heine, Wagner, Engels – que Marx rencontre là pour la première fois, au café de la Régence), russes (Bakounine, Annenkov), italienne (Mazzini). Ce maelström intellectuel, éditorial et politique voit aussi naître les premiers ouvrages liés à l’antisémitisme moderne, liant lutte des classes, contrôle du pouvoir et juifs : Les Juifs rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière de A. Toussenel, publié en 1847, attaque les Rothschild, les calvinistes et les Juifs en même temps.
La crise économique des années 1843-1848 accélère les mécontentements. Les pièces de théâtre prennent un ton pro-révolutionnaire en refaisant l’histoire de la révolution française. Michelet dans ses cours au Collège de France fait de la Révolution de 1789 « l’acte fondateur de la France moderne ». Palerme donna le coup d’envoi des révolutions de 1848, le 12 janvier. Un mois plus tard la Carmagnole et le Ah ça ira faisaient leur réapparition dans le public des théâtres parisiens. Le 24 février 1848 le trône de Louis-Philippe fut brûlé place de la Bastille. Le gouvernement provisoire de Lamartine tenta de calmer les esprits, 200 clubs politiques furent fondés en deux semaines ; abolition de l’esclavage, abolition des titres de noblesse, abolition de la peine de mort en matière politique : les Polonais, Allemands, Arméniens, Hongrois, qui se sont battus dans les barricades parisiennes de février 1848 exportaient leur témoignage dans leur pays, enflammant l’Europe.
Les idées nationalistes, fermentées dans le chaudron parisien de 1815 à 1851, ouvrirent la voie aux nationalismes européens. La nouvelle république de 1871, avec les 25000 morts de la Commune de Paris, et la dissolution de la Garde nationale le 25 août 1871, détruisit « Paris comme force politique » (p. 481). La défaite française face à la Prusse sonna aussi momentanément le glas de l’influence française en Europe.
Cet ouvrage est le prétexte à un nombre important d’anecdotes utiles à la compréhension d’une époque souvent maltraitée dans le traitement des cours de lycée, celle d’un premier XIX° siècle mal connu, peu étudié dans les universités, alors qu’il pose les fondements de l’influence française en Europe et des règles politiques jusqu’à aujourd’hui. Parfois trop descriptif, à la recherche d’une exhaustivité impossible, ce livre est une première tentative pour dresser un bilan de l’influence de Paris en Europe. Très convaincant pour les années 1815-1830, il l’est un peu moins pour le reste de la période, mais l’immensité des faits présentés permet à chacun de développer ses propres analyses. Long, touffu, mais stimulant.
Copyright Clionautes